/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_6e83bb_lettrine-ornee-huesca.JPG)
Cantoral, siglo XVI, Catedral de Huesca, Aragon.
Photo T. Guinhut.
De l’Histoire de l’écriture
à la magie du codex et du livre,
en passant par le Don des Lettres :
Sylvia Ferrara, Yann Sordet, Sylvie Lefèvre,
Marion Uhlig & Thibaut Radomme, Neil Gaiman.
Silvia Ferrara : La Fabuleuse Histoire de l’invention de l’écriture,
traduit de l’italien par Jacques Dalarun, Seuil, 2021, 320 p, 22 €.
Sylvie Lefèvre : La Magie du codex, Les Belles Lettres, 2023, 296 p, 25,90 €.
Marion Uhlig, Thibaut Radomme & Brigitte Roux : Le Don des lettres,
Les Belles Lettres, 2023, 656 p, 59,90 €.
Yann Sordet : Histoire du livre et de l’édition, Albin Michel, 2021, 800 p, 32 €.
Neil Gaiman : L’Art compte, Au Diable vauvert, 2020,
traduit de l’anglais (Royaume Uni) par Patrick Marcel, 120 p, 15 €.
Tablettes d’argiles entassées ou brisées dans les sables, les bibliothèques cunéiformes nous ont révélé des catalogues des arbres et des minéraux, des traités médicaux ou destinés à l’exorciste, déjà des encyclopédies, jusqu’au Catalogue d’ouvrages de la bibliothèque du roi Assurbanipal[1]. Imaginée à la fin du IV° millénaire avant notre ère, l’écriture connut après la Mésopotamie maints avatars, égyptien, phénicien, grec et latin, pour être fixée sur des papyrus et circuler aisément. L’on sait qu’il fallut attendre Gutenberg, en 1454, pour que l’imprimerie commence de répande son papier encré au service des grandes œuvres de l’humanité. Il apparait, au travers des essais de Silvia Ferrara et de Yann Sordet, qu’écrire, confectionner et éditer des livres sont des étapes du savoir qui ont demandé des siècles et des siècles de constance et d’invention. Le « Don des lettres » concourt lors à la « Magie du codex », pour reprendre deux titres aux vertus bibliophiliques précieuses. Alors que le livresque passé est ainsi à notre service, le futur, nous rappelle Neil Gaiman, dépend de nos bibliothèques, et de lecteurs sachant lire en science et conscience.
Se livrant à une enquête érudite qui ne dédaigne pas la saine vulgarisation, Silvia Ferrara nous permet de voyager, tant dans le temps que dans l’espace, avec La Fabuleuse Histoire de l’invention de l’écriture, laquelle avait été précédée par une profuse enquête sur les empreintes, les signes, les traces graphiques, intitulée Avant l’écriture[2].
Quelque part auprès du jardin d’Eden mésopotamien ainsi que du fleuve nilotique, naissent aux alentours de l’an trois mille avant notre ère deux versions concurrentes, et qui cependant s’ignorent, de l’écriture : les cunéiformes et les hiéroglyphes. Mais au-delà de ces berceaux classiques, il faut aller explorer d’autres continents pour rencontrer les foyers chinois et mexicains, décrypter les graphies encore indéchiffrées de Chypre, de Crète et de l’Île de Pâques, témoignant de l’universalité de l’entreprise, malgré des formes dissemblables, figuratives, syllabiques ou alphabétiques. Ou encore les « quipus » incas, qui sont des cordelettes à nœuds, voire le syllabaire amérindien des Cherokee créé au XIX° siècle par un seul homme nommé Sequoyah. Icones, symboles, signes servent d’abord à « sceller des transactions », avant de composer de la poésie. Mais l’alphabet est « un système sophistiqué et supérieurement intelligent comme la philosophie et la démocratie ».
Loin de se contenter de ces écritures qui marquèrent la charnière entre préhistoire et Histoire, Silvia Ferrara s’intéresse de manière aussi bienvenue qu’originale à de curieux avatars, ces créateurs d’indéchiffrables qui ne cessent de jouer avec la perplexité d’un lecteur déçu et cependant fasciné : les médiévales « litterae ignotae » d’Hildegarde de Bingen, le Manuscrit Voynich, fleuri de plantes et de femmes nues au XV° siècle, et plus près de nous le Codex seraphinianus[3], la stupéfiante encyclopédie d’un monde impossible fantastiquement illustrée et aux élégants gribouillis.
Professeure de philologie mycénienne à l’Université de Bologne, Silvia Ferrara captive son lecteur au moyen d’un bel ouvrage un brin ludique, rigoureusement documenté, illustré, et d’une enquête aux révélations palpitantes : n’y a-t-il pas en cette aventure le plus grand bouleversement de l’humanité, tant il est à l’origine de son développement et de sa mémoire…
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_8ce415_ferrara-die-grosse-erfindung.jpg)
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_ab63a3_ferrara-salto.jpg)
Quand donc est né ce livre au sens où nous l’entendons aujourd’hui, donc après le rouleau du volumen, les feuillets reliés du codex ? Mais au premier siècle avant Jésus Christ, nous dit une autre Silvia, cette fois Sylvie Lefèvre, en sa Magie du codex. Elle nous offre une manière particulièrement originale de découvrir ce miracle technologique dont on tourne les pages, avec une commodité que ne permettait pas le volumen. Ainsi s’intéresse-t-elle à la matérialité de l’objet et de sa représentation du Moyen âge à nos jours. Certes, pour le ravissement des yeux, cette médiéviste privilégie les reproductions de manuscrits médiévaux. Car lors le livre est d’abord saint, Bible, Evangiles. Mais aussi objet précieux et offrande tenue dans des mains respectueuses, ou texte en train de s’écrire sous les doigts des quatre évangélistes, de Saint Jérôme traduisant la Bible en latin au IV° siècle…
Il s’agit souvent de mise en abyme, car le livre est visible sur nombre de pages peintes : fermé, ouvert, feuilleté, il est « corps, folio, page, pli, cœur », pour reprendre le sous-titre de Sylvie Lefèvre. Et cœur parce que l’on connait au moins deux livre-cœurs. En particulier le Chansonnier de Jean de Monchenu vers 1475 : ouvert, ce sont deux cœurs, refermé, ils n’en font qu’un…
Aujourd’hui encore, et pour longtemps espérons-le, le codex est déploiement de pages, comme autant d’ailes d’un oiseau. En témoignent ces « placards » de lettres gothiques sur fond blanc, parmi le décor de personnages, d’animaux et d’architectures dans une édition incunable des œuvres d’Aristote en 1483. Lui répondent par-delà un demi millénaire les livres animés ou pop-up, dont sont friands les enfants et les collectionneurs ; lorsque leurs robustes feuillets se soulèvent en personnages debout, en architectures érigées. L’on devine que l’envol des cartes d’Alice au pays des merveilles, est propice à la « magie du pli » et à la troisième dimension. Le livre « illusionniste » fleurit au XIX° siècle, jouant avec les codes de l’affiche, avec les techniques de façonnage de découpage et d’impression de plus en plus virtuoses.
Manuel original, La Magie du codex ne laissera plus ignorer au lecteur ce que sont le tranchefile et le signet, la « main » de l’index… Accompagné de foisonnantes illustrations, cet ouvrage est un trésor historique, esthétique et bibliophilique.
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_4c9ba0_lefevre-codex.jpg)
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_9b7c27_lefevre-la-lettre.jpg)
Trésor peut-être encore plus rare, Le Don des lettres, dont la somptueuse couverture s’orne d’une Vierge à l’enfant sur fond noir, entourée d’une mandorle de branches grises où sont suspendues des lettres d’or, soit la Vierge à l’arbre sec de Peter Christus. Ceci pour annoncer l’abondance des « jeux de lettres », dans la littérature manuscrite médiévale. Car à la réserve des caractères extrême-orientaux, le livre est fait de lettres. Ne peut-on pas les considérer comme un don de Dieu ? En ce sens « le don des lettres » permet d’accéder à la Création, à l’instar du judaïsme pour lequel le nom de Dieu participe de la « théorie kabbalistique du langage[4] ». Or à cet égard le livre chrétien et médiéval accorde à la lettre une dignité considérable. En toute cohérence, les chapitres du Don des lettres sont comme il se doit ordonnés alphabétiquement, et s’achèvent par l’alpha et l’oméga du nom de Dieu et du Christ pantocrator.
Quand le B est de beauté, le L par exemple est autant celui de « liber », le livre, que celui du roi Louis, du lis, mais surtout « les trois composantes du poème placé sous nos yeux : les lettres, le langage et la loi ». L’on se doute que le M est bien plus que celui de Moïse, celui de Marie, Mère de Dieu…
Parfois, les lettres se suffisent à elles-mêmes. Comme lorsque le Pontifical de Jean de Venningen (vers 1462) trace à côté de « la formule rituelle de consécration d’une église », la figure de la croix « composée du mélange des alphabets latin et grec et copiés en deux couleurs ». La dimension symbolique n’empêche en rien celle du minimalisme esthétique, alors que tant de tableaux sur parchemin jubilent de détails et de couleurs, que ce soit parmi les psautiers, destinés à être chantés, ou parmi les initiales I et D, d’or sur fond d’azur, restées inexpliquées, pour illustrer une traduction des Héroïdes d’Ovide.
Mais au Moyen âge l’on peut être fort facétieux. En témoigne la Ballade de l’ABC, « qui se plait à vautrer l’alphabet dans le bas corporel », soit une strophe consacrée au mot « con »…
Les manuscrits enluminés regorgent de lettrines historiés ou nom, les lettres colorées courent autour des figures, accompagnant la sainte trinité, la Vierge, les anges, les saints et les animaux. Un détail exquis achèvera de nous convaincre de la beauté d’un tel ouvrage dont l’érudition stupéfie : les citations médiévales sont traduites en français moderne, en une seconde colonne de couleur bistre…
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_9c2988_uhlig-don-des-lettres.jpg)
Il faut à l’écriture et au codex trouver la pérennité du livre, qui n’allait pas de soi, traverser des étapes préparatoires avant de trouver l’assomption que nous connaissons en nos librairies et nos rayons chargés de chefs d’œuvres et autres peccadilles lettrées. Yann Sordet, directeur de la Bibliothèque Mazarine, ne pouvait faire l’impasse, quoique bien plus brièvement que Silvia Ferrara, sur l’invention de l’écriture, avant de bondir en un prodigieux fleuve de succulente érudition, son Histoire du livre et de l’édition, jusqu’à la révolution numérique, celle qui donne un nouveau souffle au livre, à moins qu’elle ne l’essouffle.
Du volumen, ce rouleau antique de papyrus muni d’une étiquette (index ou titulus) dont le plus ancien conservé vient du IV siècle avant notre ère avec un poème orphique, nous passons au codex de l’ère chrétienne, cependant attesté au moins dès l’an 90 avec les Epigrammes du poète latin Martial). Entre temps la Renaissance carolingienne impose l’écriture ronde, que l’appelle « caroline ». Venue de Chine, la fabrication du papier s’impose au XIII° siècle en Europe. La typographie prend son essor avec la Renaissance humaniste, alors que l’invention des périodiques a lieu au XVII° siècle, avant les journaux que nous pratiquons encore. De manière concomitante, la librairie s’engage résolument dans la société de consommation culturelle. Jusqu’à son avatar numérisé, rien n’entrave la dimension symbolique du livre, qui fait vivre tant bien que mal l’auteur, l’éditeur et le libraire, enfin touche le modeste lecteur aussi bien que le collectionneur et le bibliothécaire.
Depuis la plus haute antiquité l’écriture comptable, à l’aide de jetons, bullae, et tablettes d’argile, croise l’écriture divinatoire : pattes d’oiseaux, écailles et omoplates gravées. Bientôt la forme du signe se dirige vers l’abstraction linguistique et l’intention calligraphique. La période médiévale est celles des scriptoria (VIe-VIIIe siècle) quand les savoirs se polarisent entre sacré et profane. Il faut en la Constantinople chrétienne confronter le texte avec l’iconoclasme. Du XII° au XV° siècle vient l’ère des librarii, où glose et index enrichissent le livre, surtout destiné au salut du croyant, non sans opérer des changements cruciaux : séparation des mots et des vers, des chapitres, apparition de l’image. À l’ère triomphante du gothique, l’on note la musique, l’on voit l’émergence de nouveaux professionnels, des commanditaires, fournisseurs, libraires et clientèles, en particulier au travers du livre d’heures : production de luxe aux côtés du livre ordinaire à l’usage des laïcs. Aussi l’on saura tout des encres et des enluminures, du papier et de la reliure, des bibliothèques médiévales où de lourds volumes sont parfois enchaînés.
Il y eut des précédents extrême-orientaux à l’invention de Gutenberg, gravure sur bois et livrets xylographiques par exemple. Cependant, très vite, l’imprimerie devient européenne dès la fin du XV° siècle, avec plus de sept millions d’exemplaires incunables produits. L’on rencontre des humanistes imprimeurs, comme Alde Manuce[5] ou Josse Bade. Une nouvelle économie use déjà de prospectus et spécimens, de foires et catalogues, soit des outils de marchandisation. Evidemment le livre ne peut échapper au pouvoir politique. Outil de prestige, de législation, il se voit également soumis à la censure, d’autant que la Réforme protestante pèse de tout son poids, relevant le « défi de la traduction ». Via le « privilège du Roi », le contrôle de l’édition est un enjeu crucial, entre pouvoirs spirituels, séculiers et corporatifs, comme lorsque la mise à l’index permet d’interdire et d’excommunier, voire de livrer au feu[6].
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_37a6c5_ciceron-epistolae-familiares-1493-mer.JPG)
Marci Tullii Ciceronis Epistolae familiares, 1493.
Biblioteca Juan Pablo Forner, Mérida, Extremadura.
Photo T. Guinhut.
Peu à peu l’identité visuelle du livre se vêt de page de titre, de marges, de formats divers, de créativité typographique et de singularités de mise en page. L’art de la lettre voit le triomphe du romain et l’expérience de l’italique, quand le livre scientifique se pare d’une « imagerie », qu’il s’agisse de médecine, de botanique et de sciences naturelles, de géographie ou d’astronomie
La librairie de l’âge classique n’échappe ni à la « police du livre », ni à la contrefaçon. Alors naissent la presse, la gazette, le « livre missionnaire », la pédagogie jésuite par le livre, la populaire Bibliothèque bleue et les almanachs. Avant que les péripéties éditoriales des Lumières défraient la chronique, au travers de l’Encyclopédie, entre 1752 et 1772, De l’esprit d’Helvétius, notoirement athée, en 1758, ou l’Emile de Rousseau en 1762, tous menacés, voire brûlés. La question de la liberté de la presse devient urgente, ainsi que celle de la reconnaissance de l’auteur et du statut des œuvres, tels que les défend Beaumarchais.
Yann Sordet s’interroge : « l’édition française à travers Révolution, Empire et Restauration : césure ou transition ? » La liberté d’imprimer fut brièvement totale avant le « code impérial de la librairie » et le système du brevet (1810). Un nouveau monde industriel, les mutations du papier, la dynamique des inventions, la mécanisation croissante de l’impression et de la composition, presse rotative et fin du caractère mobile font du XIX° siècle une explosion technique, mais aussi des consommations ; bientôt assises sur « le règne de l’image », de la lithographie, le renouveau de la gravure sur bois, puis la photographie qui vient bouleverser la presse. Le droit d’auteur se voit balisé par la convention de Berne (1886), et dans le cas des États-Unis par l’International Copyright Act (1891), non sans que la censure s’éclipse si facilement devant une liberté de la presse durement conquise. C’est aussi le siècle de la massification de l’alphabétisation.
La naissance des « maisons d’édition » jouxte l’apparition des grands entrepreneurs de l’imprimerie, ce qui entraîne parmi les métiers du livre et les organisations professionnelles l’irruption du syndicalisme ouvrier. Les libraires, bouquinistes et relieurs prolifèrent, quand la presse de masse invente le feuilleton, quand l’édition voit poindre la « révolution Charpentier » et les « livraisons et romans à quatre sous », puis les guides de voyage, comme le fameux « Baedeker ». Chez les Anglo-saxons, ce sont des « Penny bloods » et des « Pulp Magazines ». L’Instruction publique entraîne son lot de manuels, revues, dictionnaires et matériaux pédagogiques, sans compter la survenue de la littérature jeunesse, comme celle de la Comtesse de Ségur.
Quant au XX° siècle, il est le père d’une « production en voie de dématérialisation », au travers de la fin du plomb, via l’offset, la photocomposition et l’informatisation des procédés, jusqu’à la micro-informatique et l’auto-édition. Or le livre d’artiste et la reliure sont résiduels à l’âge des smartphones, quand mondialisation et flux de traductions échangent leurs pouvoirs dans des oligopoles de l’édition, comme « Galliflagrasseuil », manœuvrant les prix littéraires, sans totalement obérer le renouvellement des « indépendants et francs-tireurs » ; à moins de devoir annoncer la fin des éditeurs.
Outre la révolution de Gutenberg, celle de la culture de masse au XIX°, puis notre internetisation, des phénomènes et moments phares sont ici mis en relief : les titres à succès (long-sellers) comme L’Astrée d’Honoré d’Urfé ou L’Imitation de Jésus Christ de Thomas A Kempis dès le XVII° siècle, l’immensité de la production hollandaise aux XVII° et XVIII° siècles, l’Aréopagitica de John Milton, qui fut le premier et fort éloquent manifeste pour la liberté de la presse en 1644, la circulation des livres clandestins et libertins au XVIII° siècle, parmi bien d’autres exemples excitants et pertinents…
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_2cd59b_sordet-histoire-du-livre.jpg)
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_d01a79_art-du-livre-citadelles.jpg)
Il s’agit bien avec Yann Sordet de renouveler la recherche en considérant « l’archéologie de l’objet » et « la fabrication typographique ». Le volume manuscrit ou imprimé est marchandise et « ferment » de civilisation. En outre, du parchemin enluminé monastique à la démocratisation du poche, les formes qu’il emprunte sont également significatives des systèmes de pensée. Ce pourquoi, fidèle à sa démarche, il s’interroge en fin de volume sur les nécessités du droit d’auteur et celle de l’« open access », dans la tradition de Condorcet, pour qui, en 1777, « les privilèges de la propriété littéraire [sont] une gêne imposée à la liberté, une restriction mise aux droits des autres citoyens » ; au risque de léser l’auteur et de décourager son long travail…
Non seulement Directeur de la bibliothèque Mazarine, à Paris, mais aussi rédacteur en chef de la revue Histoire et civilisation du livre, Yann Sordet fait œuvre à la fois synthétique et sommitale, déroulant une poignée de millénaires d’innovations. Agrémenté de deux cahiers d’illustrations en couleurs, d’une bibliographie pointilleuse, de notes et d’un index généreux, l’ouvrage est à la fois un voyage temporel qui ne lâche pas son lecteur, un voyage géographique et technologique, une amitié entre connaissance et transmission, tant l’édition peut offrir au bibliophile l’alliance du savoir, du déploiement de l’imagination et celle de l’esthétique de l’objet livre. Quoiqu’à cet égard il faille regretter que l’éditeur de ce délicieux pavé, de cette forêt presque entièrement blanche et noire n’ait pas consenti à le relier avec des couvertures toilées, à l’instar de ses volumes précédents, intitulés Lieux de savoir[7]…
Sans nul doute, nous devons partager les éloges de Robert Darnton[8] en sa postface, louant la clarté « sans pédanterie » de cette somme érudite. Il vante également la table des matières détaillée, où l’on peut puiser de manière ponctuelle si l’on ne peut, hélas, se confier au flux d’une lecture continue. Il remarque « l’accélération progressives des révolutions », des plus anciennes écritures aux réseaux sociaux d’Internet où la lecture va des âneries communes aux pourquoi pas plus grands chefs-d’œuvre de la poésie ; ce qu’il juge plus important que « la révolution gutenbergienne ». Devant la marée du tout numérique, il constate avec soulagement une récente stagnation du livre sur écran et le retour en grâce l’imprimé : « Le codex est mort, vive le codex ! »
Notre essayiste aimé, Yann Sordet, pour le nommer encore, offre un précieux bagage historique et encyclopédique. Avec une rare clarté et un enthousiasme raisonné pour son sujet, il initie son lecteur à un monde enchanté, cependant sans cesse fait de main d’homme, au cours des millénaires. Il reste à imaginer un second tome pour le futur du livre et de l’édition, qui serait de l’ordre de la science-fiction et de l’Intelligence Artificielle, et qui, venu de l’an 5000 tomberait entre nos mains éblouies, peut-être inquiètes, tant on y aurait brûlé les livres, comme le font les pompiers de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury[9], sinon comme la sélection trop drastique de L’An 2440 de Louis-Baptiste Mercier[10], où les intelligences totalitaires les auraient effacés ; à moins que l’imagination humaine ne sorte vainqueur en créant des volumes inouïs. Car le livre reste un gage salvateur, à l’abri et en dépit d’un législateur attentif, voire enclin à une censure que les totalitarismes, politiques, religieux et groupusculaires aiment à pratiquer dans une guerre continue contre l’imaginaire et le savoir. Comme nous le rappelle Yan Sordet, le socle de la mémoire livresque joue sur l’étymologie du mot livre venu de liber en latin, qui est une écorce appelant l’écriture manuscrite, en appelant son corollaire, la liberté.
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_c54345_gaiman-american-gods.jpg)
/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_240dc6_gaiman-l-art-compte.jpg)
Car les bibliothèques « sont une affaire de liberté » affirme avec un aplomb nécessaire, dans L’Art compte, l’écrivain américain d’aujourd’hui, Neil Gaiman, spécialiste de romans fantastiques fort réussis, comme Le Dogue noir[11]. De plus il ne manque pas de nous prévenir : « notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l’imagination ». Ne dit-on pas que les cadres et ingénieurs de nouvelles technologies américains ont été des lecteurs adolescents de science-fiction ? A contrario il y a une forte corrélation « entre les enfants de dix et onze ans qui ne savaient pas lire » et « le nombre des détenus » dans les prisons du futur. Outre sa qualité de « drogue d’appel vers la lecture », la fiction « développe l’empathie ». Aussi fermer une bibliothèque « pour gagner de l’argent », c’est « voler l’avenir pour payer le présent ». Si nos jeunes gens, agenouillés sur les smartphones, lisent moins, ils auront moins de mots, moins d’intrigues, moins d’idées et d’ouverture vers autrui pour dire et construire le monde, pour le défendre contre les tyrannies. Or « les livres sont notre façon de communiquer avec les morts. Notre façon d’apprendre des leçons de ceux qui ne sont plus avec nous, la façon dont l’humanité elle-même s’est édifiée, a progressé, a rendu le savoir graduellement plus important ».
Né en 1960 en Angleterre, Neil Gaiman a écrit une trentaine de romans et bandes dessinées, dont Stardust, Coraline et La Mythologie Viking. Sa série de bande dessinée Sandman est un classique du roman graphique. American Gods fait s’affronter d’anciens dieux devenus superhéros de comics et les nouveaux dieux barbares du consumérisme et des technologies exponentielles. Quant à ce mince volume revigorant intitulé L’Art compte, illustré au trait et avec humour par Chris Ridell, il s’achève par un « Créez de l’art ! » et commence par un « Credo » : « Je crois qu’on peut opposer ses idées à d’autres qui déplaisent. Qu’on devrait être libre de discuter. D’expliquer, de clarifier, de débattre, de scandaliser, d’insulter, de fulminer, de moquer, de chanter, de dramatiser, de nier ». Ajoutons, de blasphémer. Voilà qui est aussi clair qu’indispensable face aux fanatiques au cerveau carbonisé par un seul livre, politiquement sacré et farci d’objurgations génocidaires, qu’il soit meinkampfesque, léninoïde ou coranesque. Lire Silvia Ferrara, Sylvie Lefèvre et ses honorables collègues médiévistes, Yan Sordet et Neil Gaiman nous propulse vers la possibilité de la Torah, vers Tite-Live et Shakespeare[12], Flaubert et Ayn Rand[13], Emily Dickinson[14] et Georg-Friedrich Hayek, par une concaténation qui est celle d’un monde ouvert à l’imagination, à la création, au pluralisme des idées contradictoires, à la prospérité intellectuelle ; à la dignité libérale enfin.
Et s’il était besoin de prouver que Neil Gaiman tient à sa liberté conceptuelle, allons apprécier à sa juste valeur un texte, illustré avec grâce par P. Craig Russell, un apologue sur le mal angélique, bien avant la naissance d’Adam, d’Eve : Le Premier meurtre[15], qui n’est pas celui de Caïn. Ecrit sous la forme d’une pièce radiophonique, d’abord intitulée Murder mysteries, le récit est au ciel, raconté par une sorte de sans domicile fixe qui prétend être un ange déchu. Car les anges aux ailes immenses peuvent être amants, jaloux, voire meurtriers. Il y aurait donc au royaume de Dieu, une naissance du mal[16], une essentialité du mal, trop humaine, et cependant livresque…
Thierry Guinhut
La partie sur Ferrara a été publiée dans Le Matricule des anges, février 2021
[1] Tous les savoirs du monde, Bibliothèque Nationale de France, Flammarion, 1996, p 40.
[2] Silvia Ferrara : Avant l’écriture, Seuil, 2023.
[3] Luigi Serafini : Codex seraphinianus, Rizzoli, 2013.
[4] Gershom Scholem : Le Nom de dieu et la théorie kabbalistique du langage, Allia, 2018.
[6] Voir : De l'incendie des livres et des bibliothèques
[7] Lieux de savoir I & II, Albin Michel, 2007 & 2011.
[9] Ray Bradbury : Fahrenheit 451, Folio, 2000.
[10] Louis-Sébastien Mercier : L’An 2440, France Adel, 1977.
[11] Neil Gaiman : Le Dogue noir, Au Diable vauvert, 2018.
[15] Neil Gaiman & P. Craig Russell : Le Premier meurtre, Delcourt, 2016.
Apocalipsis figurado de los duques de Saboya, siglo XV,
Monasterio Real San Lorenzo de El Escorial, Madrid.
Photo T. Guinhut.

/image%2F1470571%2F20240224%2Fob_33a38f_escorial-biblioteca-apocalypse-2.JPG)


/image%2F1470571%2F20230518%2Fob_deeaa0_becerril-de-campos-livre-vert.JPG)
/image%2F1470571%2F20230518%2Fob_999631_asensio-judas.jpg)
/image%2F1470571%2F20230518%2Fob_82bbbf_asensio-temps-des-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20230518%2Fob_ebb410_le-armee.png)
/image%2F1470571%2F20230518%2Fob_376156_le-lettre.jpg)
/image%2F1470571%2F20230518%2Fob_f29008_dosse-verites.png)
/image%2F1470571%2F20230518%2Fob_bdcdfb_dosse-deleuze.jpg)
/image%2F1470571%2F20230604%2Fob_07b36b_tempsdulivre-scaled.jpg)
/image%2F1470571%2F20230604%2Fob_5f7e78_moura-totalite-litteraire.jpg)
/image%2F1470571%2F20230518%2Fob_5f233d_cuenca-livre-sculpte.JPG)
/image%2F1470571%2F20230805%2Fob_da91e0_hondarribia-achille.JPG)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_892ef9_fumaroli-bibliotheque.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_81ef69_fumaroli-sablier-tel.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_6329b1_fumaroli-querelle.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_9d8df8_fumaroli-republique.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_842cef_fumaroli-poete.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_28746f_fumaroli-grandeur.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4b4555_miller-peiresc-s.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_baf1a8_miller-peiresc-albin-michel.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_8a306e_telemaque.JPG)
/image%2F1470571%2F20230320%2Fob_ec05ba_bestiarium-chauve-souris.JPG)
/image%2F1470571%2F20230319%2Fob_08a680_tresors-enlumines-de-suisse-allemand.jpg)
/image%2F1470571%2F20230319%2Fob_3c2659_tresors-enlumines-de-suisse.jpg)

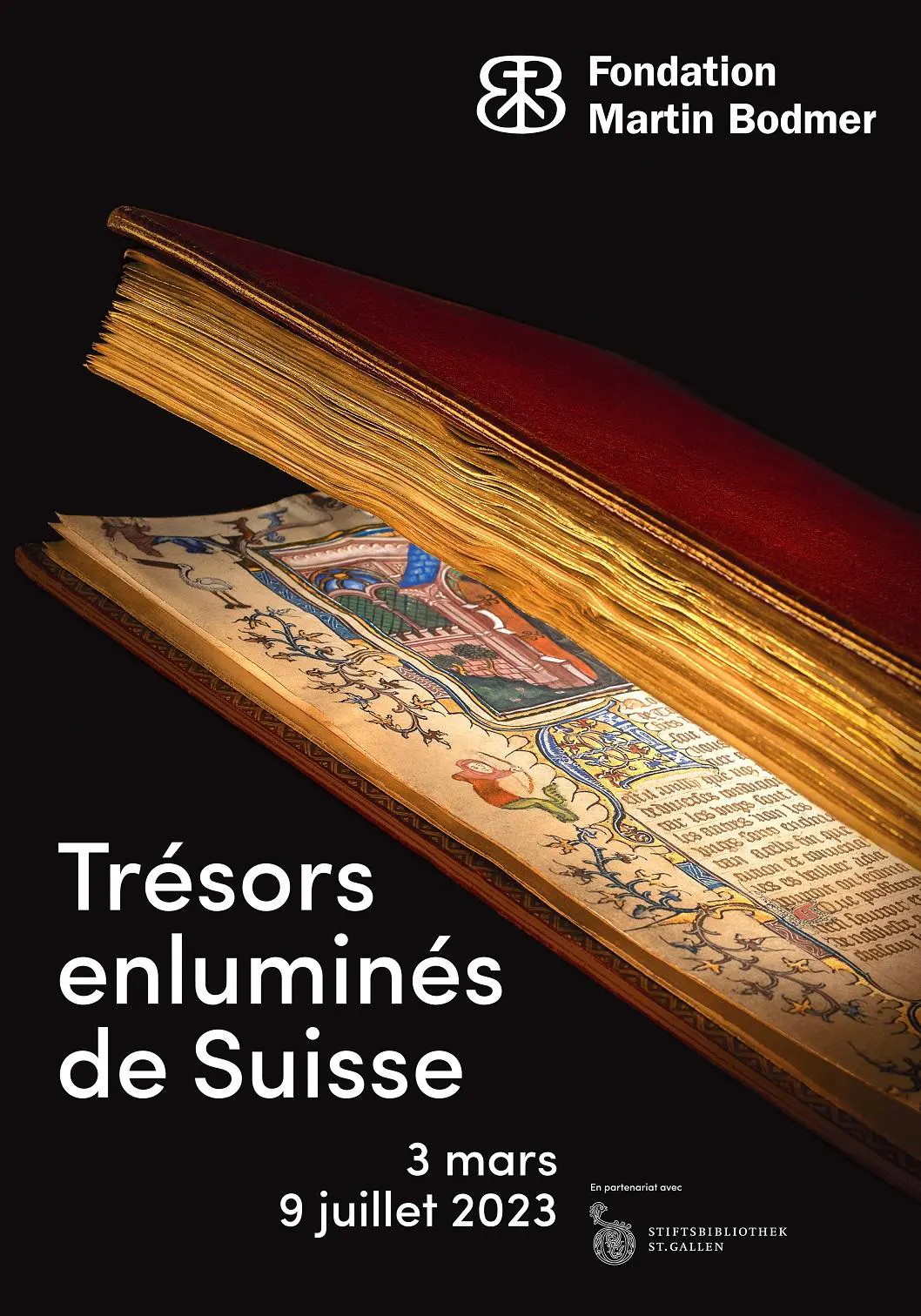


/image%2F1470571%2F20230321%2Fob_734ed4_listri-libraries-taschen.jpg)
/image%2F1470571%2F20230319%2Fob_c84ad5_bibliodysse-affiche-format-portrait-1.jpg)
/image%2F1470571%2F20230319%2Fob_a19a2c_bibliodyssees.jpg)
/image%2F1470571%2F20230805%2Fob_96c4e7_img-2916.JPG)
/image%2F1470571%2F20240301%2Fob_e9b4da_livres-en-feu.JPG)
/image%2F1470571%2F20210606%2Fob_724424_pierrat-censures-imec.jpg)
/image%2F1470571%2F20210606%2Fob_10f461_hancarville-neron.JPG)
/image%2F1470571%2F20210606%2Fob_ea0be8_pierrat-morales.jpg)
/image%2F1470571%2F20210606%2Fob_e1f35e_aboudrar-dessins-colere.jpg)
/image%2F1470571%2F20230320%2Fob_d83fb7_onfray-ventre.jpg)
/image%2F1470571%2F20230320%2Fob_89650f_onfray-autodafes.jpg)
/image%2F1470571%2F20211229%2Fob_680b12_autodafe-wiclef.JPG)
/image%2F1470571%2F20240425%2Fob_131d43_quintus-curtius-maroquin-rouge-aux-arm.JPG)
/image%2F1470571%2F20210729%2Fob_15b31e_geants-et-nains-bodmer-couverture.jpg)
/image%2F1470571%2F20210729%2Fob_08d223_bibliotheques-geants-et-nains.JPG)
/image%2F1470571%2F20210729%2Fob_29dbb5_delacroix-surrealistes.jpg)
/image%2F1470571%2F20210729%2Fob_9c719c_sandoz-dali.JPG)
/image%2F1470571%2F20240204%2Fob_6b7696_segovia-leer-es-sexy.JPG)
/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_0830fc_miles-tu-ne-desireras-pas.jpg)
/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_e9b203_kesey-bleu.jpg)
/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_a8c736_adams-watership.jpg)
/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_6d2a66_monsieur-toussaint-louverture.JPG)
/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_b48d24_gavelis-vilnius-poker-couverture-400x4.jpg)
/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_1128c0_kjaerstad-seducteur.jpg)
/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_09307f_ferris-monstres-chastly.jpeg)
/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_db32bd_monsieur-toussaint-louverture-dore.JPG)
/image%2F1470571%2F20240104%2Fob_9d040b_p-280-ammanite-tue-mouches.JPG)
/image%2F1470571%2F20201210%2Fob_025274_merlin-kajman-lire-gueule-du-loup.jpg)
/image%2F1470571%2F20201210%2Fob_b3ab66_marx-w-haine-litterature.jpg)
/image%2F1470571%2F20240104%2Fob_d09acc_velins-boussole.jpg)
/image%2F1470571%2F20201210%2Fob_1e697b_dericquebourg-deuil.jpg)
/image%2F1470571%2F20201210%2Fob_507235_liessmann-haine.jpg)
/image%2F1470571%2F20201204%2Fob_5122f3_loup-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240104%2Fob_fc6d85_masques-venitiens.JPG)
/image%2F1470571%2F20201027%2Fob_9bced6_masques-bodmer.jpg)
/image%2F1470571%2F20201027%2Fob_8f4916_masques-affiche.jpg)
/image%2F1470571%2F20201027%2Fob_a84b51_terence-comedies.JPG)
/image%2F1470571%2F20201027%2Fob_2be6f1_shakespeare-tempete-dulac.JPG)
/image%2F1470571%2F20201027%2Fob_f8f389_theatre-couleurs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240321%2Fob_3cb128_diane-de-selliers-livres.jpg)





/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)
/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)
/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)
/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)


/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)



/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)
/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)


/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)
/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)
/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)
/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)
/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)


/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)
/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)
/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)


/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)



/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)
/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)
/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)
/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)
/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)
/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)
/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)
/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)
/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)
/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)


/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)
/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)
/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)
/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)


/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)
/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)


/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)
/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)
/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)
/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)


/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)
/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)



/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)
/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)