Les livres publiés, romans, albums, essais :Une vie d'écriture et de photographie
Ackroyd
Londres la biographie, William, Trois frères
Queer-city, l'homosexualité à Londres
Adams
Essais sur le beau en photographie
Aira
Congrès de littérature et de magie
Ajvaz
Fantastique : L'Autre île, L'Autre ville
Akhmatova
Requiem pour Anna Akhmatova
Alberti
Momus le Prince, La Statue, Propos de table
Allemagne
Tellkamp : La Tour ; Seiler : Kruso
Les familles de Leo et Kaiser-Muhlecke r
Amis
Inside Story, Flèche du temps, Zone d'intérêt
Réussir L'Information Martin Amis
Lionel Asbo, Chien jaune, Guerre au cliché
Amour, sexualité
A une jeune Aphrodite de marbre
Borges : Poèmes d’amour
Guarnieri : Brahms et Clara Schumann
Vigolo : La Virgilia
Jean Claude Bologne historien de l'amour
Luc Ferry : De l'amour au XXI° siècle
Philosophie de l'amour : Ogien, Ackerman
Le lit de la poésie érotique
Erotisme, pornographie : Pauvert, Roszak, Lestrade
Une Histoire des sexualités ; Foucault : Les Aveux de la chair
Ampuero
Cuba quand nous étions révolutionnaires
Animaux
Elien Ursin : Personnalité et Prosopopée des animaux
Rencontre avec des animaux extraordinaires
Quand les chauve-souris chantent, les animaux ont-ils des droits ?
Jusqu'où faut-il respecter les animaux ? Animalisme et humanisme
L'incroyable bestiaire de l'émerveillement
Philosophie porcine du harcèlement
Philosophie animale, bestioles, musicanimales
Chats littéraires et philosophie féline
Apologues politiques, satiriques et familiers
Meshkov : Chien Lodok, l'humaine tyrannie
Le corbeau de Max Porter
Antiquité
Le sens de la mythologie et des Enfers
Métamorphoses d'Ovide et mythes grecs
Eloge des déesses grecques et de Vénus
Belles lettres grecques d'Homère à Lucien
Anthologies littéraires gréco-romaines
Imperator, Arma, Nuits antiques, Ex machina
Histoire auguste et historiens païens
Rome et l'effondrement de l'empire
Esthétique des ruines : Schnapp, Koudelka
De César à Fellini par la poésie latine
Les Amazones par Mayor et Testart
Le Pogge et Lucrèce par Greenblatt
Des romans grecs et latins
Antisémitisme
Histoire et rhétorique de l'antisémitisme
De Mein Kampf à la chambre à gaz
Céline et les pamphlets antisémites
Wagner, Tristan und Isolde et antisémitisme
Kertesz : Sauvegarde
Eloge d'Israël
Appelfeld
Les Partisans, Histoire d'une vie
Arbres
Leur vie, leur plaidoirie : Wohlleben, Stone
Richard Powers : L'Arbre-monde
Arendt
Banalité du mal, banalité de la culture
Liberté d'être libre et Cahier de L'Herne
Conscience morale, littérature, Benjamin
Anders : Molussie et Obsolescence
Argent
Veau d'or ou sagesse de l'argent : Aristote, Simmel, Friedman, Bruckner
Aristote
Aristote, père de la philosophie
Rire de tout ? D’Aristote à San-Antonio
Art contemporain
Que restera-t-il de l’art contemporain ?
L'art contemporain est-il encore de l'art ?
Décadence ou effervescence de la peinture
L'image de l'artiste de l'Antiquité à l'art conceptuel
Faillite et universalité de la beauté
Michel Guérin : Le Temps de l'art
Théories du portrait depuis la Renaissance
L'art brut, exclusion et couronnement
Hans Belting : Faces
Piss Christ, icone chrétienne par Serrano
Attar
Le Cantique des oiseaux
Atwood
De la Servante écarlate à Consilience
Contes réalistes et gothiques d'Alphinland
Graine de sorcière, réécriture de La Tempête
Bachmann
Celan Bachmann : Lettres amoureuses
Toute personne qui tombe a des ailes, poèmes
Bakounine
Serions-nous plus libres sans l'Etat ?
L'anarchisme : tyrannie ou liberté ?
Ballard
Le romancier philosophe de Crash et Millenium people
Nouvelles : un artiste de la science-fiction
Bande dessinée, Manga
Roman graphique et bande-dessinée
Mangas horrifiques et dystopiques
Barcelo
Cahiers d'Himalaya, Nuit sur le mont chauve
Barrett Browning
E. Barrett Browning et autres sonnettistes
Bashô
Bashô : L'intégrale des haikus
Basile
Le conte des contes, merveilleux rabelaisien
Bastiat
Le libéralisme contre l'illusion de l'Etat
Baudelaire
Baudelaire, charogne ou esthète moderne ?
"L'homme et la mer", romantisme noir
Vanité et génie du dandysme
Baudelaire de Walter Benjamin
Poésie en vers et poésie en prose
Beauté, laideur
Faillite et universalité de la beauté, de l'Antiquité à notre contemporain, essai, La Mouette de Minerve éditeur
Art et bauté, de Platon à l’art contemporain
Laideur et mocheté
Peintures et paysages sublimes
Beckett
En attendant Godot : le dénouement
Benjamin
Baudelaire par Walter Benjamin
Conscience morale et littérature
Critique de la violence et vices politiques
Flâneurs et voyageurs
Walter Benjamin : les soixante-treize sonnets
Paris capitale des chiffonniers du XIX°siècle
Benni
Toutes les richesses, Grammaire de Dieu
Bernhard
Goethe se mheurt et autres vérités
Bibliothèques
Histoire de l'écriture & Histoire du livre
Bibliophilie : Nodier, Eco, Apollinaire
Eloges des librairies, libraires et lecteurs
Babel des routes de la traduction
Des jardins & des livres, Fondation Bodmer
De l'incendie des livres et des bibliothèques
Bibliothèques pillées sous l'Occupation
Bibliothèques vaticane et militaires
Masques et théâtre en éditions rares
De Saint-Jérôme au contemporain
Haine de la littérature et de la culture
Rabie : La Bibliothèque enchantée
Bibliothèques du monde, or des manuscrits
Du papyrus à Google-books : Darnton, Eco
Bibliothèques perdues et fictionnelles
Livres perdus : Straten, Schlanger, Olender
Bibliophilie rare : Géants et nains
Manguel ; Uniques fondation Bodmer
Blake
Chesterton, Jordis : William Blake ou l’infini
Le Mariage du ciel et de l’enfer
Blasphème
Eloge du blasphème : Thomas-d'Aquin, Rushdie, Cabantous, Beccaria
Blog, critique
Du Blog comme œuvre d’art
Pour une éthique de la critique littéraire
Du temps des livres aux vérités du roman
Bloom
Amour, amitié et culture générale
Bloy
Le désespéré enlumineur de haines
Bolaño
L’artiste et le mal : 2666, Nocturne du Chili
Les parenthèses du chien romantique
Poète métaphysique et romancier politique
Bonnefoy
La poésie du legs : Ensemble encore
Borel
Pétrus Borel lycanthrope du romantisme noir
Borges
Un Borges idéal, équivalent de l'univers
Géographies des bibliothèques enchantées
Poèmes d’amour, une anthologie
Brague
Légitimité de l'humanisme et de l'Histoire
Eloge paradoxal du christianisme, sur l'islam
Brésil
Poésie, arts primitifs et populaires du Brésil
Bruckner
La Sagesse de l'argent
Pour l'annulation de la Cancel-culture
Brume et brouillard
Science, littérature et art du brouillard
Burgess
Folle semence de L'Orange mécanique
Burnside
De la maison muette à l'Eté des noyés
Butor
Butor poète et imagier du Temps qui court
Butor Barcelo : Une nuit sur le mont chauve
Cabré
Confiteor : devant le mystère du mal
Canetti
La Langue sauvée de l'autobiographie
Capek
La Guerre totalitaire des salamandres
Capitalisme
Eloge des péchés capitaux du capitalisme
De l'argument spécieux des inégalités
La sagesse de l'argent : Pascal Bruckner
Vers le paradis fiscal français ?
Carrion
Les orphelins du futur post-nucléaire
Eloges des librairies et des libraires
Cartarescu
La trilogie roumaine d'Orbitor, Solénoïde ; Manea : La Tanière
Cartographie
Atlas des mondes réels et imaginaires
Casanova
Icosameron et Histoire de ma vie
Catton
La Répétition, Les Luminaires
Cavazzoni
Les Géants imbéciles et autres Idiots
Celan
Paul Celan minotaure de la poésie
Celan et Bachmann : Lettres amoureuses
Céline
Voyage au bout des pamphlets antisémites
Guerre : l'expressionnisme vainqueur
Céline et Proust, la recherche du voyage
Censure et autodafé
Requiem pour la liberté d’expression : entre Milton et Darnton, Charlie et Zemmour
Livres censurés et colères morales
Incendie des livres et des bibliothèques : Polastron, Baez, Steiner, Canetti, Bradbury
T otalitarisme et Renseignement
Pour l'annulation de la cancel culture
Cervantès
Don Quichotte peint par Gérard Garouste
Don Quichotte par Pietro Citati et Avellaneda
Cheng
Francois Cheng, Longue route et poésie
Chesterton
William Blake ou l'infini
Le fantaisiste du roman policier catholique
Chevalier
La Dernière fugitive, À l'orée du verger
Le Nouveau, rééecriture d'Othello
Chine
Chen Ming : Les Nuages noirs de Mao
Du Gène du garde rouge aux Confessions d'un traître à la patrie
Anthologie de la poésie chinoise en Pléiade
Civilisation
Petit précis de civilisations comparées
Identité, assimilation : Finkielkraut, Tribalat
Climat
Histoire du climat et idéologie écologiste
Tyrannie écologiste et suicide économique
Coe
Peines politiques anglaises perdues
Colonialisme
De Bartolomé de Las Casas à Jules Verne
Métamorphoses du colonialisme
Mario Vargas Llosa : Le rêve du Celte
Histoire amérindienne
Communisme
"Hommage à la culture communiste"
Karl Marx théoricien du totalitarisme
Lénine et Staline exécuteurs du totalitarisme
Constant Benjamin
Libertés politiques et romantiques
Corbin
Fraicheur de l'herbe et de la pluie
Histoire du silence et des odeurs
Histoire du repos, lenteur, loisir, paresse
Cosmos
Cosmos de littérature, de science, d'art et de philosophie
CouleursCouleurs de l'Occident : Fischer, Alberti
Couleurs, cochenille, rayures : Pastoureau
Nuanciers de la rose et du rose
Profondeurs, lumières du noir et du blanc
Couleurs des monstres politiques
Crime et délinquance
Jonas T. Bengtsson et Jack Black
Cronenberg
Science-fiction biotechnologique : de Consumés à Existenz
Dandysme
Brummell, Barbey d'Aurevilly, Baudelaire
Danielewski
La Maison des feuilles, labyrinthe psychique
Dante
Traduire et vivre La Divine comédie
Enfer et Purgatoire de la traduction idéale
De la Vita nuova à la sagesse du Banquet
Manguel : la curiosité dantesque
Daoud
Meursault contre-enquête, Zabor
Le Peintre dévorant la femme
Darger
Les Fillettes-papillons de l'art brut
Darnton
Requiem pour la liberté d’expression
Destins du livre et des bibliothèques
Un Tour de France littéraire au XVIII°
Daumal
Mont analogue et esprit de l'alpinisme
Defoe
Robinson Crusoé et romans picaresques
De Luca
Impossible, La Nature exposée
Démocratie
Démocratie libérale versus constructivisme
De l'humiliation électorale
Derrida
Faut-il pardonner Derrida ?
Bestiaire de Derrida et Musicanimale
Déconstruire Derrida et les arts du visible
Descola
Anthropologie des mondes et du visible
Dick
Philip K. Dick : Nouvelles et science-fiction
Hitlérienne uchronie par Philip K. Dick
Dickinson
Devrais-je être amoureux d’Emily Dickinson ?
Emily Dickinson de Diane de Selliers à Charyn
Dillard
Eloge de la nature : Une enfance américaine, Pèlerinage à Tinker Creek
Diogène
Chien cynique et animaux philosophiques
Dostoïevski
Dostoïevski par le biographe Joseph Frank
Eco
Umberto Eco, surhomme des bibliothèques
Construire l’ennemi et autres embryons
Numéro zéro, pamphlet des médias
Société liquide et questions morales
Baudolino ou les merveilles du Moyen Âge
Eco, Darnton : Du livre à Google Books
Ecologie, Ecologismes
Greenbomber, écoterroriste
Archéologie de l’écologie politique
Monstrum oecologicum, éolien et nucléaire
Ravages de l'obscurantisme vert
Wohlleben, Stone : La Vie secrète des arbres, peuvent-il plaider ?
Naomi Klein : anticapitalisme et climat
Biophilia : Wilson, Bartram, Sjöberg
John Muir, Nam Shepherd, Bernd Heinrich
Emerson : Travaux ; Lane : Vie dans les bois
Révolutions vertes et libérales : Manier
Kervasdoué : Ils ont perdu la raison
Powers écoromancier de L'Arbre-monde
Ernest Callenbach : Ecotopia
Editeurs
Eloge de L'Atelier contemporain
Diane de Selliers : Dit du Genji, Shakespear e
Monsieur Toussaint Louverture
Mnémos ou la mémoire du futur
Education
Pour une éducation libérale
Allan Bloom : Déclin de la culture générale
Déséducation et rééducation idéologique
Haine de la littérature et de la culture
De l'avenir des Anciens
Eluard
« Courage », l'engagement en question
Emerson
Les Travaux et les jours de l'écologisme
Enfers
L'Enfer, mythologie des lieux
Enfers d'Asie, Pu Songling, Hearn
Erasme
Erasme, Manuzio : Adages et humanisme
Eloge de vos folies contemporaines
Esclavage
Esclavage en Moyen âge, Islam, Amériques
Espagne
Histoire romanesque du franquisme
Benito Pérez Galdos, romancier espagnol
Etat
Serions-nous plus libres sans l'Etat ?
Constructivisme versus démocratie libérale
Amendements libéraux à la Constitution
Couleurs des monstres politiques
Française tyrannie, actualité de Tocqueville
Socialisme et connaissance inutile
Patriotisme et patriotisme économique
La pandémie des postures idéologiques
Agonie scientifique et sophisme français
Impéritie de l'Etat, atteinte aux libertés
Retraite communiste ou raisonnée
Etats-Unis romans
Dérives post-américaines
Rana Dasgupta : Solo, destin américain
Bret Easton Ellis : Eclats, American psycho
Eugenides : Middlesex, Roman du mariage
Bernardine Evaristo : Fille, femme, autre
La Muse de Jonathan Galassi
Gardner : La Symphonie des spectres
Lauren Groff : Les Furies
Hallberg, Franzen : City on fire, Freedom
Jonathan Lethem : Chronic-city
Luiselli : Les Dents, Archives des enfants
Rick Moody Démonologies
De la Pava, Marissa Pessl : les agents du mal
Penn Warren : Grande forêt, Hommes du roi
Shteyngart : Super triste histoire d'amour
Tartt : Chardonneret, Maître des illusions
Wright, Ellison, Baldwin, Scott-Heron
Europe
Du mythe européen aux Lettres européennes
Fables politiques
Le bouffon interdit, L'animal mariage, 2025 l'animale utopie, L'ânesse et la sangsue
Les chats menacés par la religion des rats, L'Etat-providence à l'assaut des lions, De l'alternance en Démocratie animale, Des porcs et de la dette
Fabre
Jean-Henri Fabre, prince de l'entomologie
Facebook
Facebook, IPhone : tyrannie ou libertés ?
Fallada
Seul dans Berlin : résistance antinazie
Fantastique
Dracula et autres vampires
Lectures du mythe de Frankenstein
Montgomery Bird : Sheppard Lee
Karlsson : La Pièce ; Jääskeläinen : Lumikko
Michal Ajvaz : de l'Autre île à l'Autre ville
Morselli Dissipatio, Longo L'Homme vertical
Présences & absences fantastiques : Karlsson, Pépin, Trias de Bes, Epsmark, Beydoun
Fascisme
Histoire du fascisme et de Mussolini
De Mein Kampf à la chambre à gaz
Haushofer : Sonnets de Moabit
Femmes
Lettre à une jeune femme politique
Humanisme et civilisation devant le viol
Harcèlement et séduction
Les Amazones par Mayor et Testart
Christine de Pizan, féministe du Moyen Âge
Naomi Alderman : Le Pouvoir
Histoire des féminités littéraires
Rachilde et la revanche des autrices
La révolution du féminin
Jalons du féminisme : Bonnet, Fraisse, Gay
Camille Froidevaux-Metterie : Seins
Herland, Egalie : républiques des femmes
Bernardine Evaristo, Imbolo Mbue
Ferré
Providence du lecteur, Karnaval capitaliste ?
Ferry
Mythologie et philosophie
Transhumanisme, intelligence artificielle, robotique
De l’Amour ; philosophie pour le XXI° siècle
Finkielkraut
L'Après littérature
L’identité malheureuse
Flanagan
Livre de Gould et Histoire de la Tasmanie
Foster Wallace
L'Infinie comédie : esbroufe ou génie ?
Foucault
Pouvoirs et libertés de Foucault en Pléiade
Maîtres de vérité, Question anthropologique
Herculine Barbin : hermaphrodite et genre
Les Aveux de la chair
Destin des prisons et angélisme pénal
Fragoso
Le Tigre de la pédophilie
France
Identité française et immigration
Eloge, blâme : Histoire mondiale de la France
Identité, assimilation : Finkielkraut, Tribalat
Antilibéralisme : Darien, Macron, Gauchet
La France de Sloterdijk et Tardif-Perroux
France Littérature contemporaine
Blas de Roblès de Nemo à l'ethnologie
Briet : Fixer le ciel au mur
Haddad : Le Peintre d’éventail
Haddad : Nouvelles du jour et de la nuit
Jourde : Festins Secrets
Littell : Les Bienveillantes
Louis-Combet : Bethsabée, Rembrandt
Nadaud : Des montagnes et des dieux
Le roman des cinéastes. Ohl : Redrum
Eric Poindron : Bal de fantômes
Reinhardt : Le Système Victoria
Sollers : Vie divine et Guerre du goût
Villemain : Ils marchent le regard fier
Fuentes
La Volonté et la fortune
Crescendo du temps et amour faustien : Anniversaire, L'Instinct d'Inez
Diane chasseresse et Bonheur des familles
Le Siège de l’aigle politique
Fumaroli
De la République des lettres et de Peiresc
Gaddis
William Gaddis, un géant sibyllin
Gamboa
Maison politique, un roman baroque
Garouste
Don Quichotte, Vraiment peindre
Gass
Au bout du tunnel : Sonate cartésienne
Gavelis
Vilnius poker, conscience balte
Genèse
Adam et Eve, mythe et historicité
La Genèse illustrée par l'abstraction
GilgameshL'épopée originelle et sa photographie
Gibson
Neuromancien, Identification des schémas
Girard
René Girard, Conversion de l'art, violence
Goethe
Chemins de Goethe avec Pietro Citati
Goethe et la France, Fondation Bodmer
Thomas Bernhard : Goethe se mheurt
Arno Schmidt : Goethe et un admirateur
Gothiques
Frankenstein et autres romans gothiques
Golovkina
Les Vaincus de la terreur communiste
Goytisolo
Un dissident espagnol
Gracian
L’homme de cour, Traités politiques
Gracq
Les Terres du couchant, conte philosophique
Grandes
Le franquisme du Cœur glacé
Greenblatt
Shakespeare : Will le magnifique
Le Pogge et Lucrèce au Quattrocento
Adam et Eve, mythe et historicité
Guerre et violence
John Keegan : Histoire de la guerre
Storia della guerra di John Keegan
Guerre et paix à la Fondation Martin Bodmer
Violence, biblique, romaine et Terreur
Violence et vices politiques
Battle royale, cruelle téléréalité
Honni soit qui Syrie pense
Emeutes et violences urbaines
Mortel fait divers et paravent idéologique
Violences policières et antipolicières
Stefan Brijs : Courrier des tranchées
Guinhut
Une vie d'écriture et de photographie
Guinhut Muses Academy
Muses Academy, roman : synopsis, Prologue
I L'ouverture des portes
II Récit de l'Architecte : Uranos ou l'Orgueil
Première soirée : dialogue et jury des Muses
V Récit de la danseuse Terpsichore
IX Récit du cinéaste : L’ecpyrose de l’Envie
XI Récit de la Musicienne : La Gourmandise
XIII Récit d'Erato : la peintresse assassine
XVII Polymnie ou la tyrannie politique
XIX Calliope jeuvidéaste : Civilisation et Barbarie
Guinhut
Philosophie politique
Guinhut
Faillite et universalité de la beauté, de l'Antiquité à notre contemporain, essai
Guinhut
Au Coeur des Pyrénées
Guinhut
Pyrénées entre Aneto et Canigou
Guinhut
Haut-Languedoc
Guinhut
Montagne Noire : Journal de marche
Guinhut Triptyques
Le carnet des Triptyques géographiques
Guinhut Le Recours aux Monts du Cantal
Traversées. Le recours à la montagne
Guinhut
Le Marais poitevin
Guinhut La République des rêves
La République des rêves, roman
I Une route des vins de Blaye au Médoc
II La Conscience de Bordeaux
II Le Faust de Bordeaux
III Bironpolis. Incipit
III Bironpolis. Les nuages de Titien
IV Eros à Sauvages : Les belles inconnues
IV Eros : Mélissa et les sciences politiques
VII Le Testament de Job
VIII De natura rerum. Incipit
VIII De natura rerum. Euro Urba
VIII De natura rerum. Montée vers l’Empyrée
VIII De natura rerum excipit
Guinhut Les Métamorphoses de Vivant
I Synopsis, sommaire et prologue
II Arielle Hawks prêtresse des médias
III La Princesse de Monthluc-Parme
IV Francastel, frontnationaliste
V Greenbomber, écoterroriste
VI Lou-Hyde Motion, Jésus-Bouddha-Star
VII Démona Virago, cruella du-postféminisme
Guinhut Voyages en archipel
I De par Marie à Bologne descendu
IX De New-York à Pacifica
Guinhut Sonnets
À une jeune Aphrodite de marbre
Sonnets des paysages
Sonnets de l'Art poétique
Sonnets autobiographiques
Des peintres : Crivelli, Titien, Rothko, Tàpies, Twombly
Trois requiem : Selma, Mandelstam, Malala
Guinhut Trois vies dans la vie d'Heinz M
I Une année sabbatique
II Hölderlin à Tübingen
III Elégies à Liesel
Guinhut Le Passage des sierras
Un Etat libre en Pyrénées
Le Passage du Haut-Aragon
Vihuet, une disparition
Guinhut
Ré une île en paradis
Guinhut
Photographie
Guinhut La Bibliothèque du meurtrier
Synospsis, sommaire et Prologue
I L'Artiste en-maigreur
II Enquête et pièges au labyrinthe
III L'Ecrivain voleur de vies
IV La Salle Maladeta
V Les Neiges du philosophe
VI Le Club des tee-shirts politiques
XIII Le Clone du Couloirdelavie.com.
Haddad
La Sirène d'Isé
Le Peintre d’éventail, Les Haïkus
Corps désirable, Nouvelles de jour et nuit
Haine
Du procès contre la haine
Hamsun
Faim romantique et passion nazie
Haushofer
Albrecht Haushofer : Sonnets de Moabit
Marlen Haushofer : Mur invisible, Mansarde
Hayek
De l’humiliation électorale
Serions-nous plus libres sans l'Etat ?
Tempérament et rationalisme politique
Front Socialiste National et antilibéralisme
Histoire
Histoire du monde en trois tours de Babel
Eloge, blâme : Histoire mondiale de la France
Statues de l'Histoire et mémoire
De Mein Kampf à la chambre à gaz
Rome du libéralisme au socialisme
Destruction des Indes : Las Casas, Verne
Jean Claude Bologne historien de l'amour
Jean Claude Bologne : Histoire du scandale
Histoire du vin et culture alimentaire
Corbin, Vigarello : Histoire du corps
Berlin, du nazisme au communisme
De Mahomet au Coran, de la traite arabo-musulmane au mythe al-Andalus
L'Islam parmi le destin français
Hobbes
Emeutes urbaines : entre naïveté et guerre
Serions-nous plus libres sans l'Etat ?
Hoffmann
Le fantastique d'Hoffmann à Ewers
Hölderlin
Trois vies d'Heinz M. II Hölderlin à Tübingen
Homère
Dan Simmons : Ilium science-fictionnel
Homosexualité
Pasolini : Sonnets du manque amoureux
Libertés libérales : Homosexualité, drogues, prostitution, immigration
Garcia Lorca : homosexualité et création
Houellebecq
Extension du domaine de la soumission
Humanisme
Erasme et Aldo Manuzio
Etat et utopie de Thomas More
Le Pogge : Facéties et satires morales
Le Pogge et Lucrèce au Quattrocento
De la République des Lettres et de Peiresc
Eloge de Pétrarque humaniste et poète
Pic de la Mirandole : 900 conclusions
Hustvedt
Vivre, penser, regarder. Eté sans les hommes
Le Monde flamboyant d’une femme-artiste
Huxley
Du meilleur des mondes aux Temps futurs
Ilis
Croisade des enfants, Vies parallèles, Livre des nombres
Impôt
Vers le paradis fiscal français ?
Sloterdijk : fiscocratie, repenser l’impôt
La dette grecque, tonneau des Danaïdes
Inde
Coffret Inde, Bhagavad-gita, Nagarjuna
Les hijras d'Arundhati Roy et Anosh Irani
Inégalités
L'argument spécieux des inégalités : Rousseau, Marx, Piketty, Jouvenel, Hayek
Islam
Lettre à une jeune femme politique
Du fanatisme morbide islamiste
Dictatures arabes et ottomanes
Islam et Russie : choisir ses ennemis
Humanisme et civilisation devant le viol
Arbre du terrorisme, forêt d'Islam : dénis
Arbre du terrorisme, forêt d'Islam : défis
Sommes-nous islamophobes ?
Islamologie I Mahomet, Coran, al-Andalus
Islamologie II arabe et Islam en France
Claude Lévi-Strauss juge de l’Islam
Pourquoi nous ne sommes pas religieux
Vérité d’islam et vérités libérales
Identité, assimilation : Finkielkraut, Tribalat
Averroès et al-Ghazali
Israël
Une épine démocratique parmi l’Islam
Résistance biblique Appelfeld Les Partisans
Amos Oz : un Judas anti-fanatique
Jaccottet
Philippe Jaccottet : Madrigaux & Clarté
James
Voyages et nouvelles d'Henry James
Jankélévitch
Jankélévitch, conscience et pardon
L'enchantement musical
Japon
Bashô : L’intégrale des haïkus
Kamo no Chômei, cabane de moine et éveil
Kawabata : Pissenlits et Mont Fuji
Kiyoko Murata, Julie Otsuka : Fille de joie
Battle royale : téléréalité politique
Haruki Murakami : Le Commandeur, Kafka
Murakami Ryû : 1969, Les Bébés
Mieko Kawakami : Nuits, amants, Seins, œufs
Ôé Kenzaburô : Adieu mon livre !
Ogawa Yoko : Cristallisation secrète
Ogawa Yoko : Le Petit joueur d’échecs
À l'ombre de Tanizaki
101 poèmes du Japon d'aujourd'hui
Rires du Japon et bestiaire de Kyosai
Jünger
Carnets de guerre, tempêtes du siècle
Kafka
Justice au Procès : Kafka et Welles
L'intégrale des Journaux, Récits et Romans
Kant
Grandeurs et descendances des Lumières
Qu’est-ce que l’obscurantisme socialiste ?
Karinthy
Farémido, Epépé, ou les pays du langage
Kawabata
Pissenlits, Premières neiges sur le Mont Fuji
Kehlmann
Tyll Ulespiegle, Les Arpenteurs du mond e
Kertész
Kertész : Sauvegarde contre l'antisémitisme
Kjaerstad
Le Séducteur, Le Conquérant, Aléa
Knausgaard
Autobiographies scandinaves
Kosztolanyi
Portraits, Kornél Esti
Krazsnahorkaï
La Venue d'Isaie ; Guerre & Guerre
Le retour de Seiobo et du baron Wenckheim
La Fontaine
Des Fables enfantines et politiques
Guinhut : Fables politiques
Lagerlöf
Le voyage de Nils Holgersson
Lainez
Lainez : Bomarzo ; Fresan : Melville
Lamartine
Le lac, élégie romantique
Lampedusa
Le Professeur et la sirène
Langage
Euphémisme et cliché euphorisant, novlangue politique
Langage politique et informatique
Langue de porc et langue inclusive
Vulgarité langagière et règne du langage
L'arabe dans la langue française
George Steiner, tragédie et réelles présences
Vocabulaire européen des philosophies
Ben Marcus : L'Alphabet de flammes
Larsen
L’Extravagant voyage de T.S. Spivet
Legayet
Satire de la cause animale et botanique
Leopardi
Génie littéraire et Zibaldone par Citati
Lévi-Strauss
Claude Lévi-Strauss juge de l’Islam
Libertés, Libéralisme
Pourquoi je suis libéral
Pour une éducation libérale
Du concept de liberté aux Penseurs libéraux
Lettre à une jeune femme politique
Le libre arbitre devant le bien et le mal
Requiem pour la liberté d’expression
Qui est John Galt ? Ayn Rand : La Grève
Ayn Rand : Atlas shrugged, la grève libérale
Mario Vargas Llosa, romancier des libertés
Homosexualité, drogues, prostitution
Serions-nous plus libres sans l'Etat ?
Tempérament et rationalisme politique
Front Socialiste National et antilibéralisme
Rome du libéralisme au socialisme
Lins
Osman Lins : Avalovara, carré magique
Littell
Les Bienveillantes, mythe et histoire
Lorca
La Colombe de Federico Garcia Lorca
Lovecraft
Depuis l'abîme du temps : l'appel de Cthulhu
Lovecraft, Je suis Providence par S.T. joshi
Lugones
Fantastique, anticipation, Forces étranges
Lumières
Grandeurs et descendances des Lumières
D'Holbach : La Théologie portative
Tolérer Voltaire et non le fanatisme
Machiavel
Actualités de Machiavel : Le Prince
Magris
Secrets et Enquête sur une guerre classée
Makouchinski
Un bateau pour l'Argentine
Mal
Hannah Arendt : De la banalité du mal
De l’origine et de la rédemption du mal : théologie, neurologie et politique
Le libre arbitre devant le bien et le mal
Christianophobie et désir de barbarie
Cabré Confiteor, Menéndez Salmon Medusa
Roberto Bolano : 2666, Nocturne du Chili
Maladie, peste
Maladie et métaphore : Wagner, Maï, Zorn
Pandémies historiques et idéologiques
Pandémies littéraires : M Shelley, J London, G R. Stewart, C McCarthy
Mandelstam
Poésie à Voronej et Oeuvres complètes
Trois requiem, sonnets
Manguel
Le cheminement dantesque de la curiosité
Le Retour et Nouvel éloge de la folie
Voyage en utopies
Lectures du mythe de Frankenstein
Je remballe ma bibliothèque
Du mythe européen aux Lettres européennes
Mann Thomas
Thomas Mann magicien faustien du roman
Marcher
De L’Art de marcher
Flâneurs et voyageurs
Le Passage des sierras
Le Recours aux Monts du Cantal
Trois vies d’Heinz M. I Une année sabbatique
Marcus
L’Alphabet de flammes, conte philosophique
Mari
Les Folles espérances, fresque italienne
Marino
Adonis, un grand poème baroque
Marivaux
Le Jeu de l'amour et du hasard
Martin Georges R.R.
Le Trône de fer, La Fleur de verre : fantasy, morale et philosophie politique
Martin Jean-Clet
Philosopher la science-fiction et le cinéma
Enfer de la philosophie et Coup de dés
Déconstruire Derrida
Marx
Karl Marx, théoricien du totalitarisme
« Hommage à la culture communiste »
De l’argument spécieux des inégalités
Mattéi
Petit précis de civilisations comparées
McEwan
Satire et dystopie : Une Machine comme moi, Sweet Touch, Solaire
Méditerranée
Histoire et visages de la Méditerranée
Mélancolie
Mélancolie de Burton à Földenyi
Melville
Billy Budd, Olivier Rey, Chritophe Averlan
Roberto Abbiati : Moby graphick
Mille et une nuits
Les Mille et une nuits de Salman Rushdie
Schéhérazade, Burton, Hanan el-Cheikh
Mitchell
Des Ecrits fantômes aux Mille automnes
Mode
Histoire et philosophie de la mode
Montesquieu
Eloge des arts, du luxe : Lettres persanes
Lumière de L'Esprit des lois
Moore
La Voix du feu, Jérusalem, V for vendetta
Morale
Notre virale tyrannie morale
More
Etat, utopie, justice sociale : More, Ogien
Morrison
Délivrances : du racisme à la rédemption
L'amour-propre de l'artiste
Moyen Âge
Rythmes et poésies au Moyen Âge
Umberto Eco : Baudolino
Christine de Pizan, poète feministe
Troubadours et érotisme médiéval
Le Goff, Hildegarde de Bingen
Mulisch
Siegfried, idylle noire, filiation d’Hitler
Murakami Haruki
Le meurtre du commandeur, Kafka
Les licornes de La Fin des temps
Musique
Musique savante contre musique populaire
Pour l'amour du piano et des compositrices
Les Amours de Brahms et Clara Schumann
Mizubayashi : Suite, Recondo : Grandfeu
Jankélévitch : L'Enchantement musical
Lady Gaga versus Mozart La Reine de la nuit
Lou Reed : chansons ou poésie ?
Schubert : Voyage d'hiver par Ian Bostridge
Grozni : Chopin contre le communisme
Wagner : Tristan und Isold et l'antisémitisme
Mythes
La Genèse illustrée par l'abstraction
Frankenstein par Manguel et Morvan
Frankenstein et autres romans gothiques
Dracula et autres vampires
Testart : L'Amazone et la cuisinière
Métamorphoses d'Ovide
Luc Ferry : Mythologie et philosophie
L’Enfer, mythologie des lieux, Hugo Lacroix
Nabokov
La Vénitienne et autres nouvelles
De l'identification romanesque
Nadas
Mémoire et Mélancolie des sirènes
La Bible, Almanach
Nadaud
Des montagnes et des dieux, deux fictions
Naipaul
Masque de l’Afrique, Semences magiques
Nietzsche
Bonheurs, trahisons : Dictionnaire Nietzsche
Romantisme et philosophie politique
Nietzsche poète et philosophe controversé
Les foudres de Nietzsche sont en Pléiade
Jean-Clet Martin : Enfer de la philosophie
Violences policières et antipolicières
Nooteboom
L’écrivain au parfum de la mort
Norddahl
SurVeillance, holocauste, hermaphrodisme
Oates
Le Sacrifice, Mysterieux Monsieur Kidder
Ôé Kenzaburo
Ôé, le Cassandre nucléaire du Japon
Ogawa
Cristallisation secrète du totalitarisme
Au Musée du silence : Le Petit joueur d’échecs, La jeune fille à l'ouvrage
Onfray
Faut-il penser Michel Onfray ?
Censures et Autodafés
Cosmos
Oppen
Oppen, objectivisme et Format américain
Orphée
Fonctions de la poésie, pouvoirs d'Orphée
Orwell
L'orwellisation sociétale
Cher Big Brother, Prism américain, français
Euphémisme, cliché euphorisant, novlangue
Contrôles financiers ou contrôles étatiques ?
Ovide
Métamorphoses et mythes grecs
Palahniuk
Le réalisme sale : Peste, L'Estomac, Orgasme
Palol
Le Jardin des Sept Crépuscules, Le Testament d'Alceste
Pamuk
Autobiographe d'Istanbul
Le musée de l’innocence, amour, mémoire
Panayotopoulos
Le Gène du doute, ou l'artiste génétique
Panofsky
Iconologie de la Renaissance
Paris
Les Chiffonniers de Paris au XIX°siècle
Pasolini
Sonnets des tourments amoureux
Pavic
Dictionnaire khazar, Boite à écriture
Peinture
Traverser la peinture : Arasse, Poindron
Le tableau comme relique, cri, toucher
Peintures et paysages sublimes
Sonnets des peintres : Crivelli, Titien, Rohtko, Tapiès, Twombly
Perec
Les Lieux de Georges Perec
Perrault
Des Contes pour les enfants ?
Pétrarque
Eloge de Pétrarque humaniste et poète
Du Canzoniere aux Triomphes
Petrosyan
La Maison dans laquelle
Philosophie
Mondialisations, féminisations philosophiques
Photographie
Photographie réaliste et platonicienne : Depardon, Meyerowitz, Adams
La photographie, biographème ou oeuvre d'art ? Benjamin, Barthes, Sontag
Ben Loulou des Sanguinaires à Jérusalem
Ewing : Le Corps, Love and desire
Picaresque
Smollett, Weerth : Vaurien et Chenapan
Pic de la Mirandole
Humanisme philosophique : 900 conclusions
Pierres
Musée de minéralogie, sexe des pierres
Pisan
Cent ballades, La Cité des dames
Platon
Faillite et universalité de la beauté
Poe
Edgar Allan Poe, ange du bizarre
Poésie
Anthologie de la poésie chinoise
À une jeune Aphrodite de marbre
Brésil, Anthologie XVI°- XX°
Chanter et enchanter en poésie
Emaz, Sacré : anti-lyrisme et maladresse
Fonctions de la poésie, pouvoirs d'Orphée
Histoire de la poésie du XX° siècle
Japon poétique d'aujourd'hui
Lyrisme : Riera, Voica, Viallebesset, Rateau
Marteau : Ecritures, sonnets
Oppen, Padgett, Objectivisme et lyrisme
Pizarnik, poèmes de sang et de silence
Poésie en vers, poésie en prose
Poésies verticales et résistances poétiques
Du romantisme à la Shoah
Anthologies et poésies féminines
Trois vies d'Heinz M, vers libres
Schlechter : Le Murmure du monde
Pogge
Facéties, satires morales et humanistes
Policier
Chesterton, prince de la nouvelle policière
Terry Hayes : Je suis Pilgrim ou le fanatisme
Les crimes de l'artiste : Pobi, Kellerman
Bjorn Larsson : Les Poètes morts
Populisme
Populisme, complotisme et doxa
PorterLa Douleur porte un masque de plumes
Portugal
Pessoa et la poésie lyrique portugaise
Tavares : un voyage en Inde et en vers
Pound
Ezra Pound, poète politique controversé par Mary de Rachewiltz et Pierre Rival
Powers
Générosité, Chambre aux échos, Sidérations
Orfeo, le Bach du bioterrorisme
L'éco-romancier de L'Arbre-monde
Pressburger
L’Obscur royaume, ou l’enfer du XX° siècle
Proust
Le baiser à Albertine : À l'ombre des jeunes filles en fleurs
Illustrations, lectures et biographies
Le Mystérieux correspondant, 75 feuillets
Céline et Proust, la recherche du voyage
Pynchon
Contre-jour, une quête de lumière
Fonds perdus du web profond & Vice caché
Vineland, une utopie postmoderne
Racisme
Racisme et antiracisme
Pour l'annulation de la Cancel culture
Ecrivains noirs : Wright, Ellison, Baldwin, Scott Heron, Anthologie noire
Rand
Qui est John Galt ? La Source vive, La Grève
Atlas shrugged et La grève libérale
Raspail
Sommes-nous islamophobes ?
Reed Lou
Chansons ou poésie ? L’intégrale
Religions et Christianisme
Pourquoi nous ne sommes pas religieux
Catholicisme versus polythéisme
Eloge du blasphème
De Jésus aux chrétiennes uchronies
Le Livre noir de la condition des Chrétiens
D'Holbach : Théologie portative et humour
De l'origine des dieux ou faire parler le ciel
Eloge paradoxal du christianisme
Renaissance
Renaissance historique et humaniste
Revel
Socialisme et connaissance inutile
Richter Jean-Paul
Le Titan du romantisme allemand
Rios
Nouveaux chapeaux pour Alice, Chez Ulysse
Rilke
Sonnets à Orphée, Poésies d'amour
Roman
Adam Thirlwell : Le Livre multiple
L'identification romanesque : Nabokov, Mann, Flaubert, Orwell...
Rome
Causes et leçons de la chute de Rome
Rome de César à Fellini
Romans grecs et latins
Ronsard
Sonnets pour Hélène LXVIII Commentaire
Rostand
Cyrano de Bergerac : amours au balcon
Roth Philip
Hitlérienne uchronie contre l'Amérique
Les Contrevies de la Bête qui meurt
Rousseau
Archéologie de l’écologie politique
De l'argument spécieux des inégalités
Rushdie
Joseph Anton, plaidoyer pour les libertés
Quichotte, Langages de vérité
Entre Averroès et Ghazali : Deux ans huit mois et vingt-huit nuits
Russell
De la fumisterie intellectuelle
Pourquoi nous ne sommes pas religieux
Russie
Islam, Russie, choisir ses ennemis
Golovkina : Les Vaincus ; Annenkov : Journal
Les dystopies de Zamiatine et Platonov
Isaac Babel ou l'écriture rouge
Ludmila Oulitskaia ou l'âme de l'Histoire
Bounine : Coup de soleil, nouvelles
Sade
Sade, ou l’athéisme de la sexualité
San-Antonio
Rire de tout ? D’Aristote à San-Antonio
Sansal
2084, conte orwellien de la théocratie
Le Train d'Erlingen, métaphore des tyrannies
Schlink
Filiations allemandes : Le Liseur, Olga
Schmidt Arno
Un faune pour notre temps politique
Le marcheur de l’immortalité
Sciences
Agonie scientifique et sophisme français
Transhumanisme, intelligence artificielle, robotique
Tyrannie écologique et suicide économique
Wohlleben : La Vie secrète des arbres
Factualité, catastrophisme et post-vérité
Cosmos de science, d'art et de philosophie
Science et guerre : Volpi, Labatut
L'Eglise est-elle contre la science ?
Inventer la nature : aux origines du monde
Minéralogie et esthétique des pierres
Science fiction
Philosopher la science fiction
Ballard : un artiste de la science fiction
Carrion : les orphelins du futur
Dyschroniques et écofictions
Gibson : Neuromancien, Identification
Le Guin : La Main gauche de la nuit
Magnason : LoveStar, Kling : Quality Land
Miller : L’Univers de carton, Philip K. Dick
Mnémos ou la mémoire du futur
Silverberg : Roma, Shadrak, stochastique
Simmons : Ilium et Flashback géopolitiques
Sorokine : Le Lard bleu, La Glace, Telluria
Stalker, entre nucléaire et métaphysique
Théorie du tout : Ourednik, McCarthy
Self
Will Self ou la théorie de l'inversion
Parapluie ; No Smoking
Sender
Le Fugitif ou l’art du huis-clos
Seth
Golden Gate. Un roman en sonnets
Shakespeare
Will le magnifique ou John Florio ?
Shakespeare et la traduction des Sonnets
À une jeune Aphrodite de marbre
La Tempête, Othello : Atwood, Chevalier
Shelley Mary et Percy Bysshe
Le mythe de Frankenstein
Frankenstein et autres romans gothiques
Le Dernier homme, une peste littéraire
La Révolte de l'Islam
Shoah
Ecrits des camps, Philosophie de la shoah
De Mein Kampf à la chambre à gaz
Paul Celan minotaure de la poésie
Silverberg
Uchronies et perspectives politiques : Roma aeterna, Shadrak, L'Homme-stochastique
Simmons
Ilium et Flashback géopolitiques
Sloterdijk
Les sphères de Peter Sloterdijk : esthétique, éthique politique de la philosophie
Gris politique et Projet Schelling
Contre la « fiscocratie » ou repenser l’impôt
Les Lignes et les jours. Notes 2008-2011
Elégie des grandeurs de la France
Faire parler le ciel. De la théopoésie
Archéologie de l’écologie politique
Smith Adam
Pourquoi je suis libéral
Tempérament et rationalisme politique
Smith Patti
De Babel au Livre de jours
Sofsky
Violence et vices politiques
Surveillances étatiques et entrepreneuriales
Sollers
Vie divine de Sollers et guerre du goût
Dictionnaire amoureux de Venise
Somoza
Daphné disparue et les Muses dangereuses
Les monstres de Croatoan et de Dieu mort
Sonnets
À une jeune Aphrodite de marbre
Barrett Browning et autres sonnettistes
Marteau : Ecritures
Pasolini : Sonnets du tourment amoureux
Phénix, Anthologie de sonnets
Seth : Golden Gate, roman en vers
Shakespeare : Six Sonnets traduits
Haushofer : Sonnets de Moabit
Sonnets autobiographiques
Sonnets de l'Art poétique
Sorcières
Sorcières diaboliques et féministes
Sorokine
Le Lard bleu, La Glace, Telluria
Sorrentino
Ils ont tous raison, déboires d'un chanteur
Sôseki
Rafales d'automne sur un Oreiller d'herbes
Poèmes : du kanshi au haïku
Spengler
Déclin de l'Occident de Spengler à nos jours
Sport
Vulgarité sportive, de Pline à 0rwell
Staël
Libertés politiques et romantiques
Starobinski
De la Mélancolie, Rousseau, Diderot
Steiner
Oeuvres : tragédie et réelles présences
De l'incendie des livres et des bibliothèques
Stendhal
Julien lecteur bafoué, Le Rouge et le noir
L'échelle de l'amour entre Julien et Mathilde
Les spectaculaires funérailles de Julien
Stevenson
La Malle en cuir ou la société idéale
Stifter
L'Arrière-saison des paysages romantiques
Strauss Leo
Pour une éducation libérale
Strougatski
Stalker, nucléaire et métaphysique
Szentkuthy
Le Bréviaire de Saint Orphée, Europa minor
Tabucchi
Anges nocturnes, oiseaux, rêves
Temps, horloges
Landes : L'Heure qu'il est ; Ransmayr : Cox
Temps de Chronos et politique des oracles
Tesich
Price et Karoo, revanche des anti-héros
Texier
Le démiurge de L’Alchimie du désir
Théâtre et masques
Masques & théâtre, Fondation Bodmer
Thoreau
Journal, Walden et Désobéissance civile
Tocqueville
Française tyrannie, actualité de Tocqueville
Au désert des Indiens d’Amérique
Tolstoï
Sonate familiale chez Sofia & Léon Tolstoi, chantre de la désobéissance politique
Totalitarismes
Ampuero : la faillite du communisme cubain
Arendt : banalité du mal et de la culture
« Hommage à la culture communiste »
De Mein Kampf à la chambre à gaz
Karl Marx, théoricien du totalitarisme
Lénine et Staline exécuteurs du totalitarisme
Mussolini et le fascisme
P our l'annulation de la Cancel culture
Muses Academy : Polymnie ou la tyrannie
Tempérament et rationalisme politique
Hayes : Je suis Pilgrim ; Tejpal
Meerbraum, Mandelstam, Yousafzai
Trollope
L’Ange d’Ayala, satire de l’amour
Trump
Entre tyrannie et rhinocérite, éloge et blâme
À la recherche des années Trump : G Millière
Tsvetaeva
Poèmes, Carnets, Chroniques d’un goulag
Ursin
Jean Ursin : La prosopopée des animaux
Utopie, dystopie, uchronie
Etat et utopie de Thomas More
Zamiatine, Nous et l'Etat unitaire
Huxley : Meilleur des mondes, Temps futurs
Orwell, un novlangue politique
Margaret Atwood : La Servante écarlate
Hitlérienne uchronie : Lewis, Burdekin, K.Dick, Roth, Scheers, Walton
Utopies politiques radieuses ou totalitaires : More, Mangel, Paquot, Caron
Dyschroniques, dystopies
Ernest Callenbach : Ecotopia
Herland parfaite république des femmes
A. Waberi : Aux Etats-unis d'Afrique
Alan Moore : V for vendetta, Jérusalem
L'hydre de l'Etat : Karlsson, Sinisalo
Valeurs, relativisme
De Nathalie Heinich à Raymond Boudon
Vargas Llosa
Vargas Llosa, romancier des libertés
Aux cinq rues Lima, coffret Pléiade
Littérature et civilisation du spectac le
R êve du Celte et Temps sauvages
Journal de guerre, Tour du monde
Arguedas ou l’utopie archaïque
Venise
Strates vénitiennes et autres canaux d'encre
Vérité
Maîtres de vérité et Vérité nue
Verne
Colonialisme : de Las Casas à Jules Verne
Vesaas
Le Palais de glace
Vigolo
La Virgilia, un amour musical et apollinien
Vila-Matas
Vila-Matas écrivain-funambule
Vin et culture alimentaire
Histoire du vin et de la bonne chère de la Bible à nos jours
Visage
Hans Belting : Faces, histoire du visage
Vollmann
Le Livre des violences
Central Europe, La Famille royale
Volpi
Volpi : Klingsor. Labatut : Lumières aveugles
Des cendres du XX°aux cendres du père
Voltaire
Tolérer Voltaire et non le fanatisme
Espmark : Le Voyage de Voltaire
Vote
De l’humiliation électorale
Front Socialiste National et antilibéralisme
Voyage, villes
Villes imaginaires : Calvino, Anderson
Flâneurs, voyageurs : Benjamin, Woolf
Wagner
Tristan und Isolde et l'antisémitisme
Walcott
Royaume du fruit-étoile, Heureux voyageur
Walton
Morwenna, Mes vrais enfants
Welsh
Drogues et sexualités : Trainspotting, La Vie sexuelle des soeurs siamoises
Whitman
Nouvelles et Feuilles d'herbes
Wideman
Trilogie de Homewood, Projet Fanon
Le péché de couleur : Mémoires d'Amérique
Williams
Stoner, drame d’un professeur de littérature
Wolfe
Le Règne du langage
Wordsworth
Poésie en vers et poésie en prose
Yeats
Derniers poèmes, Nôs irlandais, Lettres
Zamiatine
Nous : le bonheur terrible de l'Etat unitaire
Zao Wou-Ki
Le peintre passeur de poètes
Zimler
Lazare, Le ghetto de Varsovie

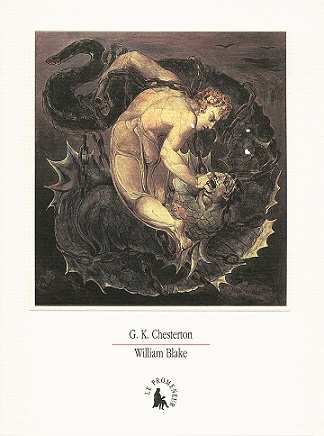
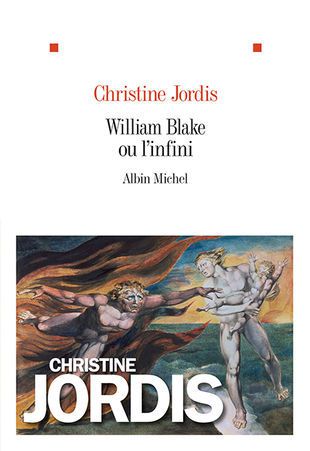





/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)
/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)
/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)
/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)


/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)


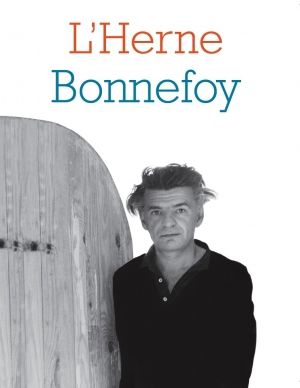
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)
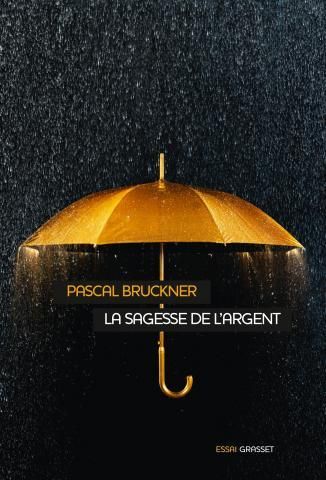
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)
/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)
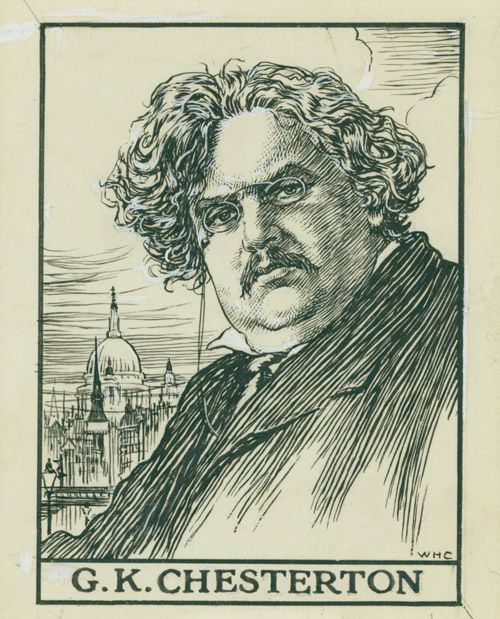

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)
/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)
/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)
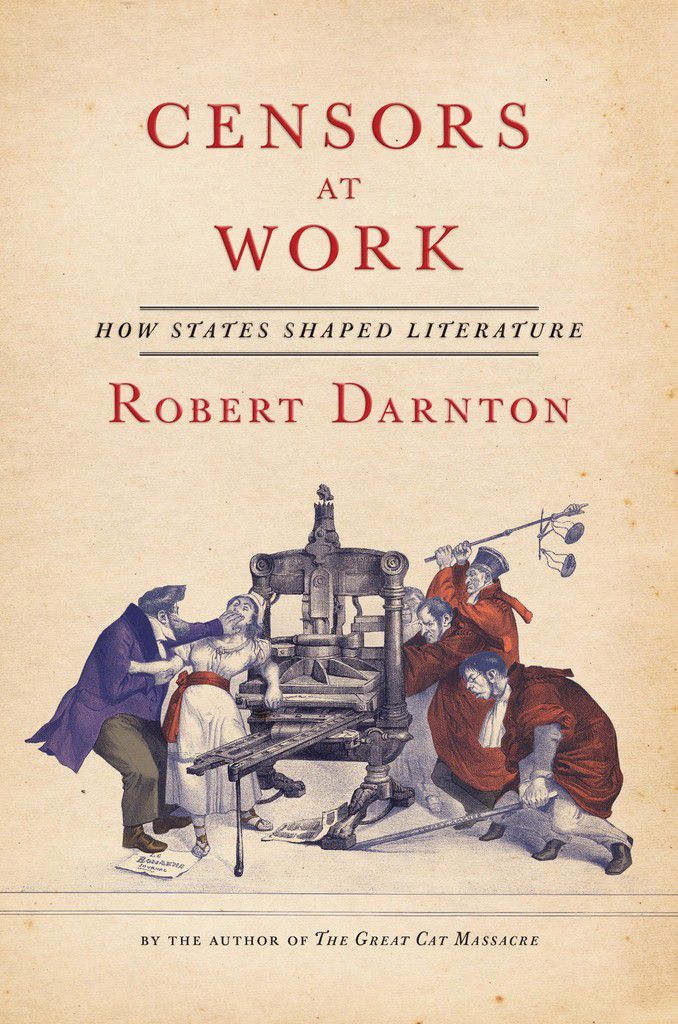
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)
/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)
/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

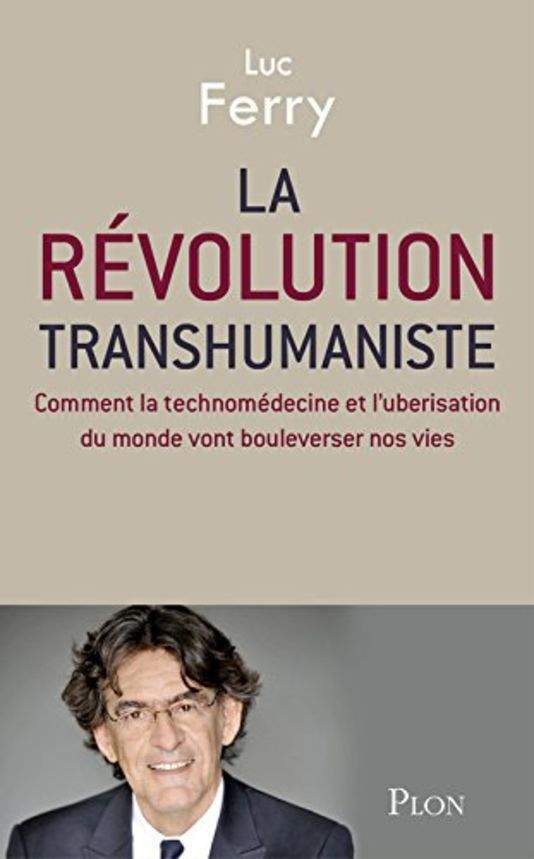
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)
/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)
/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)


/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)



/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)
/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)
/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)
/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)
/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)
/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)
/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)
/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)
/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)
/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)


/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)
/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)
/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)
/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)


/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)
/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)
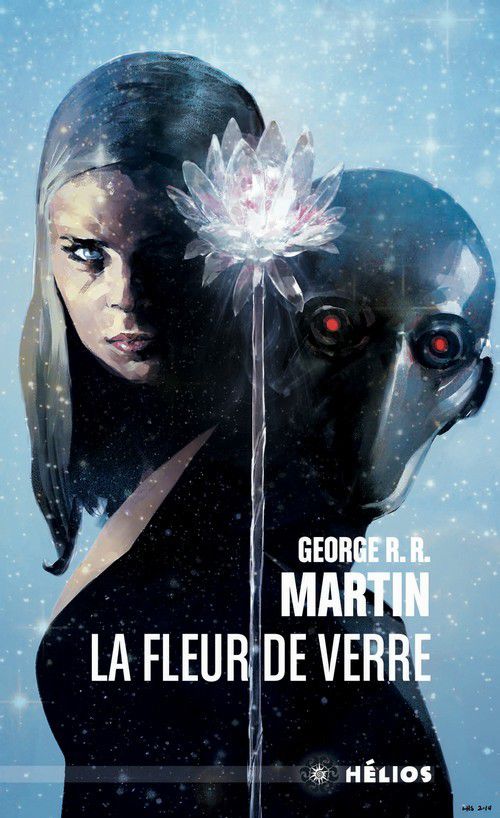
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)
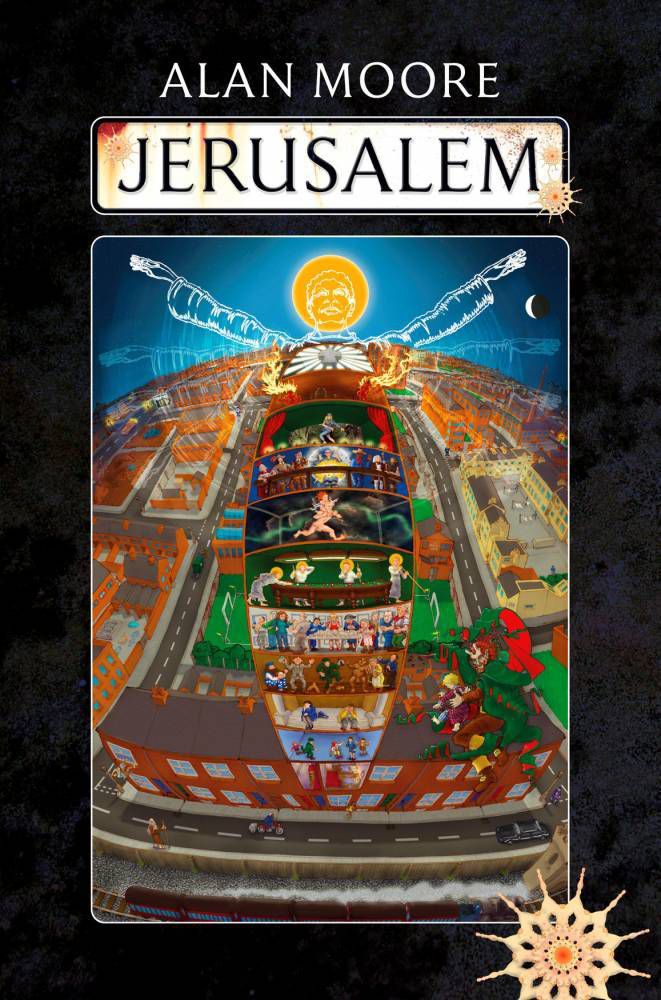

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)
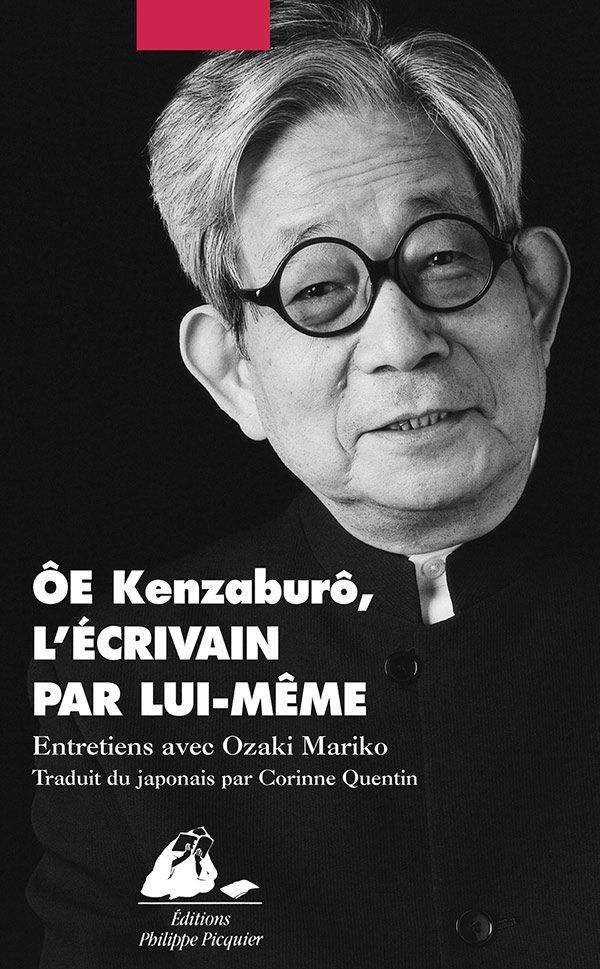
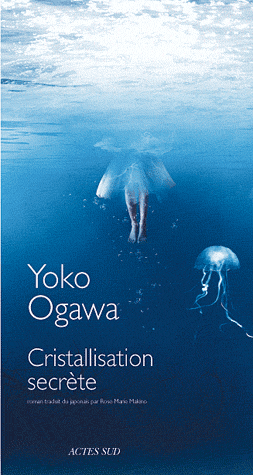
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)
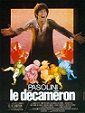
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)
/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)
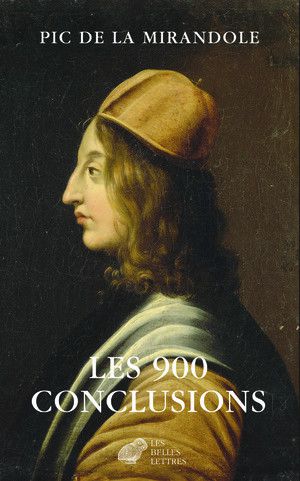
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)
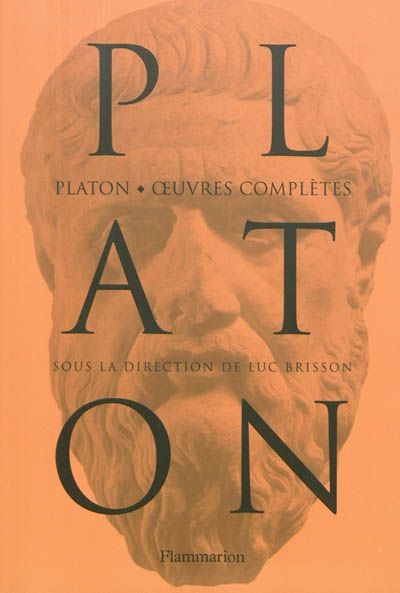
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)
/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)
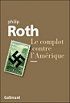
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)
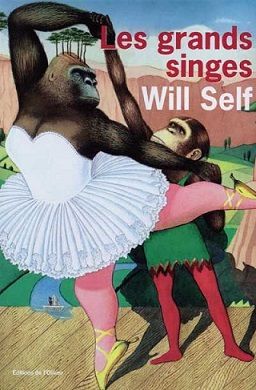
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)
/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)


/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)
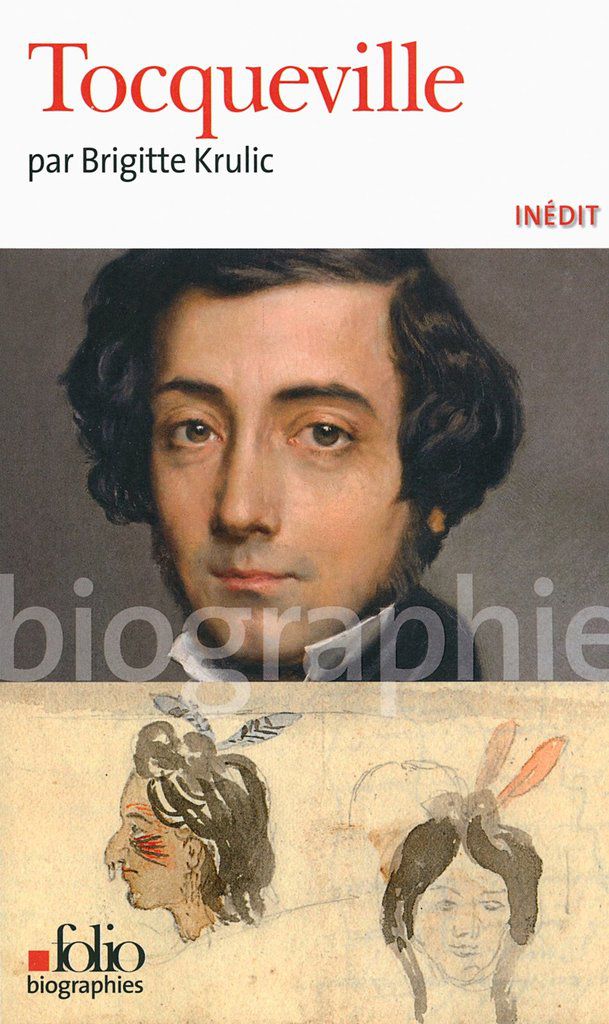
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)
/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

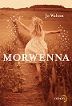
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)



/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)
/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)