
Vierge XV°, Museo civico de Bolzano / Bozen, Trentino Alto-Adige / Südtirol.
Photo : T. Guinhut.
Féminités littéraires,
du Moyen Âge à notre contemporain.
Martine Reid & Nathalie Heinich.
Femmes et littérature. Une histoire culturelle I & II,
Sous la direction de Martine Reid, Folio essais, 2020, 1040 p, 13,50 € et 592 p, 10,30 €.
Nathalie Heinich : Etats de femme. L’identité féminine dans la fiction occidentale,
Tel Gallimard, 2018, 402 p, 12,50 €.
Il est loin le temps où l’on songeait à une Galerie des femmes célèbres avec un rien de condescendance, comme Sainte-Beuve, qui, tout en honorant deux douzaines de dames fort renommées, reines, duchesses et amoureuses, ne comptait qu’à peine une demi-douzaine d’écrivaines, quoique ce féminin ne fût pas employé. Madame de Sévigné pour ses lettres, Mademoiselle de Scudéry, pour les interminables préciosités de Clélie et sa « carte du Tendre », traitée d’ailleurs du bout du bec, ou George Sand, dont il aimait ses « tableaux de pastorales et de géorgiques bien françaises[1] ». Cette manière critique bien désuète se devait d’être dépassée. C’est chose faite, en toute ampleur et vigueur, avec Femmes et littérature. Une histoire culturelle, sous la direction de Martine Reid et avec le concours d’une dizaine de spécialistes. Les plumes féminines françaises et francophones méritaient au moins ces mille-six-cents pages, du Moyen Âge à notre contemporain. À cette somme, il ne faut pas manquer d’ajouter l’essai de Nathalie Heinich : Etats de femme. L’identité féminine dans la fiction occidentale, de façon à élargir encore la perspective, non sans se demander s’il y a bien une spécificité de l’écriture féminine et combien de représentations collent à la peau des femmes dans la littérature.
À qui était-il permis d’écrire, au Moyen Âge ? Fallait-il encore savoir lire… « La grande dame, la religieuse ou la veuve » seules était susceptibles de pages épistolaires, dévotes, plus rarement poétiques à l’instar des troubadours, ou de ce qui devenait le roman. Mais en français, et non en latin, ce qui les rendaient méprisables aux yeux des lettrés. Quoiqu’elles fussent également commanditaires, copistes, enlumineresses, jouant un rôle parfois crucial dans la chaine du livre, encore manuscrit. L’une de ces artistes, Anastaise, nous est connue par l’éloge qu’en fit Christine de Pizan, dans son Livre de la Cité des Dames. Celle-ci, après Marie de France et ses Lais, est la « nonpareille », présentée avec conviction par Jacqueline Cerquiglini-Toulet, qui la traduisit en français moderne[2]. Aux autorités paternelle et masculine, Christine de Pizan préfère « Raison et Philosophie ». Ce qui lui permet d’être fort polémique à l’encontre de la misogynie du Roman de la rose. Sa Cité des dames présente les femmes célèbres, tant dans la guerre que la sainteté et les arts, le Livre des Trois Vertus répond aux Enseignements moraux. Se faisant homme en mettant la main à la plume qui la fait vivre, elle est « la première figure d’une intellectuelle écrivant en français ». Comme quoi « les femmes auteurs ne se sont pas coulées dans un modèle d’amour, d’amour dit courtois, qui n’a pas été pensé par elles ».
La Renaissance fut-elle également féminine ? Souvent encore, la femme subit les attaques des auteurs qui la conspuent : elle est libidineuse, folle et traitresse, selon Toulouse Gratien du Pont, qui, en 1534, publia les Controverses des sexes Masculin et Femenin. Tout ou presque, y compris la police des mœurs est au service des hommes. À une époque où se poursuit la chasse aux sorcières[3], le développement de l’imprimerie bénéficia cependant à nos auteures, malgré une exclusion des lieux d’éducation : « une floraison inattendue, puisque près de cent-quarante autrices ont pu y être repérées, là où les dix siècles précédents en avaient laissé émerger à peine une cinquantaine ». En effet, l’aristocratie et une certaine bourgeoisie encouragent une éducation de leurs filles. Princesses et reines sont au pouvoir, les salons apparaissent, quand les imprimeurs travaillent avec leurs femmes et filles, et la veuve reprend parfois l’affaire. Bientôt l’on publie une Fleur des dames ou une Vie des femmes célèbres. Quand des humanistes se font « champions des dames », le néoplatonisme et le pétrarquisme contribuent aux « idéologies philogynes ». Et si la poésie de Scève et Ronsard loue la femme, leur répond Louise Labé. Marguerite de Navarre, après une œuvre étendue, dont théâtrale avec pas moins de onze pièces, laisse inachevé son Heptaméron, publié de manière posthume. Si les Reines du temps sont prolixes, sans compter des écrits politiques injustement oubliés, l’on retient les noms de Pernette du Guillet, d’Hélisenne de Crenne, dont il faudrait lire le « grandiose roman » : Les Angoysses douloureuses qui procèdent d’amours. Elle y jette « les bases du roman psychologique qu’on dit à tort inventé par Madame de Lafayette ».
La « dénonciation de la sujétion féminine » et des violences masculines, dans l’Heptaméron par exemple, est évidement féministe, même si le mot n’existe pas encore. À quoi répond l’éloge des « femmes fortes ». Cependant ce sont aussi des hommes qui se font les éditeurs, les anthologistes de cette « renaissance des Muses », dans la lignée d’une Sappho redécouverte.


Enfin vint « un grand siècle pour les femmes auteurs » ! Le XVII° de Mesdames de Lafayette, de Villedieu, d’Aulnoy et de Sévigné, est aussi le grand siècle où elles « revendiquent l’égalité politique, sociale et économique entre les sexes ». L’émergence de volumes aux petits formats, la vogue de la prose romanesque et du français au détriment du latin, tout contribue à l’émergence d’« Amazones, femmes fortes et frondeuses » ; comme Barbe d’Ernecourt, qui porta l’épée pour défendre ses terres et conçut des tragédies. L’on s’arrache avec délectation les romans épiques, politiques, chevaleresques et pastoraux de Madeleine de Scudéry, Artamène ou le grand Cyrus et Clélie, histoire romaine, comptant chacun dix volumes, quand le premier exhibe treize mille pages, soit le plus long roman français jamais écrit ! Ces modèles de chroniques guerrières, de la préciosité et de la galanterie, de l’art d’aimer en de baroques développements, coulaient d’une main révoltée contre la tyrannie du mariage, qu’elle évita en restant célibataire. N’empêche que si l’on ne lit plus guère ses pages aujourd’hui, peut-être à tort, elles eurent une affolante réputation et une influence considérable pendant plus d’un siècle, jusque dans les développements du roman anglais. Hélas, les précieuses à la Clélie sont moqués par Boileau, quoique louées par Huet, deviennent « ridicules » avec Molière, qui en récolte grand succès…
Avec Zaïde puis La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette participe à la « naissance des grands classiques ». Madame de Villedieu n’a pas cette chance, à cause d’un vent de scandale. Madame D’Aulnoy publie en 1690 le premier conte de fées, avant Perrault, donnant lieu à un engouement pour ce nouveau genre presque exclusivement féminin, qui influencera grandement les Lettres anglaises. Probablement a-t-on eu grand tort d’enfouir dans l’oubli les romancières Murat et de La Force. C’est alors que le Dictionnaire de l’Académie, mais aussi ceux de Richelet et Furetière, incluent autant hommes que femmes sous le mot « auteur », ce qui permet à la signataire de ce vaste chapitre, Miss Joan Dejean, de « rester fidèle au choix des premiers grands lexicographes français » et d’adopter « les termes d’auteurs et d’écrivains sans recourir à une forme féminine » ; sage posture sans polémique superflue.
Paradoxalement, le siècle des Lumières ne fut pas aussi prolixe en auteurs féminins. Ce qui n’empêche pas les dames de la République des Lettres de dialoguer avec les penseurs du temps et les encyclopédistes. Si la question du droit des femmes est intensément débattue, au travers de L’Egalité des deux sexes de Poulain de la Barre que discute Louise d’Epinay, de Voltaire qui prétend que l’imagination passive et servile est féminine quand celle active et créatrice est masculine, sans oublier Sophie fort inférieure à Emile chez Rousseau, auquel l’on préférera la défense de l’éducation dans Les Conversations d’Emilie de Louise d’Epinay, elle aboutira à une revendication occultée, celle de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en 1791, par la dramaturge et essayiste Olympe de Gouges, guillotinée lors de la Terreur révolutionnaire.
Il n’en reste pas moins qu’en ce siècle des salons et des académies, des figures essentielles surgissent, tant Emilie du Chatelet, mathématicienne et physicienne dont la traduction française des Principia Mathematica de Newton fait toujours autorité, sans compter son essai De la liberté, que Françoise de Grafigny, dont les excellentes Lettres d’une Péruvienne participent de la curiosité des Lumières à l’égard des nouveaux mondes, ou Marie-Jeanne Riccoboni, aux vastes romans épistolaires sentimentaux et polémiques, ou encore Germaine de Staël[4], qui déborde sur le XIX° siècle.

Madame du Boccage : La Colombiade, Desaint & Saillant, 1756.
Œuvres, Chez les Frères Périsse, 1770.
Photo : T. Guinhut.
Placé « sous le signe de la différence des sexes », le siècle inauguré par Napoléon entérine en son Code civil de 1804 l’inégalité des sexes. Germaine de Staël dénonce l’existence « incertaine » des femmes, George Sand vitupère contre « l’esclavage féminin », Hortense Allard défend l’éducation, le divorce, la liberté de conduite. Pendant ce temps la satire s’amuse à caricaturer la savante et l’auteure, comme le fit Frédéric Soulier dans sa Physiologie du bas-bleu, en 1841. Aurore Dupin prit le pseudonyme que l’on sait, Rachilde se targuait de cartes de visite ainsi libellées : « homme de lettres ». Libraires et éditeurs féminins sont encore bien rares.
C’est cependant le temps des livres pour la jeunesse, pour les filles, dans une visée éducative, écrits par Félicité de Genlis ou la comtesse de Ségur. Cénacles, salons, presse féminine, librairies se développent peu à peu. Quelques rares voyageuses peuvent publier, comme la malheureuse Flora Tristan avec ses Pérégrinations d’une paria. Mais aussi des mémoires, des autobiographies, telle l’Histoire de ma vie, sous la plume de George Sand. Quant à la poésie, elle reste un discours « genré », où parmi une abondante production domine la romantique Marceline Desbordes-Valmore, que Baudelaire ne dédaignait pas, poétesse honorée, mais à condition qu’elle reste fidèle à une poésie de femme… Nombreuses et lyriques, ces poétesses parlent du cœur, des fleurs et de l’âme, jusqu’à la musicalité synesthésique d’Anna de Noailles ; rares sont celles qui accèdent autour de 1900 à la capacité de laisser entendre leur homosexualité, telle Renée Vivien ou Natalie Clifford Barney dont on retient Quelques portraits-sonnets de femmes.
Genre féminin, le roman se doit être sentimental. Sophie Cottin et Madame de Staël, avec Corinne ou l’Italie sont parmi les meilleures ventes. Il en est de même avec George Sand, puis à la Belle époque, Marcelle Tynaire, Gérard D’Houville, alors que ces dames n’hésitent pas à investir les genres gothique, historique, comme Madame de Genlis, avec Mademoiselle de Lafayette ou le siècle de Louis XIII, voire libertin, avec Monsieur Vénus de Rachilde. Cependant il s’agit d’investir l’essai, là encore avec Germaine de Staël dont l’Essai sur les fictions n’est pas aussi célèbre que De l’Allemagne. C’est sous le nom de Daniel Stern que Marie d’Agout, amante de Franz Liszt, publie son brillant et méconnu Essai sur la liberté considérée comme principe et fin de l’activité humaine, dans lequel elle défend ardemment le droit des femmes, à l’éducation, au divorce, au choix de la maternité !
Le XIX° littéraire n’était pas si misogyne que l’on voulut nous le faire croire. Au rebours de nombre de contempteurs méprisant une romancière prétendue médiocre, l’auteur de L’Âne mort, et critique renommé, Jules Janin, déclara en 1839 : « Le roi des romanciers modernes, c'est une femme ». Certes il ne pensait pas à détrôner Balzac, mais à louer George Sand, elle-même admirée par l’auteur de La Comédie humaine et par Flaubert, rien de moins ! Celle qui a publié plus de soixante-dix romans[5] obtint un succès considérable avec Indiana, s’illustra scandaleusement au cours du roman-poème Lélia dans la révolte métaphysique et l’expression d’une sexualité féminine en 1833. Mauprat est à la fois un roman historique, familial, d'amour, d'aventures, noir, humanitaire, et social, quand Nanon réécrit l'histoire de la Révolution par le truchement des lèvres d’une paysanne. Pauline est le roman de formation de l'artiste, alors que le triptyque champêtre formé par La Mare au Diable, François le Champi et La Petite Fadette, la révèle en pionnière de l'ethnographie et de l'ethnolinguistique, non sans compter l'ethnomusicologie avec Les Maîtres sonneurs. Par ailleurs Chopin transparait dans Lucrezia. La Ville noire est un roman industriel à la fois réaliste et utopiste. N’est-elle pas également précurseure du Voyage au centre de la Terre, de Jules Verne, lorsque Laura, voyage dans le cristal associe voyage initiatique, conte fantastique et science, en particulier la minéralogie ?

Madame de Grafigny : Lettres d'une Péruvienne, Didot l'Ainé, 1797 ;
Ménard et Desenne, fils, 1822.
Photo : T. Guinhut.
Foisonnant, explosant toutes ou presque les barrières, le XX° siècle voit la vogue de Colette, qui aura droit à des funérailles nationales en 1959, malgré ses thématiques parfois homosexuelles, voire incestueuses, puis celle du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, le flux du féminisme et les éditions « Des femmes ». Une Marguerite de Yourcenar se voit accéder à l’Académie française, Françoise Sagan ou Marguerite Duras éclipsent bien des messieurs. Les « étrangères de Paris » viennent de Russie pour devenir Nathalie Sarraute ou Irène Némirovski, dont Suite française, posthume, ne sera publié qu’en 2004. Le roman politique fait d’Elsa Triolet une thuriféraire du Parti Communiste, alors que Charlotte Delbo participe de la littérature concentrationnaire. Sans compter que le roman sentimental devient stéréotypé, rose avec Delly et « passion » avec les surproductions de la collection « Arlequin » qui abreuve les lectrices en mal d’amour, c’est « Eros au féminin » qui vient troubler le jeu : l’on se souvient, malgré la censure encore vive, d’Histoire d’O, de Pauline Réage, de Thérèse et Isabelle de Violette Leduc, d’Emmanuelle…
Être romancière n’a plus rien qui puisse être dépréciatif. Journalistes, philosophes comme Simone Weil, poétesses comme Andrée Chédid, peut-on dire que le récent siècle réalise le rêve de l’équité ?
Une foule de poétesses, théologiennes, romancières, épistolières, essayistes éclosent sous nos yeux en ce livre-fleuve, parfois introuvables, comme Madame du Boccage[6], au XVIII° qui fit une tragédie sur Les Amazones, mais aussi, quoiqu’elle soit ici trop peu évoquée, une belle épopée en vers sur Christophe Colomb et la découverte de l’Amérique : La Colombiade. Une redécouverte s’impose, non pas par égalité des sexes, car ce serait un critère usurpé face à celui de la qualité littéraire, mais de par une réelle équité, une curiosité créatrice, jusqu’à une actuelle et féminine francophonie.
« Chacune des contributrices », dit-on ; est-ce à dire qu’aucun contributeur ne fut invité ? Au risque du sectarisme féminin qui considérerait que l’on ne peut faire œuvre féminine que par des femmes. Ce qui, gageons-en, serait à cent lieues de l’esprit dans lequel Christine de Pizan, George Sand ou Simone Weill ont écrit. Un rien de dogmatisme, aimant traquer pas toujours avec nuance, l’« antiféminisme ordinaire » (à propos des « chosettes » de Christine de Pizan qui devinrent au XIX° des « chaussettes »), imprègne de manière par instant dommageable ce vaste ensemble, quoique nos femmes savantes de cette « histoire culturelle échappent presque toujours à ce travers. Insistons avec vigueur, l’ouvrage, qui eût gagné à être édité avec des couvertures cartonnées, reste au long cours prodigieusement intéressant, lisible comme un bon roman, érudit et roboratif.
Avouons qu’en apercevant un entrefilet annonçant cette parution, nous imaginions une anthologie documentée et commentée, de façon à découvrir maintes auteures ignorées. Faut-il regretter que cela ne soit pas le cas ? Oui et non. Certes ces deux volumes comptent des citations judicieusement choisies et permettent d’éclairer ce qui fut occulté, mais la perspective s’intéresse autant au contenu proprement littéraire qu’aux conditions sociétales et idéologiques qui président à cette créativité moins contrainte que l’on aurait pu l’imaginer, qui a cependant pu exploser au cours du XX° siècle, grâce à sa libération des femmes. Sans oublier les lectrices et bien plus tard les éditrices.
Nos auteures rappellent avec pertinence Hélène Cixous, affirmant en 1975 combien il est « impossible de définir une pratique féminine de l’écriture », et Julia Kristeva, elle aussi en 1975, pensant « de plus en plus qu’il faudrait se garder de sexualiser les productions culturelles ». L’on sait à ce propos qu’aujourd’hui ces messieurs, au contraire de Georges Sand au XIX° siècle, ne répugnent pas le moins du monde à user d’un pseudonyme féminin, tel Yasmina Khadra, qui se révéla en 1999, s’appeler Mohammed Moulessehoul, ce qui ne manque pas de sel si l’on pense à l’origine culturelle maghrébine de tels noms…
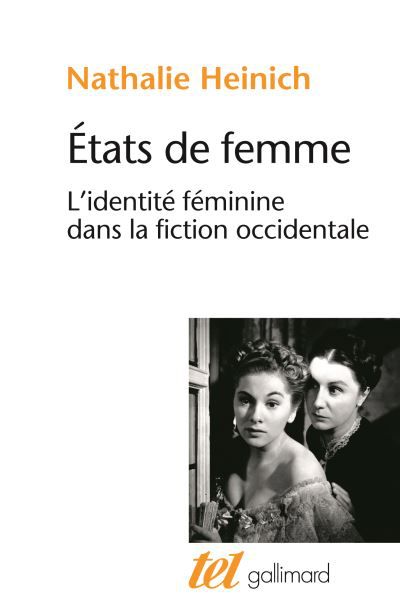
En complément de cette vaste traversée, ne faut-il pas s’intéresser à « l’identité féminine dans la fiction occidentale » ? L’essai de Nathalie Heinich (dont nous connaissions la réflexion sur l’art contemporain[7]), Etats de femmes, aurait pu se passer d’un tel titre pour ne conserver que le sous-titre plus explicite. L’essayiste s’attache à décrire les « structures élémentaires de l’identité féminine » parmi le roman occidental du XVIIIe siècle à notre contemporain, sans ignorer contes, nouvelles, pièces de théâtre et films. Soit, à la suite de Claude Lévi-Strauss, « les structures élémentaires de l'identité féminine ». Comment représente-t-on les personnages féminins, selon quels regards, quelles stratégies ? Ils sont évidemment et de manière écrasante hétérosexuels, fort souvent adossés au sentiment amoureux et à un projet matrimonial, en situation de sujétion face aux entités masculines.
Nathalie Heinich structure sa réflexion selon trois états de la femme romanesque : la première, jeune fille à marier, devient souveraine légitime face au mari, et mère comblée comme il se doit ; la seconde, rivale ou maîtresse, est aux prises à la menace d’une autre fantasmée ; la troisième est gouvernante, veuve, vieille fille ou « bas bleu », en ce sens exclue du monde sexué, elle n’est rien ni n’est touché par la rivalité entre les précédentes. L’on se demande alors où placer la courtisane, la prostituée et fille des rues et de bas-étage, « la grisette et la débauchée », ou encore « concubine et maîtresse ». Même si l’on observe la survenue de nouvelles figures, en particulier entre les deux guerres mondiales, comme la « femme non-liée », indépendante financièrement et assumant sa sexualité, qui chamboule la représentation traditionnelle du féminin.
Cependant des modèles iconiques surgissent, telle Rebecca, chez Daphné Du Maurier, qui est éprouvée par le « complexe de la seconde », soit l’ « incertitude quant à sa propre position, obsession d’une autre magnifiée, rabaissement puis négation de soi, endossement successif de rôles toujours plus infériorisant. » Nathalie Heinich y décèle un « Œdipe au féminin », ce qui s’explique par « l’identité de la structure entre la situation de la seconde épouse en rivalité avec la première pour l’amour du mari, et la situation de la fille en rivalité avec sa mère pour l’amour du père ». Ainsi, de Charlotte Brontë à Marguerite Duras, d’Henry James à Delly, l’on saura comment et quelle femme être, quelle femme remplacer dans le cœur ou le panier de mariage de messieurs exigeants, ou dupés. L’on devine que les désillusions dues au mariage sont nombreuses. Il en va ainsi en étudiant le cas de Madame Bovary par l’entremise de Flaubert, de Gervaise dans L’Assommoir de Zola. L’on ne pouvait rater les romans de Colette, icône de « l’affranchissement sexuel de la femme moderne », en particulier La Seconde, où les relations extraconjugales perturbent Fanny, l’épouse de Farou, quoique notre essayiste fasse l’impasse sur ce titre. Ni ces personnages emblématiques, Jane Eyre, menacée par une première femme folle, dans les pages addictives de Charlotte Brontë, « Tess, âgée de seize ans, violée au fond des bois, dans sa robe de fête » sous la plume de Thomas Hardy… Veuve joyeuse et dangereuse, femme passive ou révoltée, harem, polygamie, sorcière, « divorce et délivrance », « écriture et indépendance », ce sont cent « états de femme » qui donnent le vertige.
Malgré la riche énumération d’intrigues romanesques et d’allusions à des personnages aux prises avec leur féminité, le roman ne se contente pas ici d’être un objet littéraire, il devient le « terrain » d’une enquête sociologique, anthropologique et psychanalytique. Le désir qui peut être tyrannie de la possession de l’autre chez l’homme peut devenir, au-delà du désir de procréation, au-delà de la domination patriarcale, un désir de reconnaissance chez la femme, celui d’un statut familial, social, intellectuel. L'appréciation traditionnelle des qualités littéraires des œuvres n’est pas ici la tasse de thé de Nathalie Heinich. Qu’importe, le but est autre, préférant scruter le récit, les personnages, en tant que témoignages et moteurs d’un temps, en tant que structures des mentalités. Il postule avec pertinence que le roman est un moyen pour les femmes de se connaître et d'exister, comme auteur et comme lectrice.
In fine, faut-il saluer la probité de la chercheuse qui ne campe pas au sommet d’une position dogmatique, « pour s’abstenir de toute position idéologique et, en l’occurrence, de tout engagement féministe », assumant une sociologie de la compréhension, ou se chagriner qu’elle ne joue pas dans la cour d’une lecture critique, déconstructive et militante du champ masculin à l’œuvre dans la fiction littéraire, se démarquant ainsi de ce que l’on appelle la recherche féministe ? La seconde démarche polluerait qui sait la première…
Certes l’Histoire littéraire, dans les manuels scolaires de Lagarde et Michard, par exemple, honorait une écrasante majorité d’hommes. Mais, quand un tropisme hérité du XIX° siècle ne daignait pas considérer les « bas-bleus », ce n’était pas faute de candidates honorables ; il suffit de feuilleter ces copieux volumes de Femmes et littérature pour s’en convaincre. Ces dames ne sont plus seulement des personnages de la fiction occidentale, le plus souvent écrite par des hommes, quoiqu’ils puissent dire avec justesse « Madame Bovary c’est moi », mais depuis longtemps et pour longtemps des créatrices à part égale. Espérons qu’un avenir venu de la dystopie de Noami Alderman, dont Le Pouvoir[8] met en scène une tyrannie féminine, ne nous obligera pas à devoir imaginer un essai en miroir intitulé « Hommes et littérature »…
Thierry Guinhut
Une vie d'écriture et de photographie
[1] Sainte-Beuve : Galerie des femmes célèbres, Garnier Frères, sans date, p 435.
[5] George Sand : Romans I et II, La Pléiade, Gallimard, 2019.
[6] Madame du Boccage : Œuvres, Les Frères Périsse, 1770.
[8] Voir : Révolution anthropologique, féministe et politique du Pouvoir par Naomi Alderman

Madame de Genlis : Mademoiselle de La Fayette ou le siècle de Louis XIII,
Maradan, 1813. Photo : T. Guinhut.



/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)
/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)
/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)
/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)


/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)



/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)
/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)


/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)
/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)
/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)
/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)
/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)


/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)
/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)
/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)


/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)



/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)
/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)
/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)
/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)
/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)
/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)
/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)
/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)
/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)
/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)


/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)
/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)
/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)
/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)


/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)
/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)


/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)
/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)
/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)
/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)


/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)
/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)



/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)
/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)