/image%2F1470571%2F20230725%2Fob_e1c326_pierre-saint-martin-arette.JPG)
Col de La Pierre Saint-Martin, Arette, Pyrénées-Atlantiques.
Photo : T. Guinhut.
LE PASSAGE DES SIERRAS
I
Un Etat libre en Pyrénées
Pourtant ce fut un drôle d'été. Ou, au lieu de me gaver de montagne, la montagne me fut trop souvent retirée. Ou j'usais des camps d'adolescents qui m'embauchaient comme animateur pour atteindre et vivre des lieux... J'aimais cette activité de compagnie, de jeux et de randonnées, où je pouvais de plus espérer de féminines rencontres parmi les autres moniteurs et monitrices. Mais ceci serait une autre histoire, d'autres histoires... Après quelques bribes de vies diverses, j'allais retourner dans les Pyrénées !
Un train de nuit nous déversa, masse fluctuante bousculée de bagages, sur les quais de la gare de Pau. Puis, un bus, exagérément matinal, dans lequel, absorbé par la cohorte des adolescents bavards, par un réveil général vaseux, et par le soupçon d'éclats montagneux pâles au travers des masses brisées du temps couvert, je ne faisais guère attention au groupe des autres animateurs, particulièrement discret et gris me semblait-il. Les balancements nauséeux du bus nous hissaient rapides dans les brouillards de mon souvenir et d'une route estivale et verte dans le blanc sale du sans jour. Plus haut, après les panneaux et les murs des Eaux-Bonnes, puis au-dessus de larges lacets, de forêts lourdes d'humidité, l'on y vit quelque chose. C'étaient des bâtiments de crépi et d'ardoise, comme une caserne égarée pour soldats de zinc, jetés sur un étroit pré mal foutu, au surplomb d'un torrent invisible, entre deux versants noirs de rochers et de bois, une cuvette étranglée sous un ciel gonflé, gris bourgeonneux, obstrué d'en haut, sur les côtés et d'en bas. Quant à la route, elle n'abordait ce site bruyant de vapeurs d'eaux que par le rejet de l'extrémité d'une épingle à cheveux, à regret de devoir le desservir. Mais c'était tout de même la montagne, son souffle, sa puissance, sa liberté d'itinéraires et de moi possibles, et moi, inconscient que j'étais, j'exultais.
Nous étions là pour trois semaines, autant dire une libérale abondance de journées de marche, de campements et de cabanes, de vallées et de sentiers, de mers de nuages et de neiges estivales ; à toutes crêtes. Je brûlais d’initier ces jeunes gens à la montagne, de faire gémir le cuir neuf de mes lourdes chaussures, de hisser mon sac à dos neuf au crochet des refuges, de faire sonner la pointe vierge de mon nouveau piolet. Un équipement qui, soit dit en passant, avait laissé mon portefeuille aussi plat que l'anorexie d'une plaine d'en bas. Il faudrait bien ces trois semaines de joyeux travail pour le regonfler un peu. Et, puisque nous étions aux Eaux-Bonnes, ce séjour ne pouvait être que simple et clair, sûrement je me bonifie rais en coulant des jours limpides et vifs... Mais au rêveur un destin passablement contraire allait s'imposer.
Cette journée inaugurale se passa dans la petite euphorie fébrile de l’installation, des bagages défaits, des déjeuners et dîners, du moins avec les adolescents, car dans une apparente libéralité on ne leur attribuait pas d’animateur fixe. Les comportements bon enfant promettaient des jours heureux, animaient des groupes prolixes et joyeux sur les bancs de la maigre esplanade au-dessus du chaos fermé de brouillards. Quelques moments d’apparente clarté me permirent de descendre avec une poignée d’adolescents dans un pré qui trouait les bois autour d’un instant de torrent calme. Quelques demi-siestes où refaire le monde, jeux d’indiens pour les plus gamins, barrages et baignades allaient pouvoir fleurir…
Autour de la barbe discrète, et jusque-là silencieuse, voire fuyante, du Directeur, la réunion vespérale du programme d'animation s'ouvrit :
Ce furent d'abord, adressées à lui-même plus qu'aux cinq ou six animateurs falots que nous étions, de malhabiles et banales phrases de bienvenue ou résonnaient plus souvent qu'à leur tour l'adjectif « pédagogique » et les expressions, apparemment anodines dans un tel contexte : « collectivité », «vie communautaire »... Je me foutais royalement de ces oiseux préambules et n'écoutais que d'une oreille, attendant le plat de résistance, le programme des réjouissances, les projets de randonnées1 de refuges et de camping qui nous éloigneraient de ce lieu misérable et nous conduiraient vers les vérités de la montagne.
Je n'avais plus qu'un quart d'oreille pour ses balbutiements - visiblement l'aisance oratoire n'était pas son fort - quand il parut, haussant le ton, vouloir galvaniser ses troupes :
- Comme vous le savez, c'est inspirés par le Front de Recherches Pédagogiques des Jeunesses Communistes Révolutionnaires que nous ouvrons la session d'août de ce camp.
Il respira, satisfait, tournant sa langue dans sa bouche comme dans un moulin à sirop, pendant qu'en un instant je me remémorai que cette colonie de vacances émanait du plus banal ministère qui soit, celui des Affaires Sociales, même sous un gouvernement assez paisiblement de droite alors...
Il reprit, plus incisif :
- Donc, ce sera à vous d'instaurer avec moi, ici en Pyrénées, un Etat libre. Dans lequel aucun adolescent, aucun apprenant au collectivisme, ne sera soumis à un chef, dans lequel aucune activité ne sera obligatoire et s'inscrira seulement dans un forum journalier et libertaire. Ici, sur une enclave pyrénéenne, un mode de vie communiste est enfin installé pour le bonheur de tous et en dissidence avec l'infâme gouvernement bourgeois français...
J'en restai bouche bée ...
Il poursuivit en présentant ses acolytes, assis en ordre à sa droite et à sa gauche, son « amie », pâle, les cheveux, nez, menton très courts, le regard effacé, qui faisait fonction d'intendante et d'infirmière, visiblement plus soumise qu’une brebis - à moins que mégère maniaque dans le privé -, ensuite D, lui-même Directeur. Puis B, casque de cheveux frisés, gros doigts, traits de passionaria assagie, et deux ou trois figures si anonymes et que j'oserais a peine nommer, de C à E, F, et peut-être G. Il ne restait au groupe que deux inconnus : mon voisin et moi. A nous somma de dire qui nous étions, bien que le contrat d'engagement dont il avait eu le double eût du suffisamment le renseigner, et ce que nous pensions, pédagogiquement et politiquement. En une bête provocation post-adolescente, riant, je lançai :
- Oh, moi, tout ça m'indiffère un peu. Ce sont les montagnes et le développement des adolescents qui m’intéressent. Pour le reste, je suis un libéral tempéré.
D. s'était étranglé d'un cri de rage rentré... Il se reprit et poussa son attaque :
- Mais c'est incroyable ! D'où sort-il celui-là ? Du musée de l'Histoire ? Tu es donc un valet du capitalisme ? Un suppôt de la tyrannie droitière ? Un capo scout des places boursières ? Un aristo décadent ? Un étrangleur du peuple des travailleurs ? Réponds !
- Je n'aurais pas cru possible la violence de tels clichés, de cette lèvre inférieure gonflée, tordue par la bave du mépris...
- Non, rien de tout ça, tentai-je de me maladroitement défendre. Je ne tiens qu'à ma liberté d'entreprendre et de penser...
- Peuh, sembla-t-il s’affaisser, déçu, fatigué. Là, dans un râle, il prétendit à l’adresse de ses comparses prudemment silencieux :
- Il ne peut pas savoir ce que c’est… Liberté !
- C’est ma liberté que de penser autrement que vous, rétorquai-je, légèrement excédé.
Je crus avoir couru tout droit à l'orage, à la rupture... D. ne fit que rentrer la tête dans les épaules et affecter un air de méditation supérieure :
- De l'autre côté les libéraux aussi défendent la vieille momie de Franco. On dit qu'elle est gravement malade. Qu'elle va bientôt crever. Que la pourriture de sa vie ne lui vient plus que par des tuyaux... L'Espagne fasciste est prête à s'écrouler, mûre enfin pour la revanche populaire. Qu'il passe l'arme à gauche et c'est la révolution. Qui balaiera du même coup son fils incestueux, ce roi pantin de Juan Carlos...
- Et pourquoi pas Juan Carlos ? C'est peut-être ce qui pourrait arriver de mieux à l'Espagne. 11 y a bien des monarchies constitutionnelles, comme en Suède.
Là, je le provoquai. C'était sûrement une erreur. Mais il s'était tassé sur lui-même :
- Peuh... La monarchie. Une image fossile de l'oppression, une figurine de plomb à abattre. Hélas, il y a encore des gens et des peuples pour ne pas connaître la vérité de l'Histoire. Que peuton faire pour eux ? Sinon malgré eux ? En attendant, qu'on le veuille au non, entre France et Espagne, entre Giscard et Franco, c'est ici une enclave, un Etat libre en Pyrénées !
- Comme l'Andorre...
Que n'avais-je pas dit là ! Je lui avais redonne du poil de la bête. Il éclata en vitupérations baveuses sur sa barbe :
-Les Andorrains ! Des marchands. Des outres à figues sèches. Des fils de contrebandiers entre deux frontières qui détaxent et détroussent en vendant du Pernod et des cigares à bas prix pour dévaloriser ceux du peuple cubain et sans souci pour la santé publique ! Des égoïstes sans la moindre culture politique qui bétonnent leur vallée pour mieux y ratisser les poches des touristes sans conscience internationale. Un furoncle de marchands à la jointure de deux impérialismes !
Il s'arrêta d'un coup, hébété, comme vide. Il parcourut d'un regard morne ses troupes mutiques, ses acolytes pétrifiés qui semblaient ne rien regarder, évitant de faire paraitre la moindre expression, sinon la soumission. Il se tourna alors vers mon voisin, un dénommé H... du moins, moi, Paul Duchêne, je n'avais pas retenu son patronyme - et lui demanda de prendre la parole :
- Oh, répondit-il avec hésitation, je suis un peu dérouté. Je ne m'attendais pas à ça... Je ne suis pas un communiste... Je ne fais pas de politique... Je ne sais pas trop ce que vous voulez... Je suis là pour apprendre la vie en communauté aux adolescents et favoriser leurs activités. Je vais voir. Laissez-moi le temps...
- Bien. Nous verrons, sembla se satisfaire D. Quant à toi, m'asséna-t-il dans son dernier sursaut d'énergie de la soirée, ce n'est que par égard pour ton camarade que je te laisse la possibilité de rentrer dans le rang. Dès demain matin, si tu veux, tu peux faire tes bagages, ça vaudrait mieux pour toi et pour la communauté !
Et sans transition, ils passèrent a des conciliabules sur l'organisation matérielle du camp, les transports et l'intendance, à des propositions d'ateliers qui paraissaient réglées et connues depuis toujours, bien que farcies avec des « si on », comme s'il s'agissait d'inédites et géniales trouvailles aux vertus pédagogiques initiatiques. De tout cela, je n'entendais guère. C'étaient des échanges à voix basse et qui ne m'étaient visiblement pas adressés. L'on ne parla pas un instant de montagnes. Où sont les montagnes, me criais-je en moi-même, pour me sauver avec le vert de leurs herbages et l'acuité de leurs roches, où sont la paix menaçante des névés et la boursouflure des orages que les crêtes font résonner ?
La réunion fut close sans cérémonie. Le traditionnel goûter du soir entre adultes n’avait vu passer que quelques croutes de pain et de fromage, méprisées à la fin des repas.
J'allai me coucher dans les affres de l'indécision. Partir ? Sans montagnes et sans argent, que ferais-je? Je craignais plus que tout de me voir revenir comme un chien battu chez mes parents, en août, dans une lointaine ville de plaine et de replaine. Rester ? Ma conscience politique comme il disait, n'était guère aiguisée, mais je me voyais mal jouer leur jeu de militants obsessionnels, tristes et revanchards, leur fiction dangereuse. Car je sentais bien que D. avait, sinon le pouvoir de virer manu militari, au moins celui de m'emmerder jusqu'à la lie.
/image%2F1470571%2F20230725%2Fob_6184f3_cezy-ossau.JPG)
Pic de Cézy, Vallée d'Ossau, Pyrénées-Atlantiques.
Photo : T. Guinhut.
Sur la carte, au-dessus du torrent du Valentin au nom charmant, la « Cola » était située au lieu-dit « d'Asperta », bastion en devers de la route et en travers de la gorge, nom que j'étais prêt à changer en Desperta, en Désespoir... Je m'endormis je ne sais comment. Me réveillai à la lueur du brouillard qui obscurcissait la fenêtre et le plafond si peu montagneux. À ma surprise, dès le café-tartines, fut négligemment acceptée ma proposition d'emmener un groupe d'adolescents enthousiastes édifier un barrage, un fort et un jardin zen plus bas dans le torrent, ce qui nous prit toute la journée, seulement coupée par un repas fruste et bourratif. Enfin la veillée chansonnettes, passa comme une fleur, au bon plaisir des adolescents et du mien, sans intervention aucune de D.
Il n'y eut pas de réunion du soir. Ce que j'avais craint m'accordait un sursis. Etait-ce, pour le Directeur D., la patience d'avant l'attaque ? Ou étais-je quantité si négligeable pour me laisser dans le jus de pluie menaçante et ne pas plus s'en préoccuper ? Je me disais lâchement qu'un orage évité était toujours ça de gagné et qu'en faisant le mort, le temps allait jouer en ma faveur. Mais surtout, curieusement, je n'y pensais pas plus que ça, dans une capacité de distance, d'insouciance qui m'étonne encore aujourd'hui. J'aimais mieux rire et bavarder avec les adolescents. Projeter avec eux des balades sur les cartes que je leur apprenais à lire.
Le lendemain donc, après que j'eus commencé avec les adolescents la construction d'une cabane dans un hêtre écroulé au-dessus de notre torrent avec barrage et jardin zen, j'attendais avec une poignée d'entre eux le repas de midi, sur l'esplanade, jouant avec une craie et cailloux à déplacer pour former le premier une ligne dans un carre aux huit triangles... D. me jaillit dessus :
- Qu'est-ce que tu fais ? Ce jeu débile. Quel est ton objectif ?
- Je ne comprenais rien. Je balbutiai. Alors que les gamins, discrètement choqués, s'écartaient.
- Tout animateur digne de ce nom doit soumettre toute action à un objectif. Es-tu si ignare que tu ne connais pas la pédagogie par objectifs ? La socialisation et l'apprentissage d'une technique collective !
Et, derechef, il éloigna sa barbe frêle et sa silhouette hésitante...
Encore un mauvais coup pour moi, me dis-je. Qu'est-ce que c'était que ces billevesées ? Alors que la passionaria languide aux cheveux noirs crépus, au nez camus, continuait placidement son atelier macramé, ses tortillages de ficelles et cordages pour exécuter de splendides créatures artisanales, dignes des plus tristes salles des fêtes soviétiques, suspensoirs à pots de fleurs, panier ventral pendouillant et autre hamacs et dessus de table, chefs-d'œuvre de l'ingéniosité humaine comme j' en avais vu dans une exposition de l'association France-URSS, clichés extenués d'art populaire pour propagande. Elle devait surement habiller la chose de concepts prétentieux tels que « découverte de l'artisanat populaire traditionnel » ou « initiation à la création manuelle »... Comme ceux qui derrière moi passaient leurs journées aux sports, ping-pong, volley et foot dans le seul pré plat, ces « éducations a la motricité et à l'esprit d'équipe », que je prenais plutôt pour enrégimentement, agitation fonctionnelle, empêchage de pensée singulière…
Aussitôt le dessert avalé, un ciel plus clair se levant soudain, j'embauchai un animateur pâle et timide autant que sa syntaxe, une tête aussi blanche qu'un poireau grêle, c'est tout ce que j'ai pu retenir de lui, puis une douzaine d'adolescents, pour une balade d'après-midi. Par la route, par des sentes qui en coupent les lacets, nous montâmes à Gourette, laide station de ciment, goudron et téleskis, pour accéder au sentier du lac d'Anglas. Lac que nous n'aurions pas le temps d'atteindre... Le petit bois de Saxe dépasse, le torrent franchi, nous étions lancés en pleine montagne, vallée torturée par les géologies du calcaire, mais point par l'homme encore. Même si nous eûmes le temps de nous étonner devant l'effilement de l'arête de Pène Sarriere, un défi de la roche au ciel un instant bleu, à l'équilibre, je sentais trop que j'étais au bout d'une laisse, celle du temps imparti par la rancune de la caserne ou l'on aimait tant les mots d'ordre et les injonctions, et où, je m'en rendais compte peu à peu, l'on ne faisait rien en fait.
Il n'y eut pas plus de réunion ce soir-là. Les bruits de randonnées à programmer restaient remis à cause d'une incertaine météo. Ou à cause de la flemme, de la léthargie grise des esprits, du ressentiment assagi...
Je restais deux ou trois jours à trainasser dans l'oubli de la hiérarchie absente, sous le ciel couvert ou pluvieux, à jouer à notre cabane de torrent ou à suivre les adolescents aux bistrots et boutiques des Eaux-Bonnes, pendant que le Directeur D emmenait tour à tour des groupes « en ville », en camionnette, à Laruns, pour les faire participer au projet d'intendance, excursions auxquelles je n'étais pas convié, et dont je ne souhaitais pas être.
Il fallait bien occuper pourtant des jours franchement pluvieux. Je ne pouvais les faire jouer à l'Indien sous le wighwam de fougères détrempées. II fallait bien s'abriter de l'averse dégoulinante dans l'abri de la caserne de tôle et de ciment. Usant d'une de mes passions d'alors, je lançai dans la cantine un atelier d'initiation à l'art abstrait. Qui marcha assez bien. Entrainant à barbouiller de l’abstraction lyrique et de l'expressionnisme abstrait une douzaine de gamins. Les œuvrettes nous parurent assez variées, colorées et réussies pour qu'on en scotche les feuilles sur le mur qu'ainsi chamarré j’appelai pompeusement « Galerie d'Art » sur un panonceau de carton. Les adolescents virent cette appellation comme le couronnement de leur fierté et attendaient de pied ferme l'arrivée des autres.
Quand D. entra, de retour de son escapade qui, prétendument, était destinée à chercher des lieux de camping, en fureur, et m'apostropha, quoique sans me regarder dans les yeux :
- Quoi ! "Galerie d'Art"? Tu veux faire le lit du système capitaliste, de l'art pour l’élite financière, de l'appropriation privée de l'art par des privilégiés au lieu de le rendre à tous ? Offrir aux mains rapaces de l'argent et de la spéculation des motifs décoratifs et vides de sens ? Non ! C'est à l'Etat communiste et collectiviste de permettre à l'art prolétarien d'être produit par tous et utile à tous...
Il sortit aussi rapidement qu'il avait surgi, comme s'il ne voulait pas se laisser le temps d'entendre ma réponse. Peut-être me serais-je tu. Pour ne pas plus irriter son ire, étrange puisqu'elle ne se portait plus vers moi que par intermittences, aussitôt retirée. Etait-ce incontrôlé ? Pensait-il ainsi mieux me blesser ? Ou mieux m'épargner? Quant au sujet de discorde, un de plus, je pensais à part moi que l'on savait à quel art officiel, à quel médiocre stéréotype la mainmise de l'Etat mène... Une fois de plus les ados s'étaient éclipses. Il n'en restait qu'un ou deux pour décrocher avec moi les œuvrettes que nous voulions protéger de la destruction, de la censure...
Ma mémoire, de cette semi-privation de montagne (elle était là et je n'allais pas à elle), de cette saynète sociale obligée, n'a finalement guère retenu. Des journées vides restent vides. Ma chance, peut-être, face à de tels obtus idéologues, heureusement dénués du pouvoir de nuire plus avant, était de les presque instantanément effacer par une incroyable et gamine faculté d'oubli, de considérer la montagne, même depuis la prison des fenêtres au-delà de la médiocre esplanade, d'examiner ses troncs, ses falaises, ses ciels bouchés et ses pluies. Sans compter ses innombrables, toujours changeants, ballets de vapeurs, averses, brumes et brouillards qui balayaient comme vanité le théâtre minable de notre colonie, même jeune, même communiste, même révolutionnaire. Finalement, D. et sa troupe, du moins l 'espérais-je, n'avaient pas assez de poigne pour châtier plus violemment mes dissidences et risquer ainsi de transgresser les lois du ministère et de l'Etat qui les payait.
Déjà, une semaine était largement passée. Sans qu'il se soit rien passé. Il n'y avait eu ni expulsion du gris purgatoire de D. ni haute montagne. D. continuait de passer parfois près de moi sans paraître me voir. Pourquoi si menaçant, si intransigeant, n'usait-il plus de son maigre pouvoir de roquet ? Etait-ce au fond un craintif, ou, retors, guettait-il l'occasion de me prendre réellement en faute et me tomber dessus ? Cependant, tout animateur ayant droit à une journée de congé par semaine, la chose fut vite réglée : il suffisait de s'inscrire sur un tableau après une informelle concertation avec ses pairs. La perspective de marcher enfin seul le lendemain dans et sur la montagne me faisait vibrer comme une comète... Jusque-là, promener sa viande molle autour du casernement des animateurs et ados, qui avaient déjà des habitudes de grand-père,refaisant les mêmes maigres trajets sans couper le cordon du camp, ne m'avait laissé qu'un goût de gris dans la bouche, sans le secret affolement du désir.
J'espérais une radieuse aurore pour ce jour de liberté. Hélas, la pluie avait pris en otage la montagne. Elle tenait aux branches comme par des menottes et ses lourds nuages encapuchonnaient les falaises comme des bures d'ascètes castrés.
Je n'allais pas m'avouer vaincu. J'engloutis le petit déjeuner en chaussures de montagne avant de voir l'œil étrange de D. considérer mon départ sous une pluie battante, sonore, tenace, qui me dégoulinait déjà du nez au menton et du menton au cou. J'avais vu de pires départs qui s'étaient ouverts sur l'éclaircie, du moins sur le silence des écharpes de brumes entrouvertes. Ou sur une magique neige estivale.
Par Gourette, plus laide encore sous le déluge qu'elle salissait, je montais, par prairies et sous-bois, faisant l'inventaire des flaques, rigoles, boues et rochers glissants, mousses aqueuses et feuilles spongieuses, écoutant la galopade ininterrompue des gouttes sur ma capuche, faisant gicler terre et eau dans la soupe du sentier. En deux heures, j'arrivai à la cabane de Bouy dont l'alpage courbe aurait dû largement dominer la vallée du Valentin et la microbienne colonie tout en se laissant survoler par les arêtes calcaires du Ger et les aiguilles des Quintettes au nom si musical, fabuleux. J'avais cru pouvoir entendre en la montagne un aérien et joyeux quintette de Haydn. Alors que je ne pouvais percevoir que le néant des gris, la collante et monocorde sonorité de la pluie universelle. Trois heures durant, a demi-abrite contre la cabane fermée, je restais à scruter l'attente d'un miracle qui ne vint pas. Je connaissais jusqu'à l'intime la mâche de la pluie, le fumet de la forêt, le crépitement des gouttes dans la pelouse. Touchant le grain particulier d'une roche mouillée, il n'y avait plus de mes sens que la vue qui restait frustrée. Même si l’expérience de transporter en marchant et autour de soi comme une grotte de brume ou n'apparaissaient que les premiers troncs, les seuls objets proches, semblait fort limitée, cette aventure me prenait toujours d'une sorte de joie de sanglier au tr avers de la gorge. Je préférais le goût rauque de cette goulée de montagne sur mes tartines à la cantine de la caserne.
Dans l’abri précaire de l’encoignure de la cabane d’altitude, je prêtai soudain attention à la froideur croissante de la pluie, à son évanescence lourde, à ses virevoltants duvets : il neigeait ! C’était ténu, le sol blanchissait à peine, par plaques. Il aurait fallu pouvoir bivouaquer là, trouver au matin la vue dégagée sur un cirque fluorescent de montagnes enneigées…
Je dus redescendre, rejoignant Les Eaux Bonnes par un sentier forestier adjacent, forant le nuage comme un geai. Dans la brumeuse et mobile cellule heureusement individuelle qui m'avait été allouée pour la route,je sentais l'animal, le cuir de chamois rebelle, le jus d'écorce et de bouillasse, le sperme en puissance, l’intellect d'homme libre...
(...)
Thierry Guinhut
Une vie d'écriture et de photographie
/image%2F1470571%2F20230725%2Fob_923990_aspe.JPG)
Haute vallée d'Ossau, Pyrénées-Atlantiques.
Photo : T. Guinhut.



/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_ab00ee_demanda-manquillo-neige.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9a1f1d_alano-passage-des-sierras.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_245dea_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_aa56f1_balces-canyon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_3e8179_trujillo-rocs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_705ca1_caceres-rocs.JPG)

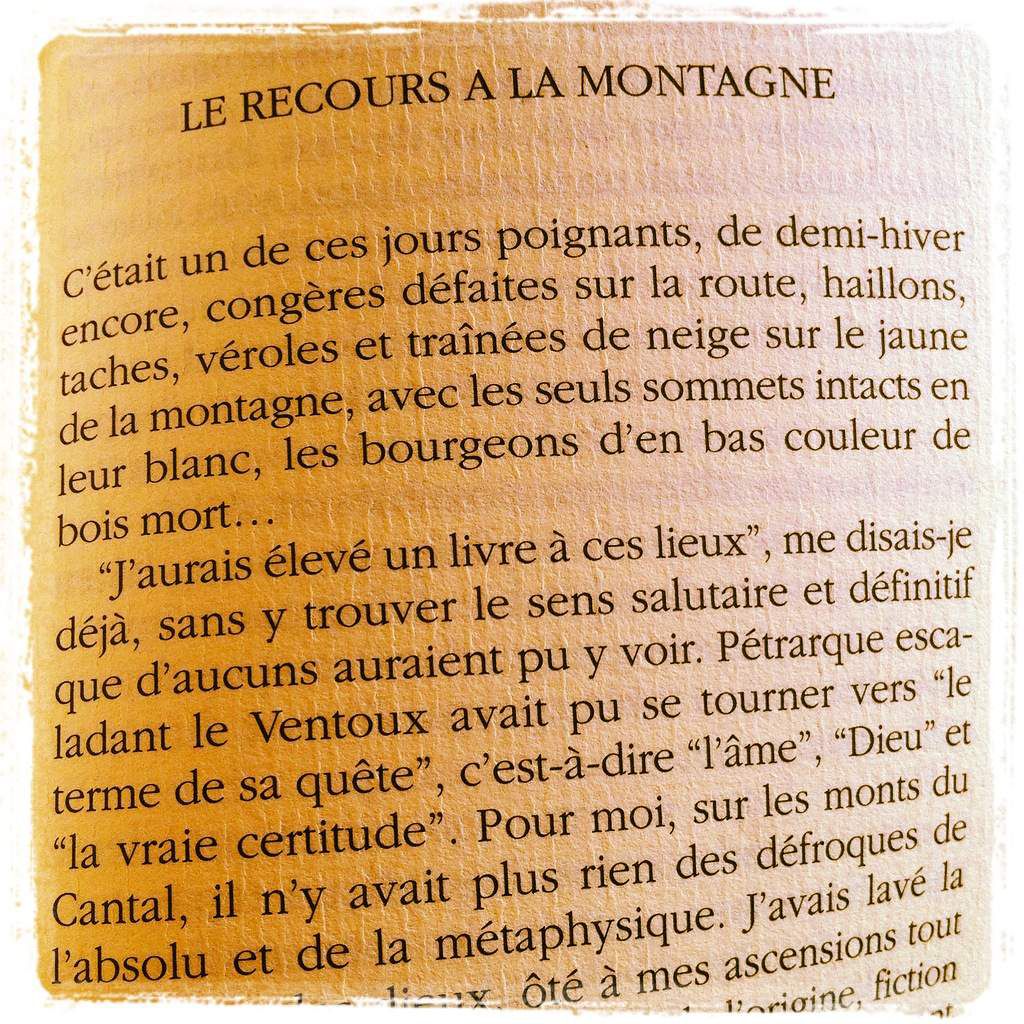


/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)
/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)
/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)
/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)


/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)


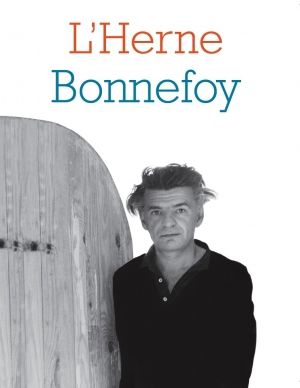
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)
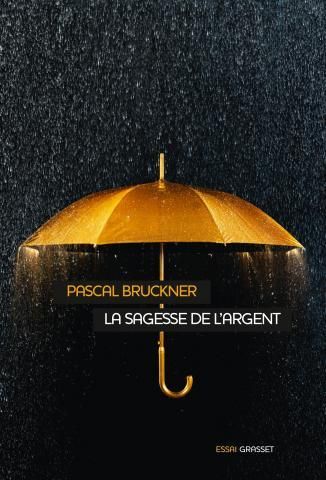
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)
/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)
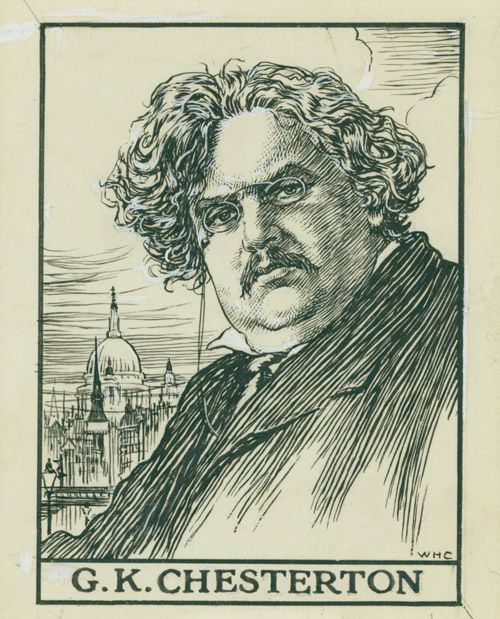

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)
/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)
/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)
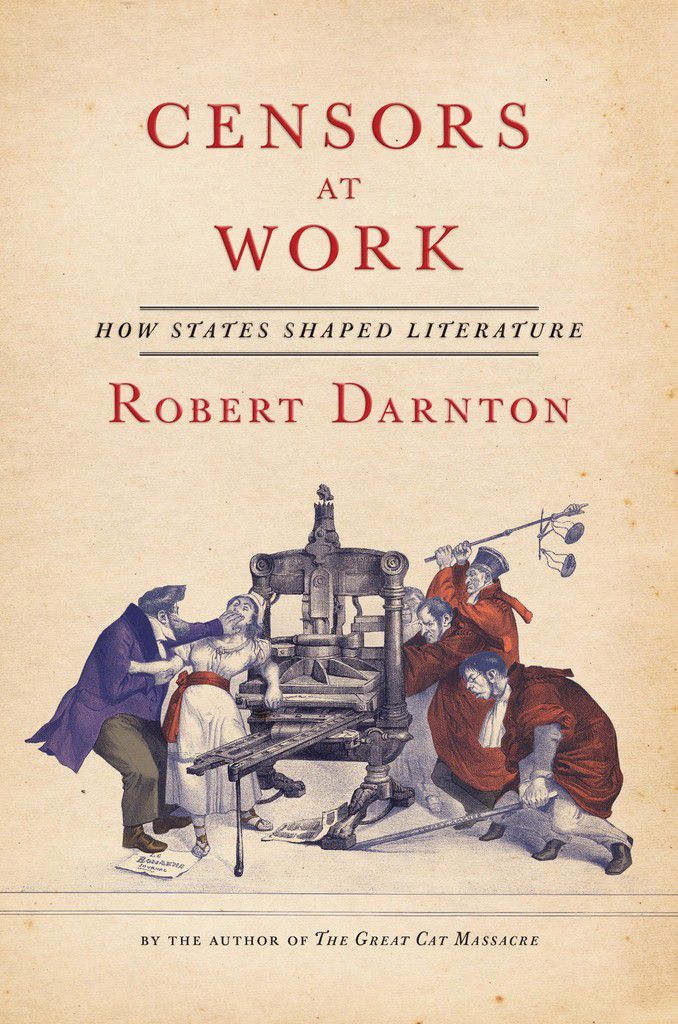
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)
/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)
/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

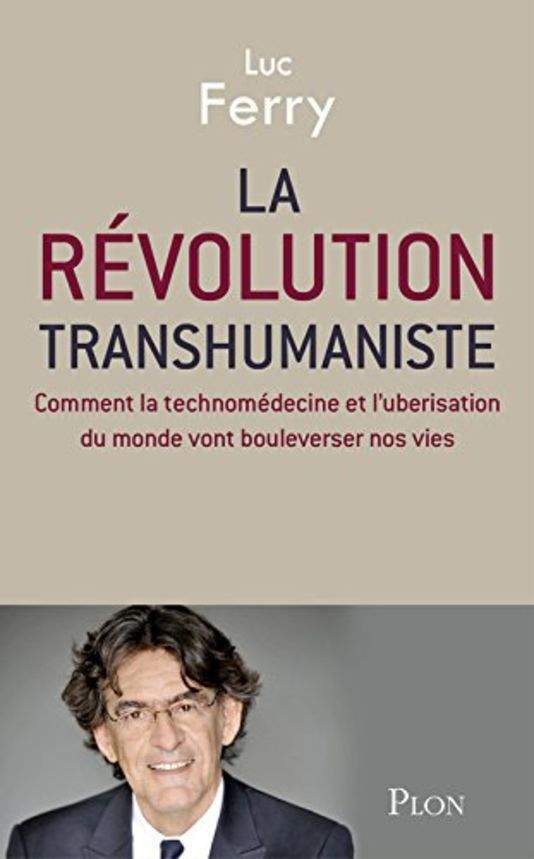
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)
/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)
/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)


/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)



/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)
/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)
/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)
/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)
/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)
/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)
/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)
/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)
/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)
/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)


/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)
/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)
/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)
/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)


/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)
/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)
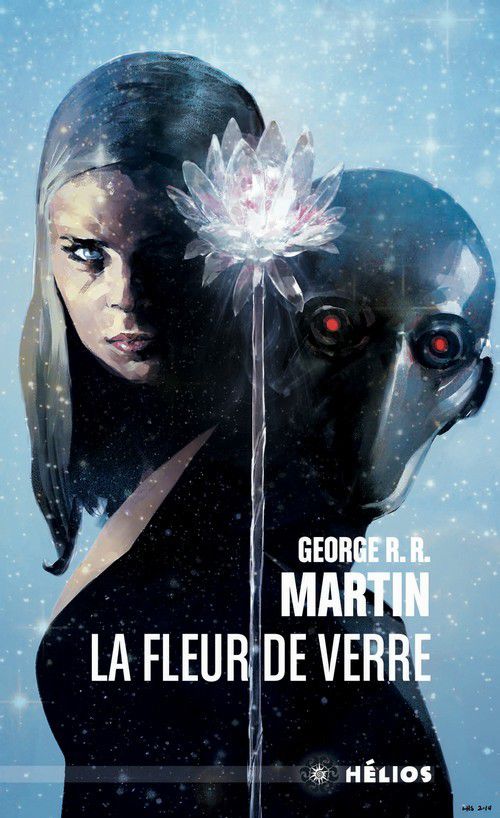
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)
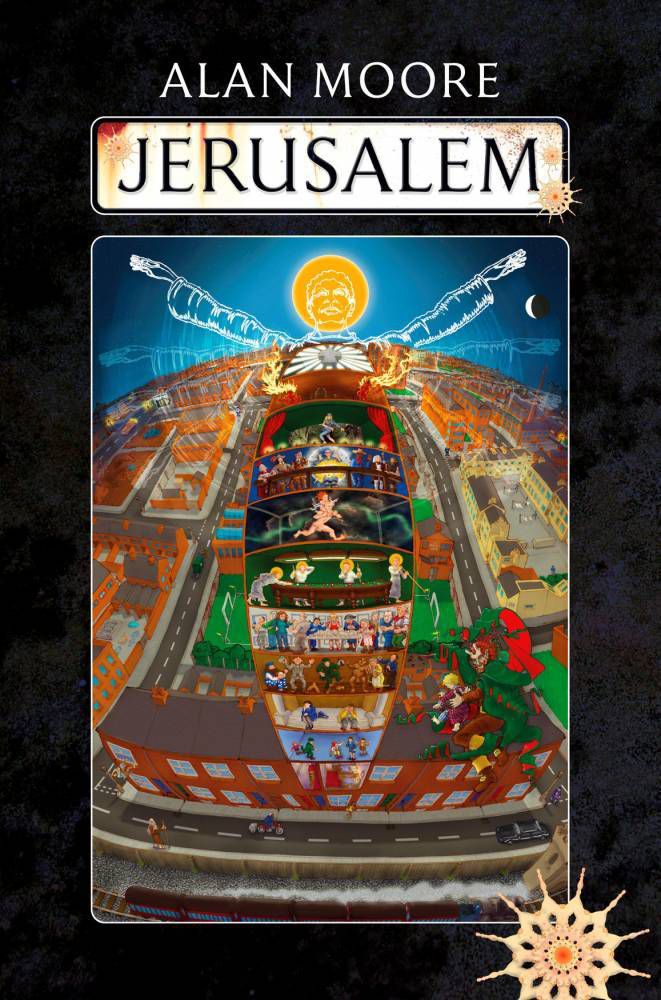

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)
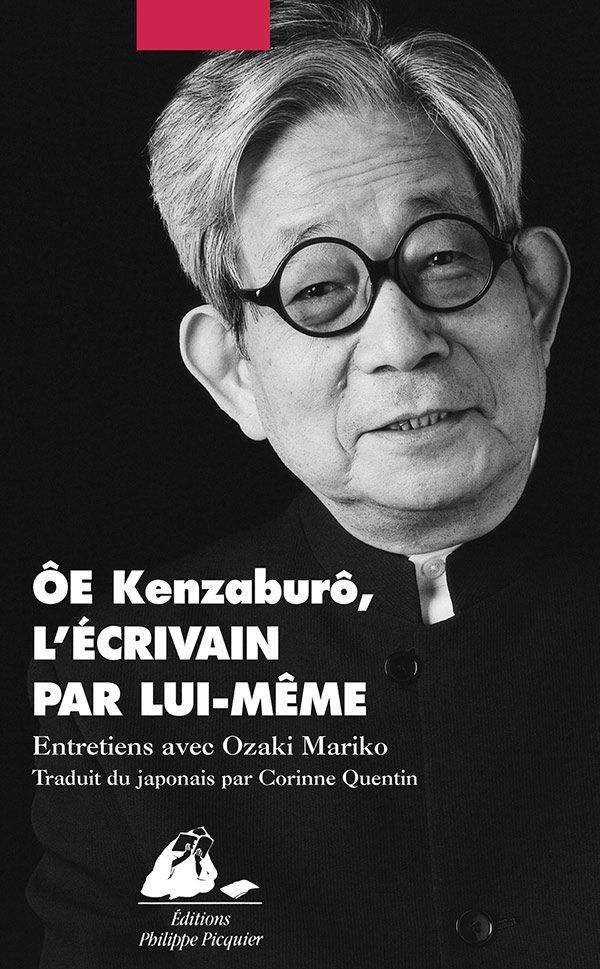
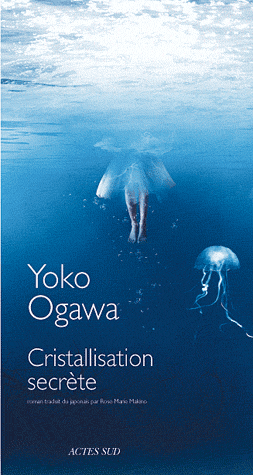
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)
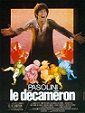
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)
/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)
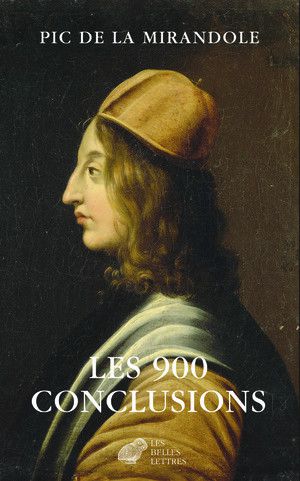
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)
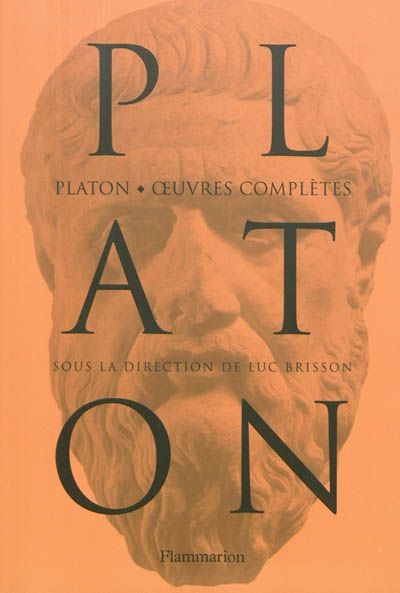
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)
/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)
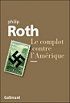
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)
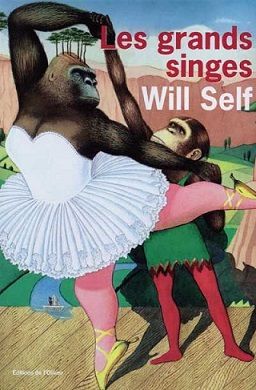
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)
/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)


/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)
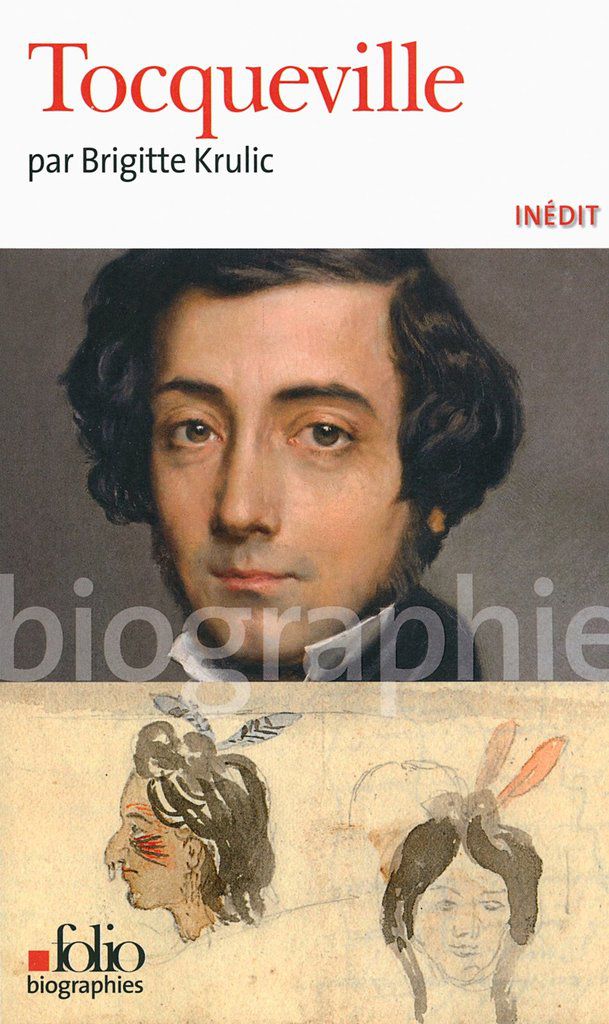
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)
/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

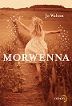
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)



/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)
/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)