
Playa de Luana, Cantabria. Photo : T. Guinhut.
Roberto Bolaño ou l’artiste devant le mal
De Nocturne du Chili à 2666...
Roberto Bolaño : Nocturne du Chili,
traduit de l'espagnol par Robert Amutio,
Christian Bourgois, 2002, 154 p, 15 €.
Roberto Bolaño : 2666,
traduit de l'espagnol par Robert Amutio,
L'Olivier, 2022, 1168 p, 29 €.
L'on pourrait ainsi grossièrement résumer nombre de romans de Roberto Bolaño : un groupe d’intellectuels, jeunes poètes enthousiastes ou critiques passionnés, se livre à la joie de l’art lorsque l’irruption du mal balaie leurs certitudes, voire leurs vies. Un régime fasciste brutal, un prêtre cultivé à l’innocence suspecte, un écrivain peut-être lié à une pléthore de meurtres de femmes… D’où vient le mal ? Qui est ce trouble génie ? Comment, au travers de ses chef-d'œuvres tragiques, Nocturne du Chili et 2666, lier roman de l’incertitude au roman en réseau ?
Il semble qu’avec le Chilien Roberto Bolaño la vérité soit définitivement inatteignable, « étoile distante » de la littérature et de toute pensée. Ses personnages sont des énigmes, et le narrateur est celui qui est le plus affecté par cette énigme. Et quels que soient les procédés employés pour cette connaissance - observation, analyse textuelle, enquête, témoignages, souvenirs ou introspection, ces « détectives sauvages » - la vérité des êtres soumis à l’attraction de la prose de Bolaño est toujours hors-jeu. On a beau mettre sur la piste d’un héros ou d’une héroïne un énorme cortège de témoins, comme dans Les Détectives sauvages où les deux tiers d’un roman de près de 900 pages sont une accumulation de choses vues et autres confessions de dizaines de protagonistes plus ou moins pertinents, rien de définitif n’est réellement révélé. Le récit, comme dans le roman Etoile distante, est une planète dont l’attraction est plus véritable que sa complétude : il paraît décrire un éternel et fabuleux présent puis explose comme une constellation qui ne serait que les débris de l’étoile inaugurale. Pire encore, le narrateur est lui même peu fiable, voire totalement fourbe, malgré son retour sur soi, sa conscience, ses remords. Car la conflagration du mal, dans 2666 ou Nocturne du Chili, a imposé sa trajectoire mystérieuse et cependant destructrice. Poètes et artistes nombreux prêtent leurs figures et leurs voix d’hétéronymes à un inaccessible Bolaño dans une œuvre aussi polymorphe que le continent sud-américain, pour, dans une interrogation éthique, dire combien l’artiste est une « étoile distante ». Examinons d’abord la vie et les ouvrages de notre auteur avant de s’attacher à ceux qui nous semblent les plus marquants…
Arrêté à vingt ans par les militaires de Pinochet, Roberto Bolaño passe, en 1973, huit jours en prison. D’où son goût pour les personnages traqués, clandestins, aux personnalités interlopes et schizoïdes… L’arrestation fondatrice est contée parmi Des putains meurtrières, récits à fort substrat autobiographique, où le père emmène son fils dans des boites à putes et jeux d’argent. Il ne peut que vomir devant l’impudeur du mal triomphant… Mais dans un monde où les frontières de la réalité et du fantastique sont parfois poreuses, les fragments d’un roman de formation sont intotalisables.


Cette arrestation lui laissa le souvenir du « typique nazi sud-américain » d’où viennent peut-être les silhouettes de La littérature nazie en Amérique. Essai ou fictions plausibles? En disciple de Borges, Bolaño concocte trente biographies, maisons d’édition et revues, toutes imaginaires, toutes liés par la fascination pour le nazisme, jusqu’à 2015 compris. Que penser de Mariluce idolâtrant Hitler, de « la fraternité aryenne » de Murchison le délinquant, du plagiaire nègre Max Mirebalais, chantant les races aryennes et Massaï, de Borda peuplant sa science-fiction de vaisseaux allemands, du Brésilien De Souza qui publie cinq « réfutations » des philosophes des Lumières… Pur délire, ou satire riche d’enseignements ? N’oublions pas que l’Amérique latine où se réfugièrent bien des nazis fut un vivier de dictateurs, et que le fascisme, pulsion totalitaire, est hélas « humain, trop humain » -sans vouloir inculper Nietzsche- quelque soit la couleur de peau. Ces écrivains sont des artistes, mais dévoyés…
Les quatorze vies ou auto-fictions d’artistes d’Appels téléphoniques appellent une mélancolie infinie, ou la compassion, sur des destins effilochés : l’amoureuse d’un acteur porno atteint du sida, l’écrivain que tue la disparition de son fils, des poètes ratés, suicidés. Sauf quand crier le mot « art », dans « Un autre conte russe », sauve la vie…
Après Anvers, polar de jeunesse spectral, éclaté en poèmes en prose, surgit Monsieur Pain, spécialiste es sciences occultes, qui approche le poète Cesar Vallejo mourant d’un incompréhensible hoquet, cependant éclot avec la victoire franquiste. Même révolte dans Amuleto qui raconte le massacre étudiant de 1968 à Mexico, vu par une Uruguayenne sans papier, enfermée treize jours dans un immeuble. Sans concession, elle juge ce pays qui se targue d’avoir connu la Révolution, l’a dévoyée ou plutôt l’a poussée jusqu’à sa fatale conséquence. Elle glisse dans la folie avec un chant d’amour et de bravoure qui est « notre amulette » et la preuve d’une confiance hallucinée en la mission de la poésie.
Critique féroce du fascisme, Bolaño avoue avoir longtemps cherché des partis de gauche, pour ne trouver au Chili qu’un rance réalisme socialiste, dominé par « le premier des écrivains nationaux, Neruda, patriarche machiste de type Fidel Castro ». Au milieu des poètes atteints de « néruditose », Bolaño est un beatnik inclassable, détective errant fasciné par les vies ratées et méconnues, qui fuit le Chili en 1974 pour le Mexique puis l’Europe, où il vécut en Catalogne jusqu’à sa mort prématurée en 2003. Dernier manuscrit confié à son éditeur, Le Gaucho insupportable bascule dans le fantastique, les changements de points de vue déstabilisent le lecteur. Le retour à la pampa entraîne à côtoyer des lapins féroces. Un moine aux pieds nus est admirable ou criminel. Une conférence sur littérature et maladie - celle qui conduira Bolaño, faute de greffe de foie, à la mort - est universitaire autant qu’épitaphe personnelle. Celle sur « Les mythes de Cthulu » est une charge contre les écrivains « glamour » aisément compris par leur public et qui visent succès et respectabilité. La polémique est au service d’une haute et libre idée de l’art, seul témoignage et feu d’artifice créatif qui outrepasse la mort du corps de l’auteur.
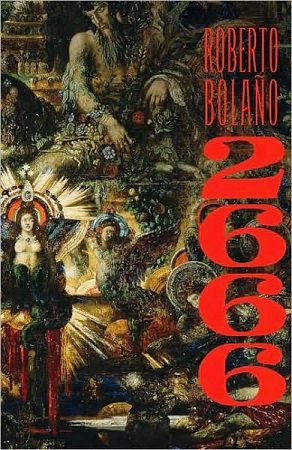
Dans Etoile distante, roman noir où prolifèrent les artistes, on ne peut pas rater l’aviateur Carlos Wieder, adulé par la junte chilienne, qui illustre ses « poèmes de fumée » de photographies des corps torturés par la dictature. Art immonde au point de faire vomir les généraux lors du vernissage ; appendice ou palimpseste de L’Histoire universelle de l’infamie de Borges. Quant à Lorenzo, né sans bras, homosexuel sous Pinochet, quel genre d’artiste peut-il être ? Romantique incorrigible, promis aux désillusions, au mépris, « il décida se suicider ». Après un plongeon avec une de ces vertigineuses accumulations du meilleur de la vie que l’on connaît à l’instant de la mort, il remonte pour « se métamorphoser en poète secret ». L’ « étoile distante » est-elle celle d’un art qui serait à la fois esthétique et moralement irréprochable ?
Les personnages, énigmatiques, fascinants et quelque part inquiétants, ont parfois plusieurs identités. Le jeune, beau et courtois poète d’Etoile distante, Ruiz Teagle, qui séduisit sans peine l’une de deux « jumelles monozygotes », Veronica Garmienda, est accueilli avec bonheur dans leur maison de campagne -où elles se sont réfugiées après le coup d’état de Pinochet- pour une soirée de discussions poétiques et peut-être d’amour avec Veronica, s’appelle en fait Carlos Wieder. Ce que l’on n’apprend qu’au moment où le narrateur veut bien nous le montrer en train d’égorger la tante des jumelles, puis nous laisser supposer qu’il est l’orchestrateur de l’enlèvement des deux poétesses. Ellipse et métaphore se conjuguent pour effacer ce que l’on peut ni veut dire : « la nuit ressort, tout de suite la nuit entre, la nuit sort, efficace et rapide. Et on ne retrouvera jamais les cadavres ». Sauf celui d’Angelica, dans une fosse commune. Hors la tragédie de la botte fasciste chilienne, ce sont ici les mobiles et les psychés pour le moins mystérieux des individus qui sont interrogés, sans guère de réponse, sans compter le rapport trouble entre la poésie et la violence politique… Comme dans Les Bienveillantes de Jonathan Littell, où la culture sophistiquée (mais peut-être kitsch pour reprendre l’argument de Georges Steiner) de Max Aue ne l’empêche en rien de devenir un gestionnaire du génocide nazi. Carlos Wieder, lui, est un poète qui écrit ses textes au-dessus des prisons et des cérémonies officielles du gouvernement militaire de Pinochet, parmi le ciel bleu et les nuages d’orages, en lettres de fumée avec son avion. Comment ne pas être dégoûté, comme le narrateur, par « l’océan de merde de la littérature », s’il ne s’agit que d’illustrer le mal ?
Naïvement « de gauche », « trotskistes » ou autres, les étudiants et le narrateur d’Etoile distante ne peuvent comprendre cette alliance entre culture raffinée et fascisme meurtrier. Ce qui ne les empêche pas d’être des admirateurs et prosélytes de Fidel Castro. Dans quelle mesure Arturo Bolaño est-il conscient de cette contradiction ? Si l’on en croit la façon dont on entend parler de Stein dans Etoile distante, il n’est pas tout à fait dupe : « Comment concilier dans le même rêve, ou le même cauchemar, le neveu de Tcherniakovski, le Juif Bolchevique des forêts du sud du Chili, avec les fils de pute qui tuèrent Roque Dalton, pendant qu’il dormait, et parce que ça convenait à leur révolution ? »
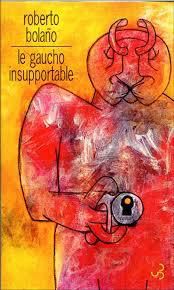

Quoi qu’il en soit, ses personnages sont pris dans le maelström d’une époque incompréhensible qui réveille les pires instincts, alors qu’ils continuent à croire dans la poésie, seule salvatrice peut-être, sous forme d’illusion romanesque. Les alter ego de Roberto Bolaño (dont Arturo Belano) sont d’éternels adolescents à qui le coup d’état de Pinochet à ouvert les yeux sur la laideur d’un réel qu’on à peine à accepter. Y compris dans la prison, le narrateur d’Etoile distante, lui aussi arrêté, ne veut voir que les instants les plus poétiques, comme le vol de cet avion qui écrit en lettres de fumées dans le ciel les premières phrases latines de la Genèse. Là encore une ellipse permet de refouler le non dit des circonstances trop laides et triviales de l’arrestation. Il y a toujours une « étoile distante » pour fixer la poésie au-delà d’un réel qu’on ne veut toucher qu’avec circonspection. En ce sens Bolaño est un romantique attardé, un errant, une figure de l’exil hors des terres à jamais ressassées et balayées d’une poésie qui est à la fois le pays natal, l’efflorescence estudiantine, la vocation des clubs de poètes, l’amour impossible des belles filles… Tout cela idéalisé, irrattrapable ; et seule l’écriture romanesque en forme de nostalgique poème en prose tournoyant permet d’en fixer la trace. La politique et la poésie prennent le personnage bolañien entre leurs serres pour ne plus le lâcher, le broyer. Et ceci à l’image de la désintégration du récit qui se produit après que la cassure Pinochet ou la menace de mort d’un souteneur aient dispersé les clubs de poètes qui rêvaient un avenir idéal, lorsqu’il se disperse en amas de particules narratives décousues, en quêtes de personnages disparus, comme dans Etoile distante et Les Détectives sauvages. A la découverte émerveillée des amitiés et des amours adolescentes -qui coïncide avec celle de la poésie et de la nébuleuse des poètes- succède la tragédie sans cesse effilochée de la perte, la dispersion des destinées fauchées, inabouties ou introuvables : « dans le triste folklore de l’exil -ou plus de la moitié des histoires sont falsifiées, ou ne sont plus que l’ombre de l’histoire réelle- ». Si l’on finit par retrouver Carlos Wieder, ou plutôt son fantôme gris en « poète barbare », en raté d’extrême droite qui « ne ressemblait pas à un assassin de légende », si par vengeance il est tué, son mystère reste toujours « aux étoiles chaque fois plus distantes »… L’indécidabilité et l’incertitude rongent et structurent le roman.
Il nous semble que les récits, nouvelles et romans, qui ne se situent pas au Chili (hors évidemment 2666) mais parmi les figures des chiliens exilés en Espagne, n’ont plus l’intensité qu’on serait en droit d’attendre. Mais leur mélancolie, à la limite de balzaciennes « illusions perdues » et du polar le plus noir, faite de destinées ratées, de coups foireux, de crimes sordides, d’ambitions clandestines et condamnées dans La piste de glace (l’un de ses premiers textes) n’est ni sans valeur ni brio. Son poète mexicain, veilleur de nuit sans permis de séjour, est évidemment bien plus qu’un personnage anecdotique : une métaphore de la condition humaine et une mise en abyme de l’œuvre entière de Bolano. De plus ces récits sont le nécessaire antipode d’un paradis perdu où la violence fasciste fut à la fois le serpent du jardin et le détonateur d’une prise de conscience, d’une réelle écriture.
Car l’écriture croise et mène un jour ou l’autre à la violence, comme dans Etoile distante, où l’écrivain, l’intellectuel Soto, pourtant heureux au Chili, croyant avoir « échappé à la malédiction », meurt sous les couteaux de jeunes nazis en gare de Perpignan, au retour d’un colloque : « Entre Tel Quel et Oulipo, la vie a décidé et a choisi la page des faits divers ». Lorsque Carlos Wieder finit avec son avion par écrire des poèmes sur la mort au dessus des officiers chiliens, lorsqu’il les invite à une exposition de photos des disparus, c’est comme si le retour du refoulé assiégeait les élites de tous bords, à moins qu’il s’agisse d’une ultime œuvre d’art à la fois conceptuelle et nazie. Au-delà des fictions pas si fictionnelles de La Littérature nazie en Amérique, le mal est donc au cœur de la problématique bolañienne, et nulle part ailleurs elle n’est autant accusée que dans Nocturne du Chili et 2666.


C’est ainsi que le prêtre Ibacache de Nocturne du Chili est lui aussi un poète de talent, un critique littéraire autorisé. Il a en quelque sorte deux responsabilités devant le monde : celle de l’artiste et celle de l’homme de Dieu. Et c’est aux portes de la mort qu’à usage intime, devant le lecteur ou devant Dieu, il rédige son autobiographie -il n’ose pas dire sa confession. Obsédé par un « jeune homme aux cheveux blancs », allégorie peut-être de la poésie saccagée par la dictature, il est en fait un narrateur retors et surtout peu fiable, qui peine -et il le sait- à convaincre de son innocence. Certes, il n’a pas les mains directement tachées de sang, mais sa conscience le ravage : sans jamais vraiment glisser dans l’introspection, sa plaidoirie est un mea culpa qui ne dit pas son nom. Car « le Chili tout entier s’était transformé en arbre de Judas ».
Ornement des soirées cultivées de l’épouse d’un tortionnaire dont la maison est un « centre d’interrogatoires », et qui cache ses victimes dans les dédales de la cave, à quelques pas des mondanités élégantes, le prêtre de Nocturne du Chili va devoir enseigner le marxisme à Pinochet et ses généraux. Ce qui donne lieu à des scènes surréalistes pendant lesquelles il donne une série de cours à des militaires impavides ou sommeillants. Le plus attentif est le Général Pinochet lui-même qui lui fera ses confidences : « Pourquoi croyez-vous que je veux apprendre les rudiments élémentaires du marxisme ? me demanda-t-il. Pour servir la patrie du mieux possible. Exactement, pour comprendre les ennemis du Chili, pour savoir comment ils pensent, pour imaginer jusqu’où ils sont prêts à aller ». Le devoir de vérité du serviteur d’Orphée et de Dieu est bafoué : « Peu à peu, la vérité commence à remonter comme un cadavre ». Parmi ces incarnations faussement idéalistes et finalement souillées par le déchaînement d’une « tempête de merde », quelle est la place du poète et de la vérité dans le contemporain ? Le mal n’a-t-il pas contaminé les meilleures intentions ?
/image%2F1470571%2F20220616%2Fob_795b3b_bolano-2666-olivier.jpg)
Le pire, le plus fabuleux est encore à venir. Bolaño fut surpris par la mort alors qu’il peaufinait encore les mille pages aux cinq parties de 2666, titre renvoyant au chiffre du diable. Quatre professeurs de littérature venus de pays divers s’enthousiasment pour l’œuvre de Beno von Archimboldi, mystérieux écrivain allemand dont la souterraine réputation va croissant. Un ménage à trois parmi le quatuor, un pèlerinage à Santa Teresa, au Mexique et à deux pas des Etats-Unis, sont quelques unes des étapes de cette quête de l’écrivain génial, sorte de Pynchon insaisissable. On découvre qu’en ce lieu frontière ont eu lieu nombre de crimes atroces : des centaines de femmes, parfois adolescentes, violées et torturées. Dans quelle mesure l’écrivain allemand est-il lié à cette série noire ? Voilà qui permet à Bolaño d’opérer un va et vient vertigineux parmi l’Histoire de l’Europe et des Amériques. Sillonnant les ruines de la civilisation et de la culture - car Archimboldi écrit entre souvenirs du nazisme et son oubli - l’écriture n’est-elle qu’un simulacre de salut et de transcendance ? Ce sont encore des passionnés de littérature, parmi lesquels des intellectuels latino-américains (dont son traducteur, Amalfitano) souffrant de l’annihilation des grands idéaux, partis à la recherche d’un artiste mythique qu’on ne saurait croiser sans rencontrer le mal. Au cœur du livre, voici le cimetière du roman : la litanie des « crimes » propose une énumération insoutenable des mortes -parfois assommante il faut l’avouer- de leurs vies plus ou moins sordides entre pauvreté, corruptions, machismes et espoir d’une condition meilleure. On peut avancer que la création littéraire, comme la création originelle, révèle une fois de plus sa face cachée, sa matière noire : cette pulsion de meurtre qui est le moteur de l’Histoire autant que des histoires. Car la mort est peut-être le plus éblouissant versant obscur de la vie, du moins pour un écrivain comme Bolaño qui a vu de près un des totalitarismes du XX° siècle à l’œuvre et qui, de plus, écrit en sachant combien la maladie le ronge. Derrière tout cela, un narrateur perfidement omniscient joue à dissimuler ses atouts maîtres : Archimboldi lui-même, Roberto Bolaño ou son double, ou l’écriture de la création toute entière…
Œuvre ouverte, au sens d’Umberto Eco, 2666 réunit donc cinq parties que l’auteur pensa un moment publier séparément. Heureusement, son éditeur et ses ayant-droits, comme Max Brod désobéissant à Kafka, n’hésitèrent pas à publier d’un seul bloc ce monstre plus mystérieux que Moby Dick. « La partie des critiques », celles « d’Amalfitano », « de Fate », « des crimes » et enfin celle « d’Archimboldi », au premier regard disjointes, ont un « sens caché » : la ville de Santa Teresa, centre de l’archipel des assassinats et cachette probable de l’écrivain Archimboldi, lui même fait des pièces de son passé et des ajouts de ses créations, comme le suggère l’allusion au peintre. Evidemment, il s’agit d’un pseudonyme : c’est un jeune criminel de guerre qui a découvert la littérature à travers un manuscrit trouvé sur le front russe. Il « a tué un assassin de Juifs » et devient portier de bar avant d’écrire des livres auxquels croit, malgré leur peu de succès, son éditeur, Bubis, jusqu’à ce qu’ « une lecture marginale, un caprice d’universitaires » le comptent parmi les grands de la fiction allemande. Amant d’une femme qui mourut de la tuberculose en Bavière, jardinier incognito à Venise, amant occasionnel de la splendide Madame Bubis, anachorète en Grèce, il reste introuvable, sans cesser de publier. Le lecteur le reverra dans une maison des « écrivains disparus », puis peut-être à Santa Teresa où son neveu, comme lui évidemment d’origine allemande (« un type énorme, très blond ») est emprisonné pour avoir tué quatre femmes, sans que l’on sache s’il est le véritable assassin en série ou seulement l’un d’entre eux, sinon un innocent. Archimboldi ne va-t-il le voir que pour respecter le vœu dernier de sa mère, enquêter et l’innocenter, ou pour se disculper d’on ne sait quel péché originel ? A moins qu’il s’agisse d’écrire un nouveau livre au plus près du vortex tragique…

Le roman de l’incertitude se double alors d’un roman en réseau. 2666 contient cinq histoires aux liens d’abord invisibles, mais bientôt elles apparaissent comme « des histoires qui maintenant tournent autour d’un centre gravitationnel chaotique », des livres « avec leur propre unité, mais fonctionnellement reliés par le dessein de l’ensemble ». Si Amalfitano lit cette dernière phrase sur la jaquette d’un Testament géométrique, ne doutons pas qu’il s’agit d’une mise abyme due aux bons soins de Bolaño. « Cela transformait un récit barbare d’injustices et d’abus, un hululement incohérent sans début ni fin, en une histoire bien structurée où il y avait toujours la possibilité de se suicider. » Pourtant, pour Fate, journaliste noir qui porte le nom du fatum et qui n’aura pas l’autorisation d’écrire sur les crimes, « la beauté c’est le sacré, une femme belle et jeune aux traits parfaits ». Ainsi les viols mortels sont des profanations contre le sacré, contre l’art, contre « l’esprit voué à la création, à l’unique vérité transcendante de la vie, cette vérité qui crée plus de vie et encore plus de vie, une abondance inépuisable de vie, de joie et de luminosité ». Le meurtre travaille en réseau avec les vies et avec l’écriture des critiques et de l’artiste Archimboldi : « Personne n’accorde d’attention à ces assassinats, mais en eux se cache le secret du monde. » Un monde où « tout est livre brûlé ». De plus, le genre policier paraît se laisser prendre dans les filets de Bolaño, avant qu’il soit bafoué par l’effilochement des enquêtes. Une sévère déception du genre barre l’accès à la solution même si elle paraît suggérée lorsqu’une femme influente mobilise tous ses moyens avant de se heurter au mur de la corruption…
A Santa Teresa donc également piétine l’enquête des critiques qui ne pourront trouver Archimboldi… Pauvres critiques qui rêvent encore de découvrir ce que nous connaissons: la biographie cependant incomplète de l’écrivain… De fait, c’est moins Archimboldi que le mystère de l’art qui reste inconnaissable en même temps que celui du mal. N’en doutons pas, ils ont partie liée. Mis à part les titres, on ne sait presque rien des romans « obscurs » de l’écrivain qui aimante 2666. Non que Bolaño et son narrateur presque omniscient soient incapables d’imaginer une myriade de situations et d’intrigues, mais par volonté de seulement frôler le mystère fascinant de la nébuleuse de l’écrivain génial et introuvable qu’il aurait peut-être aimé être. Seul Le Roi de la jungle révèle un peu de son contenu. La sœur d’Archimboldi à la surprise d’y « lire une partie de son enfance » et de pouvoir ainsi le revoir. Que restera-t-il d’Archimboldi ? L’ironie du sort lui fera rencontrer le petit fils d’un écrivain qui ne sera passé à la postérité que pour avoir laissé son nom à une « glace aux trois parfums »…
/image%2F1470571%2F20220616%2Fob_e20761_bolano-2666-anagrama-gris.jpg)
/image%2F1470571%2F20220616%2Fob_96fd73_bolano-2666-adelphi.jpg)
Les personnages de Bolaño se cherchent, ne rencontrent qu’un autre ou le vide. Reste au lecteur de 2666 à reconstituer la puzzle des vies et de l’art en assemblant s’il le peut les cinq parties. « Thanatos » passe et prend. Restera-t-il à Archimboldi le temps d’écrire le final qui les couronnerait ? Pour notre romancier, qui n’en avait nullement l’intention, il n’est pas resté de temps, la greffe du foie attendue n’a pu venir. Le mystère fascinant de ses livres reste entier. Même son double, Archimboldi, semble écrire des livres lacunaires. Il n’y a que des livres lacunaires pour dire le secret de l’homme et de l’univers. Est-ce cela le mal incarné dans Nocturne du Chili et 2666 ?
La crise des modèles (la figure fasciste, le poète socialiste, sans compter hélas l’écrivain de l’Aufklarung - pour reprendre la thèse de Peter Sloterdijk -) accompagne à la fois le paradigme de la quête qui charpente l’œuvre et l’épuisement du roman policier qui la disperse dans une mélancolie baroque et macabre. Le récit est écartelé entre un réalisme poétique et un surréalisme vénéneux truffé de culture, ce qui le rend infiniment séduisant. Parodie et pastiche, détournement et satire, ellipses, changement impromptu de registre et de narrateur, concourent à faire de Bolaño un écrivain aussi polymorphe qu’ambitieux. Servi par une technique narrative impressionnante, il n’hésite ni devant les digressions absurdes, ni devant des passages apparemment banals qui télescopent d’immenses phrases bourrées jusqu’à la gueule de trésors stylistiques, pulvérisant les temps, dans une sorte de modernité baroque et gothique. La capacité d’inventer des bibliographies fabuleuses et secrètes, les énumérations démentes et fantaisistes font partie de cette dette assumée venue de Borges, sans compter ce regard sur le réel et ses êtres quotidiens peut-être venu de l’Argentin Juan Carlos Onetti. Mais à Roberto Bolano seul, appartiendra toujours cette voix immense, pleine d’émotion mais aussi de force, malgré le monde brisé dont il tente de rassembler la cohérence dans autant de romans soumis à implosion ou explosion, comme une de ces naines brunes qui entachent l’univers de leur cruauté et de leur beauté. La tentation du romanesque paraît s’emballer, puis se décevoir dans une inaction qui n’a ni solution, ni au-delà, sauf dans le fantasme poétique. La création déborde le questionnement éthique. Comme si, toujours, parmi ses multiples avatars, l’œuvre d’art, autant que l’artiste, restait une « étoile » que le mal a rendu à jamais « distante ».
Thierry Guinhut
Une vie d'écriture et de photographie
Etude publiée dans L'Atelier du Roman n° 59, septembre 2009.
Nota bene : Les livres de Roberto Bolaño sont publiés par Christian Bourgois,
à l’exception de Monsieur Pain et de Amuletto par les Alllusifs.
Les œuvres complètes sont en cours de publication aux éditions de L'Olivier.
Roberto Bolano : Entre parenthèses
Roberto Bolano, le chien romantique

Val Ferrara, Pallars Sobira, Catalunya. Photo : T. Guinhut.
commenter cet article …



/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)
/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)
/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)
/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)


/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)



/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)
/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)


/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)
/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)
/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)
/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)
/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)


/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)
/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)
/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)


/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)



/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)
/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)
/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)
/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)
/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)
/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)
/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)
/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)
/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)
/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)


/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)
/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)
/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)
/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)


/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)
/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)


/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)
/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)
/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)
/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)


/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)
/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)



/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)
/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)