/image%2F1470571%2F20240308%2Fob_8abef0_tours-paysage-avec-ruines.JPG)
Herman Van Swanewelt : Paysage avec ruines, 1604.
Musée des Beaux-Arts, Tours, Indre-et-Loire.
Photo : T. Guinhut.
Thierry Guinhut
Faillite et universalité de la beauté,
de l’Antiquité à notre contemporain.
La Mouette de Minerve éditeur,
mars 2024.
Depuis le beau platonicien, il semble qu’une avalanche, une décadence, puissent être observées, voire diagnostiquées. Pour qu’aujourd’hui n’en restent que le souvenir muséifié, les éclats, voire la parodie, jusqu’à sa disparition nimbée de mépris dans l’Art contemporain. L’idéale sérénité de la beauté, donc les Grecs assuraient l’universalité, n’a plus qu’un rire tragique, dont le masque est attaqué, délavé, arraché, par la laideur, la vulgarité, le consumérisme et l’égalitarisme. Comment s’est opérée cette catastrophe esthétique ? Comment touche-t-elle l’obsolescence de la peinture, la figure même de l’artiste, livrant une image inquiétante de notre temps ?
Suite à l’irruption du sublime, de l’esthétique des ruines, des pierres et du cosmos, de l’usage signifiant de la mode, des couleurs, puis de l’Art Brut, d’autres avatars de la beauté ont surgi, à l’instar du beau photographique. Cependant, malgré la propension à souiller les icones dans l’Art contemporain, le tapage de la mocheté et du mauvais goût, témoins d’une inversion des valeurs, qui sait s’il reste la possibilité d’un dandysme inédit… À cette dégradation de la beauté plastique, sans oublier celle du langage, faut-il accoupler celle morale, lorsque les idéaux de La République de Platon se changent en monstres politiques, utopie devenue dystopie…
L’essai de Thierry Guinhut, entre esthétique et philosophie politique, tente d’apporter des perspectives originales, s’appuyant sur une judicieuse bibliographie, consultant maints jalons de l’Histoire de l’art et de la pensée, au service d’une conscience de notre temps.
/image%2F1470571%2F20240306%2Fob_3bce86_7-minerva-calahorra.JPG)
Minerva Pacifica, Museo Romano, Calahorra, La Rioja.
Photo : T. Guinhut.
Après une maîtrise en Histoire de l’Art Contemporain, Thierry Guinhut,
qui vit en Poitou, devient Agrégé de Lettres Modernes.
Critique littéraire, il a publié un roman, Voyages en archipel,
les récits du Recours aux monts du Cantal.
Photographe, son Marais poitevin fut couronné
par le Grand prix Hippolyte Bayard de Photographie 1991.
Après ses albums sur l’Ile de Ré, les Pyrénées et le Haut-Languedoc,
ce sont deux romans philosophiques :
La République des rêves (L'Harmattan, 2023),
ou la formation d'un artiste photographe parmi la société aquitaine,
des paysages au cosmos, en passant par l'éros :
Muses Academy (La Mouette de Minerve, 2023),
ou l'irruption des Muses de l'Antiquité grecque
au service la téléréalité contemporaine
et au moyen d'un concours de récits criminels :
/image%2F1470571%2F20240306%2Fob_7a2b98_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)
I Faillite et universalité de la beauté, de Platon à l’Art contemporain
II L’irruption esthétique : japonisme et arts premiers
III L’Art contemporain est-il encore de l’art ?
IV De l’iconologie de Panofsky au Banquet de Gérard Garouste
V Décadence, obsolescence, effervescence de la peinture
VI L’image de l’artiste, de l’Antiquité à l’Art contemporain
VII Cosmos de littérature, de science et d’art
VIII Peintures et paysages sublimes
IX L’esthétique des ruines
X De la beauté cachée des pierres
XI Des théories du portrait au portrait comme fiction
XII Histoire esthétique et philosophique de la mode
XIII Du beau photographique
XIV Sens et valeurs des couleurs de l‘Occident
XV Éloge du noir et blanc ; ou le beau n’est-il que coloré ?
XVI De la beauté politique aux couleurs des monstres politiques
XVII Beau religieux et désacralisation versus théocratie
XVIII Art brut et beauté brutale
XIX Piss Christ, une icône souillée
XX Laideur, mocheté, mauvais goût
XXI De la vulgarité langagière au règne du langage
XXII Éloge du dandysme
Conclusion. Ou la mémoire de l'avenir
Sonnet des peintres
448 pages, 35 photographies couleur, 22 €.
/image%2F1470571%2F20240306%2Fob_48f7b8_93-babou-flaran.JPG)
Christian Babou, Abbaye de Flaran, Gers.
Photo : T. Guinhut.
I
Faillite et universalité de la beauté,
de Platon à l’art contemporain.
Il semble évident que la beauté puisse être celle des visages et des corps, de la nature, de l’œuvre d’art enfin. Qu’elle soit une parfaite utopie visible, épargnée, comme le pur regard d’une Aphrodite, y compris si sa joue fut brisée par le temps. Mais au-delà d’un modèle abstrait ou classique, n’y-a-t-il pas cent beautés variées, dépendantes des époques et des cultures, de la perception plus que de l’objet, voire contradictoires ? Pire, avec l’explosion planétaire de l’art contemporain, elle est conspuée, évacuée, niée. Est-ce à dire qu’il faille la rayer de notre vocabulaire, en décrier la prétention platonicienne et universaliste ? À moins que notre capacité à recevoir et conceptualiser le beau mérite d’être étendue, remodelée…
L’affaire paraissait entendue avec Platon : le beau, le bien et le vrai sont équivalents, l’en soi esthétique est en conséquence un en soi moral. En-deçà et au-delà de l’humain, comme les mathématiques, la beauté est aussi éternelle qu’universelle, reposant sur des critères inatttaquables : la complétude, la symétrie, la justesse des proportions, la clarté, la puissance du sublime et la délicatesse de l'expression. De même son pouvoir de persuasion est irrésistible : « Les hommes, ceux du moins qui sont beaux, ô Hippias, comme toutes les décorations, les peintures ou les sculptures, charment nos regards lorsqu’ils sont beaux […] Le beau est ce qui plait par l’ouïe et par la vue[1]. » Or la polysémie du terme est vaste : il s’agit aussi d’un avantage, d’une honnêteté, d’une distinction, d’une gloire… Il ne faut alors pas douter que le beau soit dans l’objet et non dans la perception. Beauté des corps, des discours et des actions, des âmes, confluent dans l’idéalité du beau en soi. Non sans compter la splendeur du cosmos, d’où vient tant étymologiquement que conceptuellement notre cosmétique moderne, et son au-delà des orbes célestes, tintant de la musique des sphères et résonant de transcendance, où l’impalpable essence du Beau, comme l’Être, ne peut être contemplée que par l’intellect, « ce pilote de l’âme[2] ». Bien sûr, plus bas en notre caverne, le beau s’oppose radicalement au laid, au difforme, au vil, au déshonorant.
Même si plus réaliste, Aristote dans sa Poétique confirme combien le beau est à l’image du vrai : l’artiste imitateur doit chercher le vraisemblable et non le monstrueux. La représentation, pour être belle, doit faire tendre son sujet vers son propre idéal, vers son tèlos réalisé : « Les auteurs de représentations représentent des hommes qui agissent ». L’artiste, peintre, poète ou dramaturge, procure du plaisir à l’amateur « en raison du fini de son exécution, de ses couleurs[3] ».
Au cours du Moyen Âge, le beau reste transcendantal, quoiqu’en cohérence avec le christianisme. De la beauté de la création divine à celle de l’homme et de la musique, proportio, integritas, claritas restent les critères indéfectibles que reconnaît Thomas d’Aquin : en cohérence avec un « ordre théologique de l’univers, une fois passée la crise des alentours de l’an Mil, l’esthétique devient philosophie de l’ordre cosmique[4] ». Cet humanisme de l’intemporel sera cependant infléchi par la mise en retrait du théologique et le regain du platonisme.
Lors de la Renaissance italienne, Leon Battista Alberti privilégie le beau, alors que « circonscription, composition et réception des lumières sont complémentaires en peinture », là « où les hommes représentés montreront avec force les mouvements d’âme qui les animent[5] ». L’inspiration néoplatonicienne et le culte du nombre d’or nourrissent de surcroit cette Renaissance. La lecture de Plotin est alors fondamentale, grâce auquel le monde des idées ne se sépare pas du visible. Cependant, chez ce dernier, l’objectivisme du beau se voit contré par sa dimension spirituelle : la forme ne suffit pas sans l’ascèse de l’œil intérieur qui voit « cette beauté de l’âme bonne ». Plotin ordonne : « ne cesse pas de sculpter ta propre statue, jusqu’à ce que l’éclat divin de la vertu se manifeste », afin de devenir « une lumière sans mesure […] Que tout être devienne d’abord divin et beau, s’il veut contempler le Beau et le Divin. […] En tous cas, le Beau est dans l’intelligible[6] ». Pour l’âme, la laideur, qui « la souille, la rend impure et y mélange de grands maux[7] », est l’exacte antithèse. Ce pourquoi Umberto Eco aura beau jeu de consacrer deux volumes encyclopédiques opposés, et cependant accolés, à l’Histoire de la beauté[8] et à l’Histoire de la laideur[9]. L’on retrouve encore une telle opposition à l’occasion d’un romancier allemand du XIX° siècle qui sut allier la tradition de l’esthétique classique et le romantisme, Adalbert Stifter : « rien, dans l’art, n’est absolument laid aussi longtemps que c’est une œuvre d’art, en d’autres termes, aussi longtemps que cela ne nie pas le divin mais aspire à l’exprimer[10] ». Ce qui pousse à penser que la perte de la foi en Dieu puisse entraîner une dégradation de l’art, condamné à se déjuger…
De même, dans la tradition du beau et du bien platonicien, Adam Smith, au XVIIIème siècle continue à faire l’éloge de « la beauté attachée au gouvernement civil du fait de son utilité », ce dans sa Théorie des sentiments moraux[11]. Le beau esthétique doit confluer en un beau politique.
De longtemps cette conception d’origine platonicienne perdure. En témoigne ce qui est probablement le premier essai d’esthétique en tant que tel, celui du Père Yves-Marie André, simplement intitulé Essai sur le beau, publié en 1760. Il y différencie le beau visible et celui audible, selon deux des cinq sens qui lui permettent l’accès, tout en assurant qu’il est indépendant du sentiment. Est-il absolu ou relatif, « suprême, qui soit la règle & le modèle du beau subalterne que nous voyons ici-bas » ; dépend-il du caprice des hommes, de l’opinion & du goût » ? Voici sa réponse : « je dis qu’il y a un beau essentiel, & indépendant de toute intention, même divine, qu’il y a un beau naturel, & indépendant de l’opinion des hommes ; enfin qu’il y a une espèce de beau d’institution humaine, & qui est arbitraire jusqu’à un certain point ». En sus du beau sensible et du beau intelligible, il convient qu’il y a « un beau essentiel, & indépendant de toute institution, qui est la règle éternelle de la beauté visible des corps », s’appuyant sur « la régularité, l’ordre, la proportion, la symétrie », soit une « géométrie naturelle[12] », bien dans le fil du classicisme.
En 1841, Vicenzo Gioberti se montre plus prudent : « le Beau est un je ne sais quoi d’immatériel et d’objectif qui frappe l’esprit de l’homme et l’attire avec ses charmes», tout en concluant indéfectiblement : « le Beau est inséparable du bien et du vrai[13] ».
Sauf que l’on pourrait s’interroger : le beau est-il dans les choses, ou n’est-il qu’un sentiment moral ? Ce à quoi répond Emmanuel Kant, pour qui le seul attribut véritable du beau est le sentiment esthétique et non la propriété de l’objet observé. De plus, en rupture avec le platonisme, il affirme qu’il « n’y a et ni ne peut y avoir aucune science du beau et que le jugement de goût n’est pas déterminable par des principes[14] ».
Cependant les critères permettant de définir le beau, depuis essentiellement la statuaire grecque et ses Aphrodite, jusqu’à l’époque classique, restent la complétude, la symétrie, la justesse des proportions (depuis Vitruve), la mimesis et la sérénité. Ce que n’oublie pas de mentionner Hegel dans son Idée du beau : « ce qui caractérise avant tout l’idéal, c’est le calme et la félicité sereine », en particulier « la calme sérénité des personnages créés par les œuvres d’art de l’antiquité[15] ». Cependant Hegel, probablement lecteur d’Edmund Burke, a intégré une nouvelle dimension : l’« horreur délicieuse[16] » du sublime romantique. « Dans l’art romantique, le déchirement et la dissonance intérieurs sont plus accusés […] c’est souvent (pas toujours cependant) la laideur ou la non-beauté qui se substitue à la beauté sereine.[17] » Gageons qu’après que le sublime ait dévasté le beau, la beauté du laid s’impose, comme lorsque Baudelaire publie en 1857 Les Fleurs du mal et fait l’éloge paradoxal de sa « charogne ».
Mais à l’attaque de la beauté du laid s’est ajoutée une autre déconvenue : Voltaire, dans « Beau, beauté », son article du Dictionnaire philosophique, ouvre la boite de Pandore du relativisme, non sans se moquer du « to kalon » de Platon : « Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté, le grand beau, le to kalon : il vous répondra que c’est sa crapaude avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. Interrogez un nègre de Guinée, le beau est pour lui une peau noire, huileuse, des yeux enfoncés, un nez épaté. » Il conclut en toute logique, et ce dans la tradition de Descartes, malgré le piquant d’une facile ironie, « que le beau est souvent très relatif[18] ».
C’est plus nettement à partir de Nietzche que s’ouvre définitivement la faille : car « rien, absolument rien ne nous garantit que le modèle de beauté soit l’homme. » En effet, selon son antiplatonisme, « Le beau en soi n’est qu’un mot, pas même un concept. […] le prédicat « beau » c’est la vanité de l’espèce ». Rien de plus relatif et arbitraire que cette idole dont voici le crépuscule définitif : « absolument rien ne nous garantit que ce soit justement l’homme qui constitue le modèle du beau[19] ».
Bientôt, aux côtés de la démultiplication du goût, l’anthropocentrisme et l’éthnocentrisme se liguent alors pour autoriser une déconstruction du concept de beauté, historiquement, religieusement et esthétiquement constitué, dans la perspective de Derrida. À moins que, selon Jean-Pierre Changeux, une « neuroesthétique[20] » permette à la beauté et à la laideur d’illuminer des aires neuronales différentes ; et surtout à la première de procurer des émotions plus paisibles, plus éclairées…
Avec l’impressionnisme des Nymphéas de Monet et a fortiori l’abstraction, une beauté informelle, exclusivement colorée, peut enfin apparaître, affranchie de toute injonction aristotélicienne à la représentation, assimilable par le plaisir visuel de l’émotion et du sentir, d’aires neuronales exquisément chatouillées, quoique non sans une possible élégance du goût, tant l’harmonie de la composition et des couleurs restent un critère flagrant, malgré l’assertion kantienne selon laquelle « la critique du goût est [...] simplement subjective[21] », de Vassily Kandinsky à Marc Rothko et Olivier Debré… Faut-il alors regretter que l’art moderne se soit souvent consacré au goût, voire au culte, de la laideur ?
[...]
[1] Platon : Hippias majeur, 298a, Œuvres complètes, Flammarion, 2008, p 543.
[2] Platon : Phèdre, 247 c, Œuvres complètes, Flammarion, 2008, p 1263.
[3] Aristote : Poétique, 1448a, 1448b, Œuvres complètes, Flammarion, 2014, p 2762, 2764.
[4] Umberto Eco : Le Problème esthétique chez Thomas d’Aquin, PUF, 1993, p 219.
[5] Leon Batista Alberti : De Pictura, Allia, 2019, p 44, 56.
[6] Plotin : Ennéades, I 6-9, Les Belles Lettres, 1924, p 105 et 106.
[7] Plotin : Ennéades, I, 6-5, Les Belles lettres, 1924, p 101.
[8] Umberto Eco : Histoire de la beauté, Flammarion, 2004.
[9] Umberto Eco : Histoire de la laideur, Flammarion, 2007.
[10] Adalbert Stifter : L’Arrière-saison, Gallimard, 2000, p 349.
[11] Adam Smith : Théorie des sentiments moraux, PUF, 2011, p 261.
[12] Père André : Essai sur le beau, J. H. Schneider, 1767, p 2, 3, 5.
[13] Vincent Gioberti : Essai sur le beau, Meline, Cans et Compagnie, 1843, p 9, 304.
[14] Emmanuel Kant : Critique de la faculté de juger, § 60, Œuvres philosophiques III, La Pléiade, Gallimard, 1985, p 1146.
[15] Hegel : Esthétique, II, L’Idée du beau, Aubier, 1964, p 112.
[16] Burke : Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime du beau, Vrin, 2009, p 227.
[17] Hegel : Esthétique, II, L’Idée du beau, Aubier, 1964, p 113.
[18] Voltaire : Dictionnaire philosophique, Bry Ainé, 1856, tome II, p 49.
[19] Friedrich Nietzsche : Le Crépuscule des idoles, § 19, Œuvres III, La Pléiade, Gallimard, 2023, p 742.
[20] Jean-Pierre Changeux : Du vrai, du beau, du bien, une nouvelle approche neuronale, Odile Jacob, 2008, p 103.
[21] Emmanuel Kant : Critique de la faculté de juger, § 34, Œuvres philosophiques III, La Pléiade, Gallimard, 1985, p 1063.
/image%2F1470571%2F20240306%2Fob_842881_trujillo-cadre-noir-et-reflet-or.JPG)
Parador de Tujillo, Extremadura.
Photo : T. Guinhut.
Conclusion.
Ou la mémoire de l'avenir.
Nous n’aurons jamais fait que gloser de la beauté, que l’honorer, la regretter, la relativiser, la conspuer, la ressusciter peut-être, voire, qui sait, écrire pour elle en beauté. Car malgré toutes les avanies que les temps modernes et contemporains lui ont faites, lui font et lui feront subir, elle reste un horizon de l’humanité. Universelle, depuis la sereine Aphrodite capitoline jusqu’à une éruption sublime du Vésuve, d’un masque nô japonais ou Ibo du Nigéria jusqu’au plus brut de l’Art Brut, voire au coin de la mocheté, à l’ironie de la laideur. Pour emprunter une opposition nietzschéenne et le sens des métaphores de Peter Sloterdijk, la thérapeutique apollinienne qui était celle de la beauté platonicienne est peut-être passée du côté obscur de la « thérapeutique dionysiaque »[1]. Sauf si l’érosion jusqu’à la disparition de la beauté confine à la disparition de sa dimension thérapeutique et cathartique, remplacée par le divertissement, ce qui se- rait un signe inquiétant au service du diagnostic afférent à notre civilisation.
D’autant que la dimension métaphysique échappe à notre perception esthétique, alors que le poète Yves Bonnefoy nous le rappelle : « L’art, ce serait ce qui profite du déni conceptuel de la finitude pour le plaisir - un plaisir qui souvent prend figure d’une souffrance - et non plus pour la connaissance. Il saurait que de la simple apparence peut naître une beauté qui aidera à voiler les terreurs du gouffre »[2].
Pour emprunter encore à Peter Sloterdijk, le crime per- pétré par l’art contemporain, le consumérisme vulgaire, le relativisme et l’égalitarisme, commis sur l’immémoriale beauté, vaut comme un temps du crime, lorsque l’« abandon de l’Être qui caractérise les univers de l’art était inéluctable »[3] qui aurait pour vertu paradoxale d’en valoriser les ruines, la disruption du sublime, l’assaut du moche, venus de son éclatement. En une catharsis peut-être, à moins qu’il ne s’agisse que du pire voyeurisme, la beauté qui sera « convulsive, érotique-voilée, explosante fixe », venue d’André Breton[4], propose encore les traces, les indices, qui permettraient à l’enquêteur de retrouver la victime, voire de la rédimer. Ce au nom du droit naturel du dandy à la liberté et du droit intellectuel à la beauté, dans sa dimension peut-être universelle. Ce dans le cadre d’un universel qui ne soit pas uniformisateur, sans menacer la diversité culturelle qui compose l’humanité, mais également sans que les revendications identitaires le menacent.
Autre universel de l’humanité, la liberté politique. Car avec Philippe Nemo, nous pouvons penser le politique en termes de beauté et laideur, grâce à son lumineux essai : Esthétique de la liberté[5]. Au-delà de la prémisse selon la- quelle chez Platon, le vrai, le beau et le bien sont un, il montre que « la servitude enlaidit les existences humaines [et] que cela n’est pas seulement vrai de la certitude absolue instaurée par les totalitarismes, mais aussi de la demi-servitude instaurée par certaines sociétés réputées plus douces, les socialismes, qui sont nombreux dans le monde actuel ». En conséquence, seule une vie libre est créatrice de beautés et peut avoir un sens. Les vertus de justice, véracité, libéralité, esprit de paix, tolérance, prudence, tempérance, force, orientation positive des activités (en particulier l’innovation scientifique) fondent la beauté morale, donc politique, au sens où seule la participation de l’être libre leur per- met d’accéder à la beauté de l’œuvre d’art. Rappelons-nous qu’avec Jean Petitot, Philippe Nemo signa une belle Histoire du libéralisme en Europe[6], ce dernier participant d’une indispensable esthétique de la politique.
Nous savons bien hélas que la liberté n’est pas partout et en tout temps cet invariant du droit naturel dont nous réclamons l’éthique et l’esthétique. L’on y préfère trop souvent la servitude imposée et volontaire des théocraties ou des constructives totalitaires. L’espérance cependant de la beauté libre ne doit pas nous abandonner. Nous serons ainsi un dandy, non seulement de la beauté plastique, mais un dandy politique. Car à la rencontre nécessaire de ces deux disciplines complémentaires, esthétique et philosophie politique, l’art, qui selon Gilles Deleuze « n’est pas le chaos, mais une composition du chaos qui donne la vision ou la sensation[7] », est un universel de l’humanité.
Thierry Guinhut
Une vie d'écriture et de photographie
[1] Peter Sloterdijk : Le Penseur sur scène, Christian Bourgois, 2000, p 199.
[2] Yves Bonnefoy : La Beauté dès le premier jour, William Blake & co, 2010, p 41.
[3] Peter Sloterdijk : Essai d’intoxication volontaire Suivi de L’heure du crime et le temps de l’œuvre d’art, Hachette Pluriel, 2001, p 226.
[4] André Breton : L'Amour fou, Gallimard, 1976, p. 26.
[5] Philippe Némo : L’Esthétique de la liberté, PUF, 2014, p 11-12.
[6] Jean Petitot & Philippe Nemo : Histoire du libéralisme en Europe, PUF, 2006.
[7] Gilles Deleuze & Félix Guattari : Qu’est-ce que la philosophie ? Minuit, 1991, p 192.
/image%2F1470571%2F20240306%2Fob_a94f4b_sonnets-twombly.JPG)
Cy Twombly, Neuf discours sur Commode, Museo Guggenheim, Bilbao, Bizkaia.
Photo : T. Guinhut.



/image%2F1470571%2F20231218%2Fob_63aed3_tours-cathedrale.JPG)
/image%2F1470571%2F20231126%2Fob_4935a8_saint-sebastien-montserrat.JPG)
/image%2F1470571%2F20231126%2Fob_7e8e8c_daoud-le-peintre.jpeg)
/image%2F1470571%2F20231126%2Fob_0aa003_chevillard-l-arche-titanic.jpg)
/image%2F1470571%2F20231126%2Fob_2e76a7_guerin-le-temps-de-l-art.jpg)
/image%2F1470571%2F20231126%2Fob_a0ab88_guerin-philosophie-du-geste.jpg)
/image%2F1470571%2F20231126%2Fob_bd1872_bibliodyssees.jpg)
/image%2F1470571%2F20231218%2Fob_bd551f_bourges-vitrail.JPG)
/image%2F1470571%2F20231207%2Fob_e8fb44_poitiers-rose.JPG)
/image%2F1470571%2F20231112%2Fob_b230b8_rose-baraton.jpg)
/image%2F1470571%2F20231112%2Fob_8414d6_roses-pierre-joseph-redoute-les-mervei.jpg)
/image%2F1470571%2F20231207%2Fob_97acb1_roses-roses.JPG)
/image%2F1470571%2F20231112%2Fob_a3165d_roses-d-orbigny.JPG)
/image%2F1470571%2F20231112%2Fob_97cc1a_rose-fregonese.jpg)
/image%2F1470571%2F20231112%2Fob_617737_pink-diairy.jpg)
/image%2F1470571%2F20231112%2Fob_e966e5_nuanciers.jpg)
/image%2F1470571%2F20231112%2Fob_64e35d_nuancier.JPG)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_ebfe2f_img-3360.JPG)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_0f035a_japonisme.jpg)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_2c8bb2_kimono-livre.jpg)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_0fb32c_grand-heritage.jpg)
/image%2F1470571%2F20230714%2Fob_3d5af9_levi-strauss-masques.jpg)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_edba51_museum-la-rochelle-totem-oceanie.JPG)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_9b9011_anthropologie-de-l-art.jpg)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_424ded_art-en-tranfert.jpg)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_56cbe7_adorno-kulturindustrie.jpg)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_6b4cc7_benjamin-allia-l-oeuvre-d-art-a-l-epoq.jpg)
/image%2F1470571%2F20230713%2Fob_94d3e5_museum-la-rochelle-noir-et-blanc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240406%2Fob_5c3f2a_353-sables-d-olonne-chaissac.JPG)
/image%2F1470571%2F20230422%2Fob_5df4ed_thevoz-art-brut.jpg)
/image%2F1470571%2F20230422%2Fob_4e97e4_art-brut-et-psychanalyse.jpg)
/image%2F1470571%2F20230422%2Fob_41b417_thevoz-ecrits-bruts.jpg)
/image%2F1470571%2F20240406%2Fob_a69c02_chaissac-personnage-aux-yeux-bleus-nan.png)
/image%2F1470571%2F20230418%2Fob_c7452a_art-brut-delavaux.jpg)
/image%2F1470571%2F20230418%2Fob_47845f_art-brut-peiry.jpg)
/image%2F1470571%2F20230418%2Fob_d7d402_art-brut-le-beau-l-art-brut-et-le-marc.jpg)
/image%2F1470571%2F20240406%2Fob_492e87_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)
/image%2F1470571%2F20230418%2Fob_5cead4_senecal-guy.jpg)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_b05bfa_paular-sol.JPG)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_3a2183_pastoureau-rouge-points.jpg)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_200ab9_polastron-libros.jpg)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_d1e7b1_pastoureau-noir-seuil.jpg)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_43ddb7_pastoureau-blanc.jpg)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_78cd49_polastron-au-coeur-du-noir.jpg)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_bf3273_polastron-calligraphie-chinoise.jpg)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_dce6cc_penitents-pellizano.JPG)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_add49c_pastoureau-moye-age.jpg)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_f3d001_pastoureau-simonnet-le-petit-livre-des.jpg)
/image%2F1470571%2F20221209%2Fob_0919cc_causse-couleurs.jpg)
/image%2F1470571%2F20221209%2Fob_46d75d_pastoureau-souvenirs.jpg)
/image%2F1470571%2F20221208%2Fob_0e4145_roda-de-isabena-noirt-et-blanc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_5a662c_garouste-don-quichotte.jpg)
/image%2F1470571%2F20221201%2Fob_a678c8_garouste-croisee.jpg)
/image%2F1470571%2F20221201%2Fob_1a32a6_garouste-philippe-langenieux-la-ve.jpg)
/image%2F1470571%2F20221201%2Fob_ac13d4_cervantes-garouste-couv.JPG)
/image%2F1470571%2F20221201%2Fob_9b7b4a_garouste-centre-pompidou.jpg)
/image%2F1470571%2F20221201%2Fob_dcee2f_garouste-vraiment-peindre.jpg)
/image%2F1470571%2F20221201%2Fob_c4f31a_garouste-banquet-couv.jpg)
/image%2F1470571%2F20221201%2Fob_e1fced_don-quichotte-garouste.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_08197b_zamora-musee-paysage-sublime.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_3d0eee_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)
/image%2F1470571%2F20220623%2Fob_4173a3_merot-paysage.jpg)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_81dcf6_cevedale-zebru.JPG)
/image%2F1470571%2F20221005%2Fob_21e07e_sublime-belles-lettres.jpg)
/image%2F1470571%2F20221005%2Fob_febe14_leopardi-canti-friedrich.jpg)
/image%2F1470571%2F20220623%2Fob_48fe61_burkesublime.jpg)
/image%2F1470571%2F20220623%2Fob_6d0761_burke-recherche.jpg)
/image%2F1470571%2F20220623%2Fob_5fada2_bodei-paysages.jpg)
/image%2F1470571%2F20220623%2Fob_413c51_bodei-paesaggi.jpg)
/image%2F1470571%2F20220623%2Fob_20e7bd_schama-landscape.JPG)
/image%2F1470571%2F20220623%2Fob_c6189b_schama-landschap.jpg)
/image%2F1470571%2F20220623%2Fob_5ebb3b_demanda-arbre-neige.JPG)
/image%2F1470571%2F20231215%2Fob_ba402a_zurich-kunsthaus-ange.JPG)
/image%2F1470571%2F20220527%2Fob_e3628f_lahire-tableau.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d13ce9_thelot-epoque.png)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_52b6bc_thelot-peinture-et-cri.jpg)
/image%2F1470571%2F20220527%2Fob_c5b922_ruby-figure-spectateur.jpg)
/image%2F1470571%2F20220527%2Fob_9eb8b1_ruby-cris.jpg)
/image%2F1470571%2F20220527%2Fob_7aa79a_leroy-toucher-la-peinture.jpg)
/image%2F1470571%2F20220527%2Fob_135a3a_bacon-l-atelier-contemporain.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_f90bfa_saura-manda.JPG)
/image%2F1470571%2F20231215%2Fob_5567b8_93-babou-flaran.JPG)
/image%2F1470571%2F20220225%2Fob_76e26a_effervescence-de-la-peinture-dans-lart.jpg)
/image%2F1470571%2F20220225%2Fob_f9677b_pigeat-effervescence.jpg)
/image%2F1470571%2F20220225%2Fob_def607_mauries-neo-romantiques.jpg)
/image%2F1470571%2F20220331%2Fob_8cf793_issoudun-hurteau.jpg)
/image%2F1470571%2F20220402%2Fob_54afc8_peinture-obsolescence-licences-libres.jpg)
/image%2F1470571%2F20220402%2Fob_05c111_peinture-obsolescence-licences-libres.jpg)
/image%2F1470571%2F20220225%2Fob_26ec7a_neo-romantiques.JPG)
/image%2F1470571%2F20220225%2Fob_e90c75_issoudun-clemence.jpg)
/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)
/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)
/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)
/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)


/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)


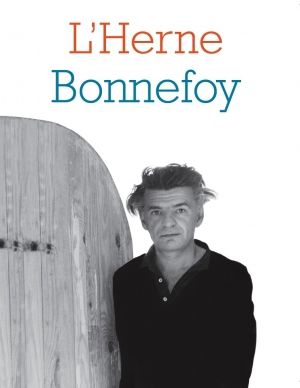
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)
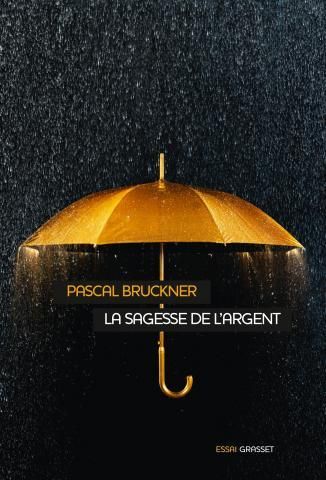
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)
/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)
/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)
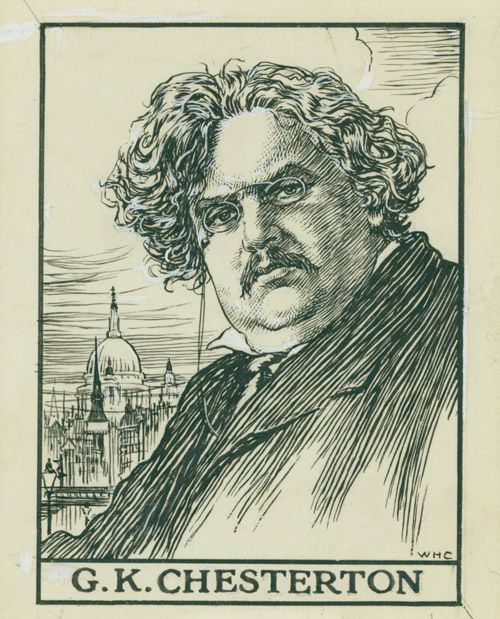

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)
/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)
/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)
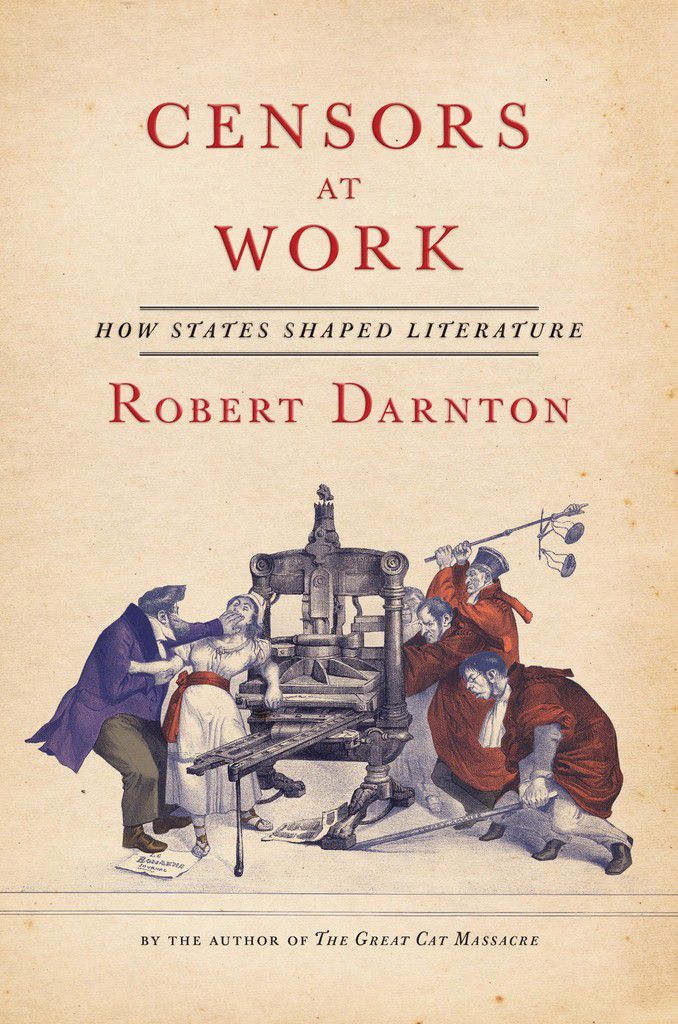
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)
/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)
/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

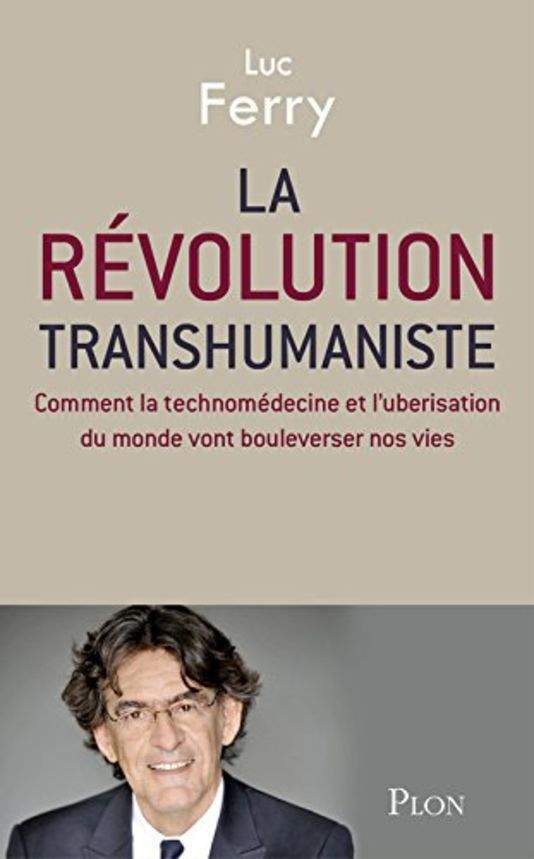
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)
/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)
/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)


/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)



/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)
/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)
/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)
/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)
/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)
/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)
/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)
/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)
/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)
/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)


/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)
/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)
/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)
/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)


/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)
/image%2F1470571%2F20240501%2Fob_b197cb_marcus-lalphabet-des-flammes-de-ben-ma.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)
/image%2F1470571%2F20240501%2Fob_5b8835_marino-adone-classici.jpg)
/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)
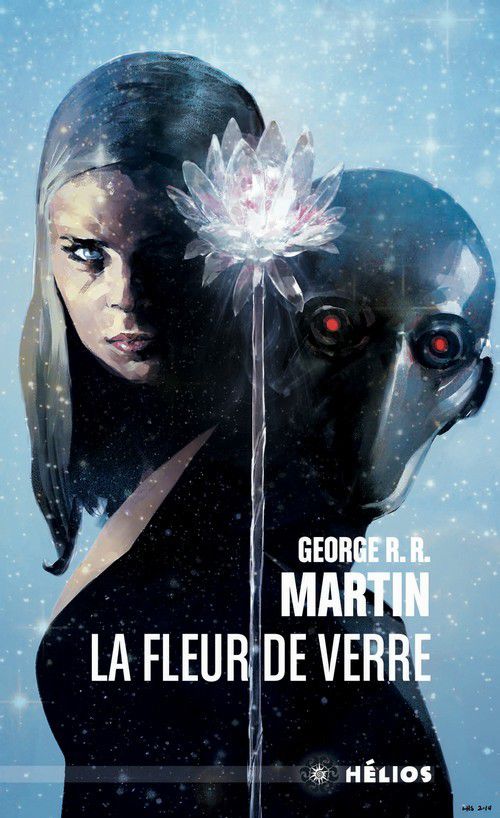
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)
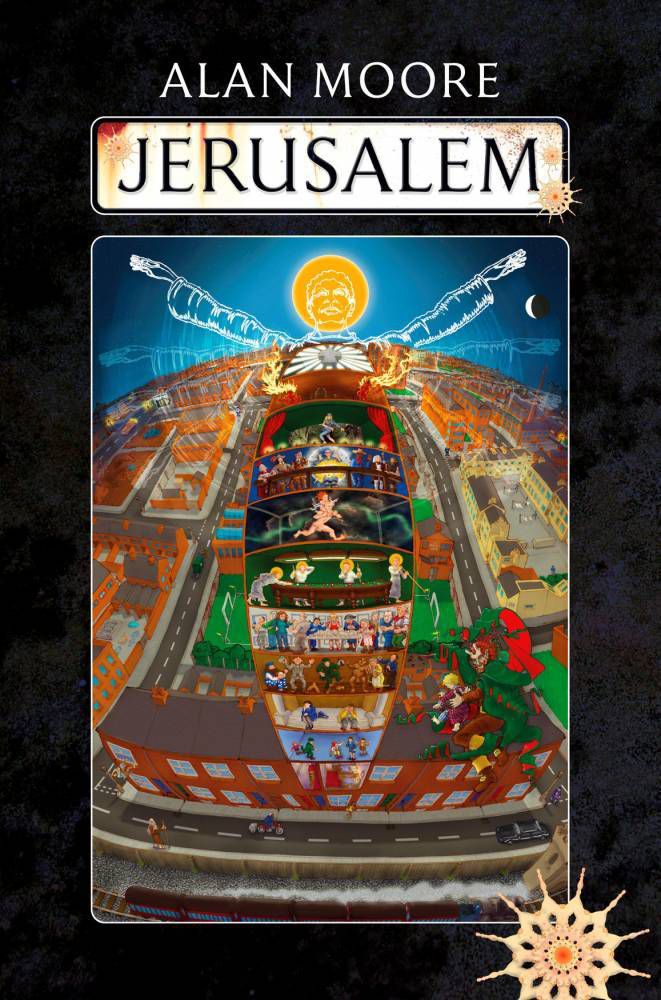

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)
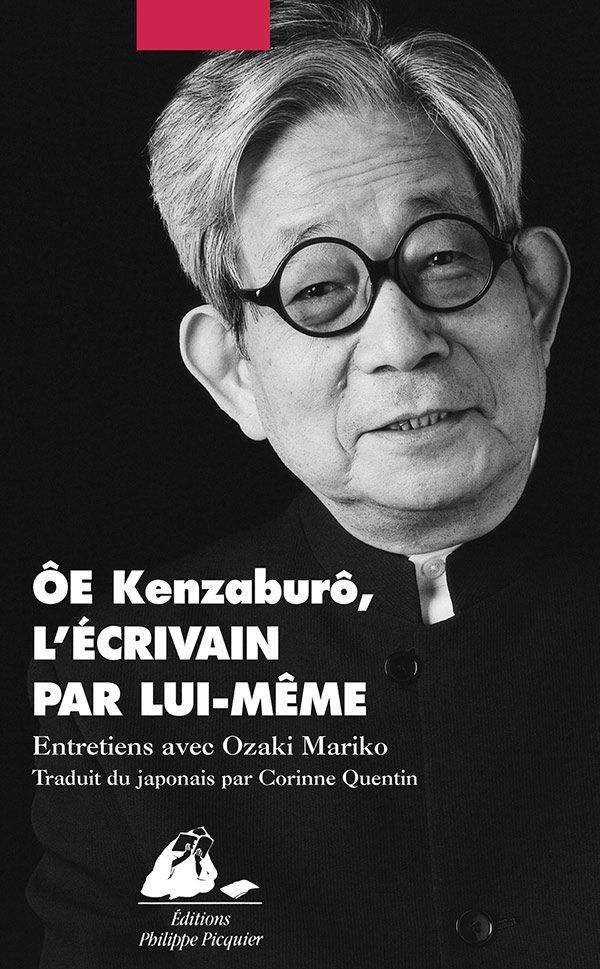
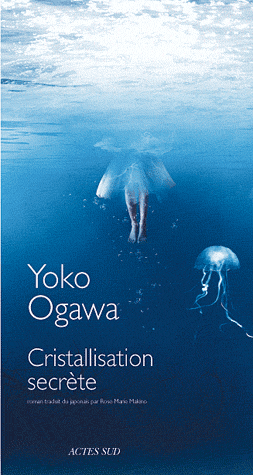
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)
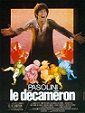
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)
/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)
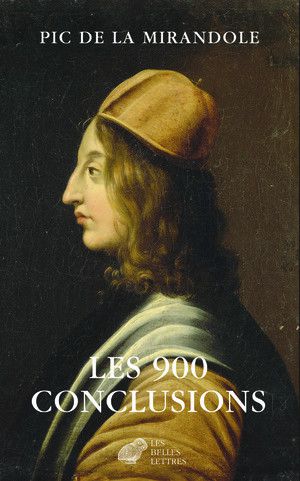
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)
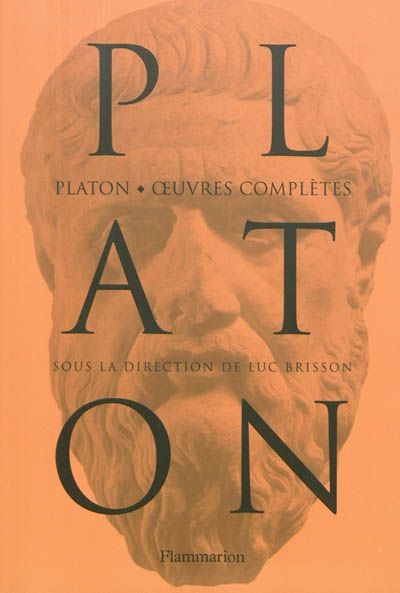
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)
/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)
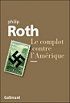
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)
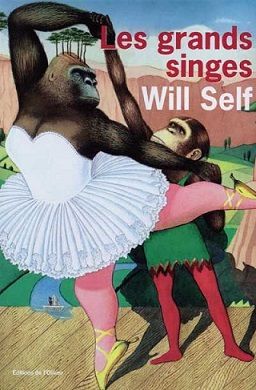
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)
/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)


/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)
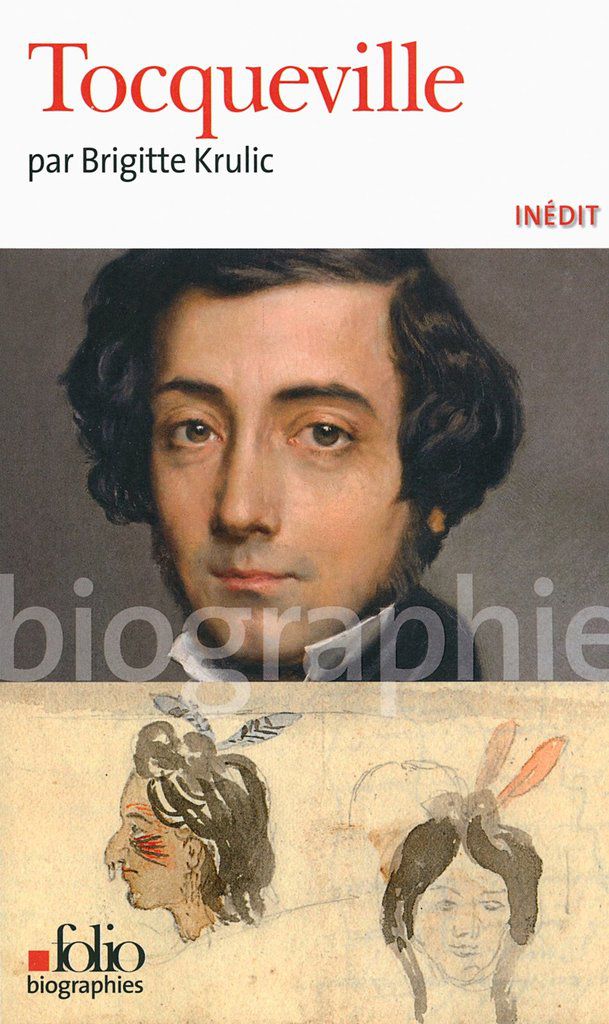
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)
/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

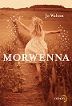
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)



/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)
/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)