/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_245554_zaragoza-museo-maigreur.JPG)
Museo Goya, Zaragoza, Aragon. Photo T. Guinhut.
La Bibliothèque du meurtrier.
Roman
I L’artiste en maigreur.
C’était l’heure vivante, profuse et bruissante du vernissage des Figures du jeune Jonas Melville. Figures II plus exactement. Après celles sous-titrées « Masques d’art » qui avaient stupéfié critiques et collectionneurs quand elles singeaient les visages archi-connus de l’Histoire de l’Art en leur coinçant des sourires d’ironies dans leurs statures de branchages cloués et sculptés, il s’agissait maintenant des « Trognes d’art » soumises à de grimaçantes, affreuses, burlesques et pitoyables ébriétés étirées. Petits fours glacés minimalistes, huitres froides en gelées miniatures, champagnes frappés, fontaine de whisky sur icebergs, rien ne réfrénait l’ardeur au pillage, l’ardeur à imiter le déglingage des Figures II de Jonas Melville. Ce dernier d’ailleurs, tordait sa maigreur de rire silencieux devant la naïveté des gogos à qui il confiait sous couvert de discrétion dévastée, le foutage de gueule de l’art, de son art…
N’empêche, ça banquait. Inès de Sommerville, sa galeriste, mi-suédoise, mi suissesse, savait ne pas avoir le moindre rictus d’ironie, sur sa face coupante de beauté accro au jogging intense et à la sculpture fildeferesque, lame de couteau et autres métaux agressifs. Cette demi-entorse à son esthétique favorite avait été dès le départ un investissement prolifique. Depuis que le gros critique d’ArtbookOne, James Columna, avait hurlé à « l’anorexie sculpturale », la production de ses poulains marchait au pas de charge. Avec les Figures I, que le même James Columna avait qualifiées de « déforestation anartistique », puis avec celles qu’il honorait ce soir de sa présence boulimique en dévastant la table des petits pâtés au rhum, et qu’il se proposait in petto de surnommer « les torsions gastriques du capitalisme », tout en remarquant « leur qualité d’autoportraits originels », les cartes American Express gold, platine et diamant claquaient sous l’impatience des ongles. Les grimaces de l’art n’échappaient pas à la rapacité des servants de l’art : marchands ostentatoires, conservateurs en vue et collectionneurs secrets. Inès de Sommerville rayonnait de confiance : son Jonas Melville n’avait qu’à creuser le filon, étirer le fil d’or qui lui naissait naturellement des phalanges…
Evidemment, il était déjà demi-fin beurré au Muscadet de Loire, sentant fort le joint marocain dont le suc imprégnait la trame de ses vêtements effilochés, collés de sciures et de copeaux, comme s’il sortait à l’instant de son atelier, en plein délit de sale gueule de la création. On l’entourait, on se collait à lui, histoire de lui chiper un copeau signé, on le congratulait, le questionnait sans écouter les réponses, glissant un œil à celui qui ne dérogeait pas sa règle immuable : ne jamais parler à l’artiste, regarder l’œuvre, rien que l’œuvre, conceptualiser en un silence sibyllin, bouffer et produire une chronique aussi phare que ciselée, en un mot inimitable. James Columna produisait en effet du concept à la même vitesse que les pores de sa peau de porc rubescente scintillaient de graisse. Ce n’était pas pour rien qu’il avait été surnommé le Gros Lucky Luke de la critique : il conceptualisait plus vite que son ombre, pourtant généreuse, mais à la condition unique, mystérieuse à souhait, que l’artiste entrât dans les grâces augustinienne de sa révélation. Il faut d’ailleurs lui rendre justice ; s’il ne résistait jamais au raffinement d’un nouvel amuse gueule charcutier, il n’était en rien vénal.
Cette fois, les vingt et une Figures avaient été prévendues avant même l’extinction des flashes du vernissage. Il avait fallu ramener Jonas Melville à son loft-taudis en le supportant sous ses osseuses aisselles aux puanteurs du pire aloi. Quand, le vendredi suivant, la chronique de Columna parut en pleine page, auréolant l’artiste de la gloire du « Junkisme sur bois », toutes les cartes purent être débitées conformément aux promesses d’achat. La couverture glacée du magazine format in folio -il était du dernier chic d’exhiber ce malcommode format- offrait à qui voulait l’entendre une resplendissante photographie de la « Trogne d’art 21 », immense cep de vigne noueux, élongation de corps aux membres scarifiés, aux veines christiques piquées de traces de seringues, au faciès déchiré par une bouche d’hémiplégique tombée à gauche, tout cela comme lacéré de l’impatience de dizaines de coups de serpettes, de l’urgence de cent peinturlurages vineux et spiritueux…
La gloire avait frôlé de son aile magique la jeunesse de Jonas Melville. Quoique pas au point de figurer sur les magazines people qu’il feuilletait à la recherche vaine jusque là de son look imitant son art. Il lui avait suffi d’exposer deux « Trognes » dans un salon d’amateurs de province un rien bohême de seconde zone pour qu’Inès de Sommerville, toujours à l’affut de talents imberbes, lui propose, lui commande, exige une série plus conséquente. Soudain, il était pété de fric ; le fric faillit achever de le péter. Une overdose de whisky Œil de perdrix et de pétards jamaïcains du dernier renom, le conduisit aux urgences, sur un lit à peine plus gris que lui, dans des draps qu’Inès de Sommerville, effarée à la pensée de devoir perdre prématurément son juteux poulain, imagina dans sa première vision mystique voir préfigurer un suaire de Mantegna visitant Auschwitz. Elle fut encore plus surprise de voir, au chevet du malheureux, une inconnue, une petite femme, un brin boulotte, en chemisier blanc à col Claudine, jupe de pensionnaire et serre-tête de miss prout-prout sur chignon parfait. Plus effarants lui parurent les vernis noirs à talons plats qui achevait de donner un look grave extraterrestre à celle qui se leva cérémonieusement à l’arrivée de la galeriste avec un « A qui ai-je l’honneur ? » de réception au Pensionnat de la Légion d’Honneur. Une fois informée de la qualité à qui elle parut donner son assentiment, elle se présenta comme l’épouse du malheureux gisant : Anne-Caroline Melville, artiste en maisons de campagne.
Alors là c’était le total bouquet ! Jonas était marié ; et à une telle poularde encore… Il battit des cils sur son palier de décompression, leva sa main grêle au poignet orné de perfusions pour la poser dans la petite pogne sévère, quoique aimante, de sa moitié. Jonas Melville allait suivre une cure de désintoxication, je puis vous l’assurer, chère Madame, affirma, un rien péremptoire, la poularde aux joues rondes et crèmes ; d’ailleurs il travaille déjà sur les croquis -fusains et sanguines- de Figures III. Veuillez-nous laisser, je vous prie.
Trois mois plus tard, Inès de Sommerville fut introduite dans l’atelier de Jonas Melville. Visiblement, Anne-Caroline, qui lui ouvrit la porte de zinc, avait fait un ménage ravageur dans le loft-taudis. L’odeur de bois sec, de palettes lavées à grande eau, d’outillage inoxydable, stérilisé, et de pervenche bleue flottait dans l’air. Jonas, en salopette bleu ciel, rasé de presque frais, droit comme un poutre à longue portée, aurait pu figurer dans un tableau représentant l’atelier de Joseph le charpentier ; même le verre indiscutable de Muscadet de Loire aurait pu y sembler être un bénitier de table. De plus, il paraissait un huitième moins maigre ; ses pommettes ressemblaient un peu moins à des tendons. Inès de Sommerville, eut peur un instant que la poularde aux seins amidonnés sous le corsage lui ait cassé son look.
Heureusement, les esquisses étaient là, vingt-trois à la parade, dressées contre la tôle du mur avec des épingles à linge en bois de bouleau. Jonas restait fidèle, comme Verlaine, à l’impair. La machine à calculer qui doublait le sens artistique d’Inès de Sommerville, cliqueta dans le lobe droit de son cerveau. Vingt-trois « Sanguine et charbon » en format grand-aigle, hyper bourrées de graphismes à La Greco resserrés au milieu d’un pur blanc angoissant, voilà qui devrait banquer. Columna allait saliver de la boite à conceptualiser. Elle rédigeait déjà mentalement l’entretien qu’elle allait donner à Pluriel des Arts, en jouant sur la comparaison entre l’artiste couché sur son lit d’Urgences et les Figures III debout sur le blanc du grand-aigle, même si au passage elle avait un peu réécrit la couleur des draps.
Avant de repartir plus que satisfaite de la promesse de son poulain de se mettre dès le lendemain à la première figure sculptée parmi la succession des 23 Figures III, Inès de Sommerville omit de voir sur le mur opposé, quoique l’artiste en herbe n’en eût pas fait montre, les peintures à l’huile, fort niaises et fort fleuries, des maisons de campagne d’Anne-Caroline, comme d’exactes petites photos surchargées de patouilles jolies…
Réflexion faite, de retour en sa galerie où elle exposait les bombes de corps humains plastifiés de Ruben Abdelwaman, Inès de Sommerville s’étonna qu’il n’y ait pas eu d’esquisses pour Figures I et II. Quel manque à gagner scandaleux. Peut-être pourrait-elle lui suggérer de les antidater…
Elle revint lorsque Jonas affirma avoir terminé. Quinze jours seulement étaient passés. Quelle productivité affolante ! Il ne faudrait pas confondre abondance et multiplication des petits pains en solde… L’atelier, cette fois, était hanté par l’absence d’Anne-Caroline, dont les tableautins luisaient dans l’ombre comme la bave d’escargot après la pluie. Quelques baquets de bois aux bouteilles de Muscadet de Loire témoignaient d’une consommation ireffrénée. Quelque raout familial et provincial devait occuper sa bourgeoise… Sans compter qu’une odeur entêtante de joint surgoudronné respirait convulsivement dans les cintres… Jonas, sans qu’on lui en demande compte, attribua la chose à une légère inquiétude : sa Princesse venait d’être admise à la maternité. Quoi ! la truie Madame Figaro était enceinte, allait accoucher par les voies naturelles ; fi donc ! Inès se surprit à n’être guère accro à la charité chrétienne et se corrigea en imaginant que son poulain pourrait bénéficier d’une telle info dans son carnet mondain. Surtout ne pas se faire oublier…
Quand Jonas, rasé comme le maquis corse, et cette fois en veine de mise en scène, tira un long rideau de lin grège -une trouvaille d’Anne-Caroline, sûrement- et découvrit les vingt-trois Figures III. Elle ne put retenir un hoquet de stupéfaction. Ce n’étaient que longues buches de peuplier debout, parfois écorcées, lacérées, scarifiées, discrètement barbouillées à la diable, pour lesquelles elle se demanda s’il avait suffi de les réceptionner à l’arrivée à la scierie, faute d’autre travail. Elle écarta bien vite cette duchampienne pensée, quoique exploitable après tout, en vérifiant la relative congruence des esquisses avec les sculptures qu’il faudrait exposer ensemble, de façon à confirmer la continuité du processus créateur.
Le vernissage des Figures III avait été étudié avec le meilleur charcutier-traiteur de la capitale. En effet, le buffet fut un succès. Columna loua les magrets de cailles en gelée et les cœurs de pigeons à la confiture, non sans regarder d’une œil torve et cependant placide un butor qui ressortait devant les esquisses et les bois l’antienne : « Mon gosse de cinq en ferait autant s’il avait des muscles de bucheron et des bras assez longs pour tirer au fusain… ». Jonas Melville avait en effet -ce qui était rien moins que nécessaire- de longs bras tendineux, plus fuselés que les bouteilles d’Alsace blanc qui le charmaient par leur nouveauté acidulée. Il y eu des commentaires élogieux sur la façon dont les sanguines graphiques s’enlaçait aux muscles supposés du fusain, mais en quantité inversement proportionnelle aux promesses d’achat. Inès de Sommerville faillit piquer un embryon de crise d’angoisse, jusqu’à ce qu’Alastair Bishop sorte son chéquier pour acheter les vingt-trois esquisses. Voilà bien de l’argent facile qui allait glisser dans les poches du jeune chargé de famille. Hélas, les Figures III en elles-mêmes parurent être boudées par les acheteurs. Elle voulu se rassurer en sachant combien l’initiative de Bishop serait productive et, surtout, combien l’imagination conceptuelle de Columna serait payante.
Hélas, trois numéros après la clôture de l’expo des Figures III, Columna, boudeur, ne vint à parler, dans un articulet de bas de page, en fin de cahier, que de « minimalisme étique », formule dont on ne sut si c’était du lard ou du cochon… Un musée miteux de Lichtenfeld consentit à acheter trois bouts de bois. Heureusement Inès de Sommerville venait de faire un carton avec Slima Vendoye et ses tubes de peintures géants d’où sortaient des houris, des geishas et des playmates plastifiées aux formes girondes. Qui pour Columna, en couverture et en première page du même numéro, signifiaient « la fin du totalitarisme anorexique », « la transculturalité de l’érotisme », « l’antitalibanisation du monde »… Cette fois le bougre n’avait pas été chiche de formules à succès offertes à une sculptrice qui savait manier les rondeurs à souhait. Il avait bien mérité ses médaillons de foie et d’abats au Champagne, dont l’un d’ailleurs avait malencontreusement chu d’entre ses doigts boudinés pour orner le revers généreusement convexe de sa veste jusque là veuve de toute palme académique.
Inès de Sommerville ne voulut pas se décourager. Jonas Melville avait eu une éclipse, une faiblesse passagère. Qui sait si l’on pouvait imaginer une lutte entre le courant anorexique et le courant boulimique, le second incarné par Slima Vendoye et le premier désincarné par un Jonas Melville, le Retour IV…
Elle demanda une nouvelle série d’esquisses. Des sculptures plus travaillées. Jonas, évasivement, promit. Tout en arguant qu’il allait pas se casser le cul pour trois mille euros, non ? Inès, langue de vipère plus qu’agile, rétorqua que mille euro par bout de bois ramassé dans un fossé de forêt, ça ne se trouvait pas sous le cul d’un âne, si l’on voulait continuer à être foutument vulgaire… Toutes façons, sa Princesse se faisait trois cents euros, par tableautin, votre baraque de cambrousse, repimponnée en huile sur toile à l’ancienne. L’art c’était plus que de la merde. Autant l’étirer jusqu’à l’os. Au boulot, mec, et que ça saute ! le stimula Inès à court d’arguments. Qu’importe le vin pourvu qu’on ait l’ivresse, se dit-elle, pensant que la voix du sculpteur était passablement avinée, et repensant à l’argument duchampien qui pourrait toujours resservir. Rendez-vous fut pris pour le mois suivant.

Alberto Giacometti, Kunsthaus, Zurich, Schweiz. Photo : T. Guinhut.
Pendant ce temps, Bishop prêtait les esquisses de Figures III au Musée d’Austin. Quand Jonas lut cela dans la presse spécialisée, lui qui n’était même pas invité, il vitupéra comme une Furie contre un pignouf friqué qui allait revendre ses esquisses, ses esquisses à lui, au moins trois fois ce qu’il les avait payées, sans même un petit pourcentage au créateur qui s’était déchiré le sang pour pondre ces assomptions du corps, que ce capitaliste de merde comprenait rien aux métaphores et qu’il lui pissait à la raie.
Inès de Sommerville reposa son Smartphone dans le silence pudique de son sac croco aux bijoux palpitants. S’il me faisait une telle scène auprès d’une nouvelle génération de Figures énergiquement travaillées, voilà qui pourrait être payant, qui pourrait faire génie outragé. Il faudra le fournir en Muscadet, Alsace et autres Chianti lors du vernissage de Figures IV le Retour.
À l’heure du rendez-vous, Anne-Caroline en personne et en vichy bleu et blanc vint ouvrir la fatale porte de zinc à Inès. D’autorité, elle fit résonner le cuir et cuivre de ses bottillons La Troba sur le béton du loft briqué comme le pont d’un navire école de la grande époque. Après quelques généralités inaudibles, Inès lorgnant sur le fameux rideau théâtralement fermé, ce fut Anne-Caroline, le bébé au sexe non identifié vagissant sur bras et son ventre, qui ouvrit la gloire des Figures IV. Elles n’étaient qu’onze. C’étaient des stèles de bois dont les membres étaient des collages alternés de pied de fauteuils Louis XV et de branches, la tête étant figurée par une pancarte de planche, sur laquelle on pouvait lire un mot gravé: « vue, toucher, ouïe, goût, odorat, corps, esprit, anorexie, boulimie, nature, culture », onze mots donc pour ces Figures IV qui ne différaient par ailleurs que par la forme aléatoire des branches.
Prudente, Inès garda une mutité méditative. Anne-Caroline avait son regard bovin. Peut-être que cela pourrait emporter l’adhésion. Les esquisses à la Twombly entrelaçaient des graphismes corporels avec chacun des mots comme avec des fils de fer barbelés. Une fois trouvée l’idée, cela avait dû prendre deux après-midi. De toute façon Inès avait réservé une quinzaine à Jonas Melville, puisque Slima avait du retard dans sa nouvelle livraison, et Bishop voulait d’autres esquisses. Jonas parut faire une trogne de poireau déterré lorsqu’avec circonspection Inès objecta que, peut-être, onze Figures, c’était un peu maigre. Que la vastitude de sa galerie réclamait plus d’abondance. D’accord. Elle n’insista pas. Elle n’informa le couple qui était resté plus muet qu’une huitre scellée (il devait y avoir de l’eau dans le gaz) de sa décision d’exposer conjointement, et sur le mur immense du fond, en vis-à-vis, les esquisses tout en rondeur de Slima Vendoye, généreuses en pastels gras, riches en couleurs méditerranéennes et orientales.
Cette fois, Jonas Melville ne s’était pas déplacé pour installer ses filiformes avortons. Il ne livra qu’un vague croquis d’archi sur une nappe de papier imbibée d’auréoles de pinard blanc. Indications chaotiques et fractales dont Inès eut de la peine à tenir compte, lorsque les manutentionnaires, aux biceps exagérément tonitruants pour la légèreté étique des Figures IV -qui faisaient panneaux de signalisation de brocante forestière- les posèrent sans coup férir en rang d’oignons devant l’accrochage des esquisses. En face, l’explosion milletunenuitesque des créatures de Slima Vendoye, soutiens-gorges béant du magma colorés, lèvres de toutes natures parlant toutes les langues babéliennes du désir et de l’exhibition fit visiblement bander l’érection d’un des deux bleus de travail. Ce dont Inès n’eut que le fantasme d’un instant de profiter : elle était en effet lesbienne strictement auto-masturbatrice, et encore les seuls soirs de pleine lune. Gardant son habituel sang froid, elle se demanda si le rachitisme revendicateur des Figures IV s’accommodait bien du néo-kitsch des pieds Louis XV qui leur servait de membres droits. N’empêche que, vis-à-vis des truculentes volutes carmin de Slima Vendoye, cela pouvait passer pour un clin d’œil, une ironie triste.
Columna adora les Esquisses pour Femmes Sensuelles de Slima. Au point d’embrasser l’artiste, plus ronde et agile qu’une délicieuse multiplication de seins et de fesses, sur les sourires de ses deux joues, ce qui fit craindre à Inès de Sommerville, qui ne se laissait jamais aller à de telles érections d’émotions, que les rots de truffe qui tenaient place de diction au critique n’incommodassent l’intéressée. Il parut errer méditativement parmi les Figures IV, palpant un instant les courbes de bois Louis XV, puis l’écorce brute des branche squelettiques et distordues. Etait-ce bon signe ? ArtBookOne allait-il leur rendre justice ? Jonas Melville était debout, plus boudeur qu’un iguane, parmi ses bois, au point de confondre son dégueulé de tee-shirt caca de saurien non identifié avec les écorces.
Evidemment, ArtBookOne fit sa couverture avec une esquisse de Slima Vendoye. Inès fut à la fois comblée (c’était sa deuxième première de couv en un an, fait rarissime s’il en fut) et affectée d’un insidieux pincement de déception. Sa galerie avait révolutionné son image autant que son écurie, elle avait su sentir, disait-on, une radicale évolution des mœurs et des looks (Elle et Vogue se mirent alors à afficher des rondes), mais elle restait physiquement aussi coupante, quoiqu’elle tentât de faire ballonner ses seins de pigeon blême sur le bustier… Qu’importe, elle était fêtée comme l’icône d’une nouvelle sensibilité. Un coup de chance, sa secrétaire assistante, partant en congé de maternité, puis parental, lui permit d’embaucher une nouvelle façade de galerie au corps nettement plus slimanesque.
Quand aux Figures IV, elles reçurent l’hommage modéré d’une photo en colonne de droite, en page onze s’il vous plait, assortie d’un commentaire prudent de Laurence Bissuel, l’assistante de Columna, qui parla de « néo-conceptualime » et de « schizophrénie alimentaire entre nature et culture » ; ce qui était fichtre mieux que rien. Les Guggenheim de Bilbao et de New-York se disputèrent les Slima dont les reproductions s’arrachaient en format couverture, cartes postales, imprimés pour tee-shirts, droits de reproductions à la clef (Inès de Somerville n’avait pas pour rien une formation de fiscaliste internationale). Las, seul Bishop, dont la fidélité était décidemment à toute épreuve, consentit à proposer 30% du prix affiché pour les onze esquisses de Jonas, qui entra dans une rage purulente, déversant sa bile noire dans le bureau d’Inès, pourtant imperturbable. Elle préparait déjà mentalement le one woman show de Slima, douze nouvelles esquisses et vingt-quatre sculptures, toutes plus gourmandes et charnues les unes que les autres, toujours jaillissant, comme le génie des contes, de leurs tubes de gouache, d’acrylique et d’huile…
Bien qu’ayant déjà reçu ses 15 % essorés depuis le compte de ce Bishop pourtant providentiel qui ne collectionnait que les dessins sur grand aigle (les Figures IV avaient beau regarder le mur de leur œil plat, aucune indécision de vente ne s’était profilée), Jonas se présenta bien peigné, mouché, un tee-shirt propre, devant Inès de Sommerville pour lui demander une avance. Eh oui, Anne-Caroline s’était habituée au luxe, elle habillait leur fils chez Tartine et Chocolat, elle était enceinte du deuxième, elle pensait déjà à une Grande Ecole de Commerce pour le fils, à une Grande Ecole d’Art pour la fille à venir… De plus, sa Princesse lui faisait découper, monter, peindre des meubles imaginatifs en forme de fleurs pour les chambres de bébés, pendant qu’elle ornait d’hortensias les contremarches, il n’avait plus le temps de créer, mais il allait se reprendre, promis, il allait scratcher une expo du tonnerre pour l’automne, balançant sur le bureau de teck une esquisse grand-aigle giclée sur nappe de restau à deux balles d’un corps auschwitzien, allez quoi, fais pas ta bégueule !
Elle lui consentit deux mille euros d’à valoir. Une fois le drôle passé la porte de verre fumé - il alla directissime se jeter deux vodka-téquilas, ce qu’elle fit consciencieusement vérifier dans le bar d’en face par Lucie - elle se demanda ce qui lui avait fait déroger à sa règle jusque là pourtant immuable. Jonas était-il le dernier symbole d’une jeune génération fidèle à ses idéaux, alors que ses sculpteurs métal avait tous emboité le pas à la rondeur et au gras ? Les sociologues s’arrachaient jusqu’aux poils des aisselles pour tenter de comprendre quelle soudaine inhibition avait sauté, quelle soudain antipuritanisme corporel et écologique avait été balayé par une festivité sans complexe… O tempora o mores, ô combien les modes les plus solidement et longuement accrochées pouvaient s’évaporer en un instant ! Les caprices du succès étaient décidemment insondables. Slima et Jonas étaient-ils les seuls artistes réellement authentiques ? Elle ne s’était pourtant pas fait faute de ne pas exiger de ce dernier qu’il invente fissa une nouvelle manière, tout en gardant son esthétique maigre, comme marque de fabrique d’une héroïque et vertueuse résistance politique.
Personne en effet ne voulait plus entendre parler d’Auschwitz, les mannequins anorexiques n’avait plus qu’à se repulper d’abondance les chairs, manger du cassoulet de Castelnaudary, se maquiller au foie gras des Landes, faute de quoi il ne leur restait plus qu’à se faufiler entre deux affiches de l’année dernière et disparaître.
Jonas ouvrit lui-même la deux fois fatale porte de zinc. Il avait les mains bandés de linge blanc et de sang. Oui, Anne-caroline était à la maternité, il avait pu travailler entre deux courses pour sa Princesse. Il laissa le soin à Inès de Sommerville de tirer le rideau de lin grège. Il n’aurait pas fait bon le souiller…
Visiblement, il venait de terminer de tordre autour de sept branches un lacis cruel de fil de fer barbelé. C’étaient les Figures V. Deux mètres cinquante de souffrance sept fois répétée. Certes. Mais c’était un peu nu. Que faire de ça ? se rongeait Inès de Sommerville, perplexe, debout près d’un cageot de bouteilles de téquila plus vides que les yeux de celui qui n’a plus de larmes. Jonas paraissait fier de lui, de ses impeccables réalisations, les poings dans ses chiffons sanglants posés sur ses genoux cagneux. Il était en short, la climatisation devait être en panne, il faisait une chaleur de rat, les huiles d’Anne-Caroline, dans leurs cadres chichiteux, paraissaient suinter. Inès frissonna dans sa mini jupe Zefirella.
Enlève tes pansements, lui ordonna-t-elle. Enroule-les dans les barbelés. Bien. Il n’en manquera plus que cinq autres. Voilà, ça parle comme ça.
/image%2F1470571%2F20201003%2Fob_05319e_krimmler-ache-croix.JPG)
Krimmler Ache, Salzburg, Osterreich. Photo T. Guinhut.
De retour dans son bureau, elle se dit rageusement qu’il lui fallait tout faire elle-même, que le Hard Art allait pouvoir contrer ce boulimisme qui rapportait pourtant une fortune à sa galerie et parmi laquelle l’avance consentie à Jonas pouvait passer en pertes et profits fiscaux. Ou c’était un cas psychiatrique, ou c’était un visionnaire. Peut-être la boule de l’obésisme allait-elle se dégonfler. Même si elle n’avait pu obtenir plus de sept Figures V, chiffre mystique, certes ; tu veux que je m’arrache les mains pour ton fric ? Prends des gants ! Non ; où serait la performance ? Un coin de galerie suffirait, au devant d’une expo rétrospective de l’Art Fer pour faire hurler l’Obésisme en cours, avant les nouvelles Déesses Mères de Slima…
Heureusement elle avait les dix esquisses, sanguines et pastels secs. Une fois encadrées bois mince, exposés à très peu d’intervalle comme un polyptique à la Grunenwald, ces couronnes d’épines contemporaines, déroulées et dressées pouvaient être splendides. Elle avait dû signer un chèque, encore deux mille euros, tu comprends, ma Princesse Anne-Caroline, les dettes, les agios ; tu comprends, l’argent de poche qu’elle se fait avec ses huiles ne peut pas lui suffire… Il suffisait bien à cacher à la Princesse aux cols Claudine les nombreux cactus pressés pour sa consommation de téquila.
La rétrospective Art Fer ne vit même pas paraître Columna. Il avait envoyé Bissuel qui commençait à se prendre pour le disciple abusif. Il traita les sphéroïdes aux méridiens et parallèles acérés de Miztlo par le mépris, les boites de conserve géantes et déchirées de Cabalira par l’indifférence. Ce jeunet qui ne savait pas voir et se prenait pour l’hémorroïde du monde s’arrêta devant les Figures V de Jonas Melville. Il se retint de parler pour avoir l’air profond, pianota quelques notes illisibles sur son Iphone, ce que Columna ne faisait jamais, imita son maître au buffet avec une gourmandise salopiote de chien fou déjà rassasié.
Cabalira et Mitzlo furent sabrés dans ArtBookOne. Seul Jonas eût droit à une photo d’une des Figures V devant esquisses. « Signatures de l’acte de décès de l’Art Fer et de l’Art Maigre » avait titré le claviphoniste. Il rapporta quelques interjections de Jonas, qui s’était répandu contre « le gras suintant du capitalisme qui crucifie les os de la pauvreté mondiale », et portait le coup fatal au travail de « l’ex-artiste » qui avait eu « l’idée grotesque, mélodramatique et superfétatoire, d’ajouter ses linges ensanglantés. La nudité du bois et du barbelé eût été préférable, euphémisme suffisant ».
Inès s’en était pourtant vaguement repentie, sans oser se déjuger devant Jonas. Elle était une excellente galeriste, pas une créatrice, elle le savait. Seul un article de La Croix parut être sensible, reprochant lui aussi l’ajout saugrenu des linges, regrettant cependant que les figures n’aient pas été treize, onze tournée vers une plus haute figures centrales et la treizième détournée… Suggestion intéressante, pensa-t-elle ; qui sait si quelqu’une de ces nouvelles églises en construction et fortunées comme il en pullule aux Etats-Unis n’aurait pas pu acheter ces Figures V ainsi conçues. Tachons de convaincre notre poulain…
Alors que sa Princesse allait à la messe, Jonas Melville ne fut guère sensible à l’attention. « Un canard catho à la con pour des grenouilles de bénitier et pour des gras prélats qui tripotent les bites des gosses ! Qu’ils aillent se chier avec leur critique à la con », hurla-t-il en pleine biture téléphonique. Le fait, incontournable, qu’aucune de ces Figures V n’ait vu l’ombre d’un chéquier en vol, ne parut pas le chatouiller. Seul Bishop rafla les dix esquisses. Celui là, flair aiguisé, bien qu’il achetât (vingt fois plus, s’il vous plait) les esquisses de Slima, pariait sur le long terme. Hélas le prix de vente effaçait tout juste l’ardoise de Jonas qui geignit pire que ses deux mômes en couches en se retournant contre les chiffons menstruels pourris qui lui avaient fait rater une vente… Il me faut du fric, cash, banco, tout de suite, la banque me colle au train, t’inquiète, dans un mois ou deux, ou trois, ou quatre, tu as les Figures VI, ça va déchirer grave, je vais crever les abcès purulents du capitalisme financier…
Après cinq mois de silence radio, alors qu’Inès songeait l’oublier, Jonas lui proposa une visite d’atelier comminatoire. Mais avec seulement trois Figures VI, ça tournait à l’esthétique du raté en grandes largeurs. Des palettes debout couronnées de barbelés, le truc fait à la sauvette entre deux stages de déco pendouillerie pour la Princesse, avec un sous-titre prétentieux : « La Sainte Trinité ». Elle afficha un sourire diplomatique, alors que le créateur baignait dans l’auréole des joints d’une semaine qui flottait sous la verrière embuée. La Princesse, Vénus du ménage et Alma mater du pouponnage était partie - une semaine justement - chez grand-mère pour faire entendre les premiers mots échangés par les deux héritiers. Il demanda posément cinq mille euros, encore les banques, l’étrangloir du peuple, tu sais… Il comprit, devant le calme de sa galeriste qu’il fallait la jouer fin… Pourtant, muselé par le relent d’alcool qui lui sirupait la langue, il s’emmêla en jurant que c’était des esquisses, que bientôt cette « Sainte Trinité » en cours d’assomption allait accoucher d’une flopée d’Anges pour étoffer ces Figures VI. Attendons de voir, se contenta d’émettre Inès avant de franchir la fatale porte de zinc dans le bon sens. Cinq mille anges, geignait-il au fond de son fauteuil de feignasse tourmenté par une Princesse absente autant que tyrannique…
Un an plus tard, plus maigre et zombi que jamais, Jonas Melville, apparut devant le bureau de marbre clair de la galeriste, dont l’emploi du temps était plus chargé qu’un camion benne. Le carton grand aigle qu’il charriait avait failli le déporter comme un voilier au vent de la rue. C’était enfin une dernière Figure VII, pitoyable, sept mille euros, zézéyait-il, un crabouilli-bouilla plutôt qu’une esquisse. Il sortit de lui-même, chiffonnant sa création en refermant le carton, se prenant avec sa voilure démesurée dans la porte de verre du bar d’en face. Inès de Sommerville, cessa immédiatement de penser à son ex-poulain alors que Slima rayonnante, pleine d’humour venait lui offrir un polyptique de douze petits pastels gras, adorable, regorgeant de viandes exotiques et confites, sous les yeux d’un Columna gourmand et amusé…
C’est dans la presse quotidienne, celle qui se démode dès le lendemain, au cœur de l’hiver suivant, qu’un articulet nécrologique apprit à Inès Sommerville que Jonas Melville avait été retrouvé derrière sa porte de zinc, couché maigre et nu sur une palette, mal lié de fil de fer barbelé, visiblement de ses propres mains, probablement dans l’imagination de réaliser une impossible Figure VIII, en état de choc alcoolique. Il était mort pendant le transport en ambulance, laissant une jeune veuve éplorée et deux bambins.
La galeriste, qui avait su prendre ce qu’il fallait d’un léger embonpoint, et dont les expositions Slima et Gudrun Solveig faisait courir jet set et critique internationale de Sydney à Los Angeles, sans compter Bâle et Kassel, crut l’histoire à jamais close, quoique regrettant de n’avoir rien conservé du regretté Jonas Melville. Car le rusé Bishop venait de revendre au nouveau Musée Religieux de Houston deux esquisses pour le prix qu’il avait payé naguère pour onze… D’ailleurs restait-il quelque chose de valable derrière cette saloperie de porte de zinc, à part des huiles aux maisons de campagnes hortensias pour petits poneys? Quand, un matin, une Anne-Caroline pimpante en col Claudine, ses gros seins plaqués sous le chemisier fleuri, accompagnée par un Monsieur silencieux à faciès éminemment sérieux, rasé plus frais qu’une eau de Cologne, lunettes cerclées d’or et costume croisé anthracite de fondé de pouvoir d’une banque impérieuse, qui lui tenait la main et lui jetait de respectueux regards énamourés, vint s’asseoir devant le bureau de marbre rose aux fossiles bleutés d’Inès de Sommerville. A quelles conditions, chère Madame, exposeriez-vous, quelques-unes des cent trente-sept esquisses grand aigle que j’ai conservées par devers le malheureux Jonas ?
Thierry Guinhut
Une vie d'écriture et de photographie
La Bibliothèque du meurtrier, roman : synopsis, sommaire, prologue

Villa Foscari, Mira, Veneto. Photo : T. Guinhut.




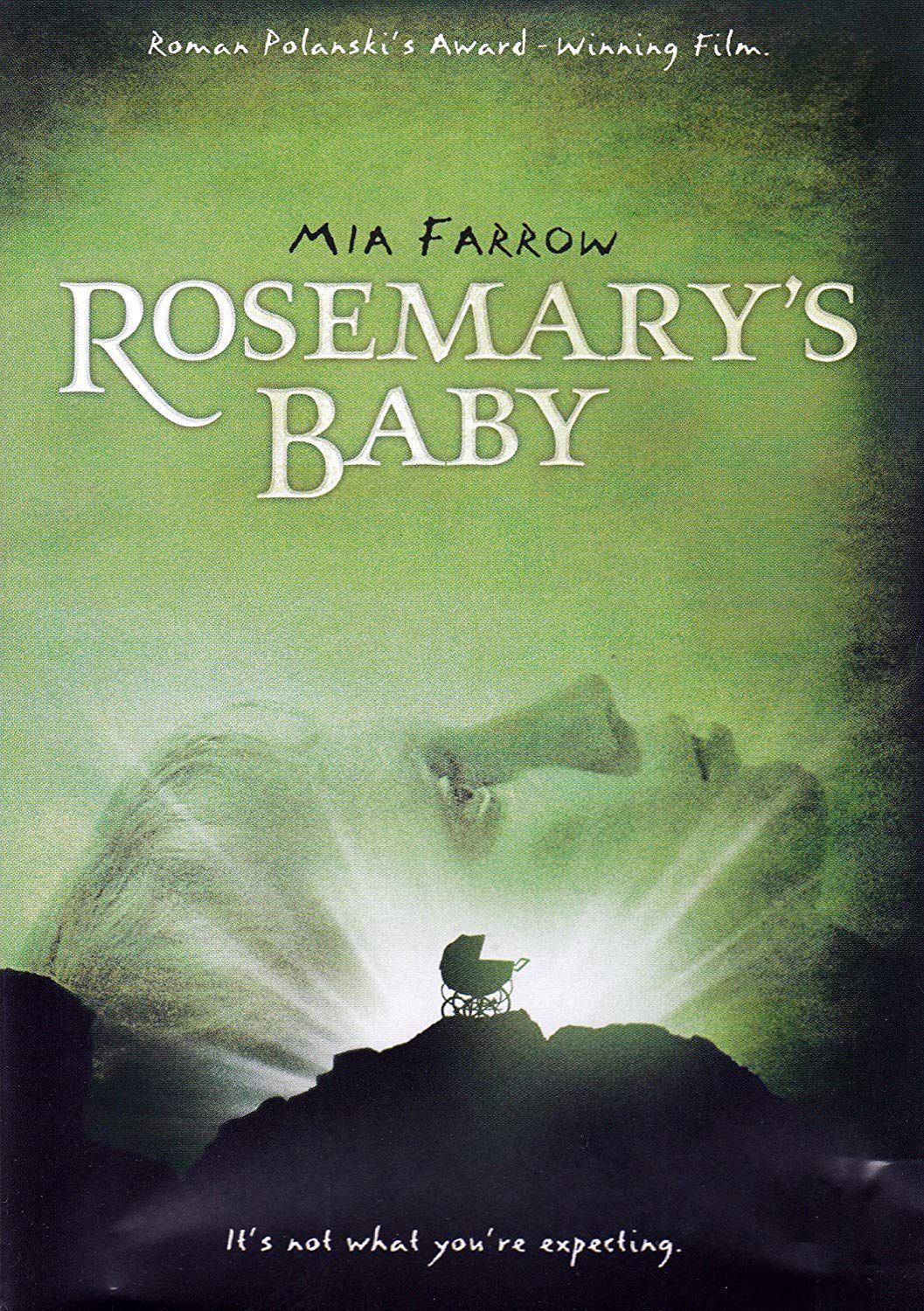

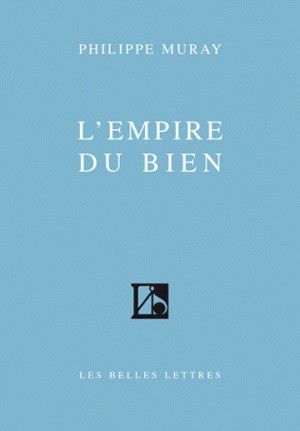
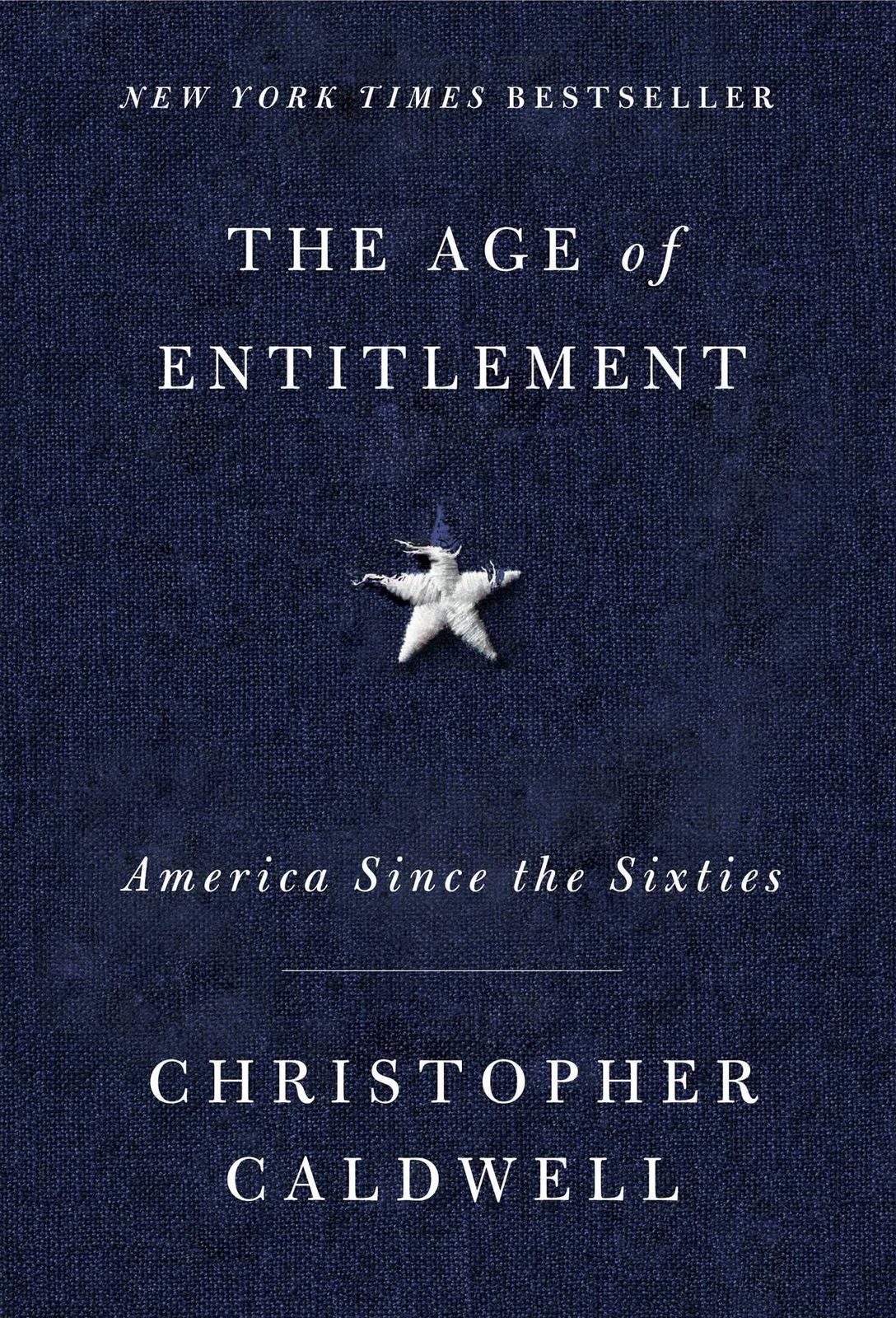





/image%2F1470571%2F20220828%2Fob_5cf0d5_enzensberger-reveurs-d-absolu-bis.jpg)
/image%2F1470571%2F20220828%2Fob_63e97c_enzensberger-reveurs-d-absolu.jpg)

/image%2F1470571%2F20240413%2Fob_c64738_insectes-papillon-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20221220%2Fob_554312_cartarescu-parfumul-aspru-al-fictiun.jpg)


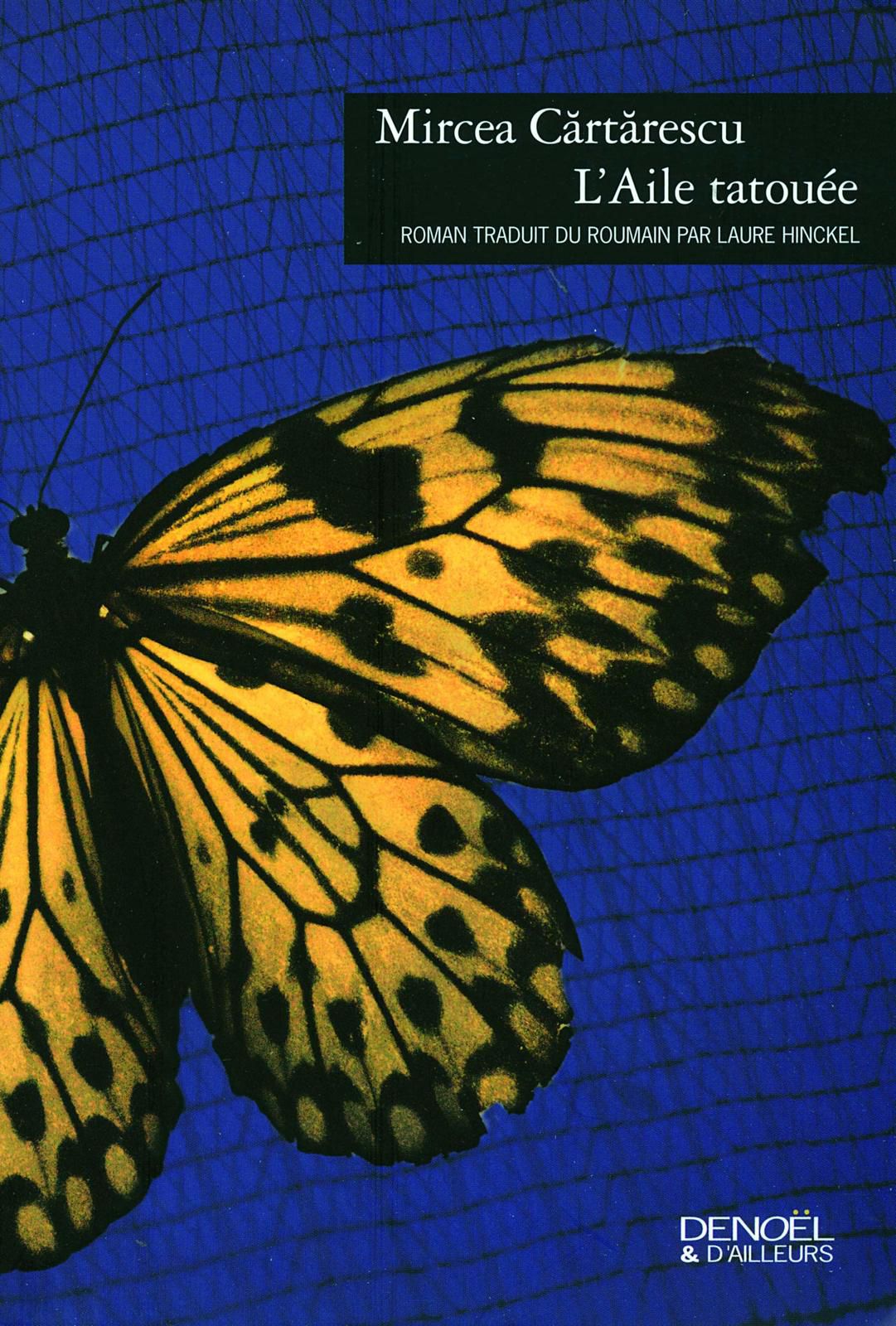

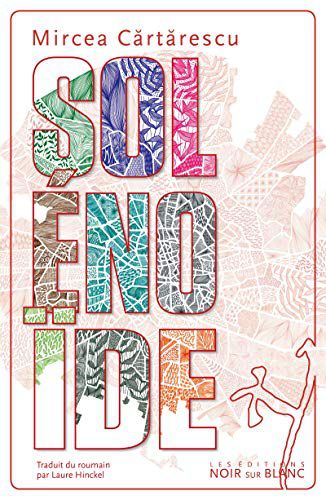
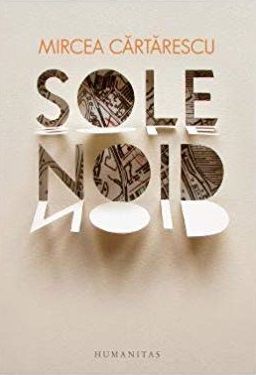
/image%2F1470571%2F20210505%2Fob_76ae94_cartarescu-solenoide-points.jpg)
/image%2F1470571%2F20221220%2Fob_ba9cad_cartarescu-femeile.jpg)
/image%2F1470571%2F20201027%2Fob_4ee899_manea-taniere.jpg)
/image%2F1470571%2F20230506%2Fob_1ab8fc_manea-viata.jpg)
/image%2F1470571%2F20221220%2Fob_47e632_araignees-papillons-cartarescu.JPG)
/image%2F1470571%2F20231217%2Fob_7e9cfa_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20220312%2Fob_d61f27_aristote-pseud-couleurs.jpg)




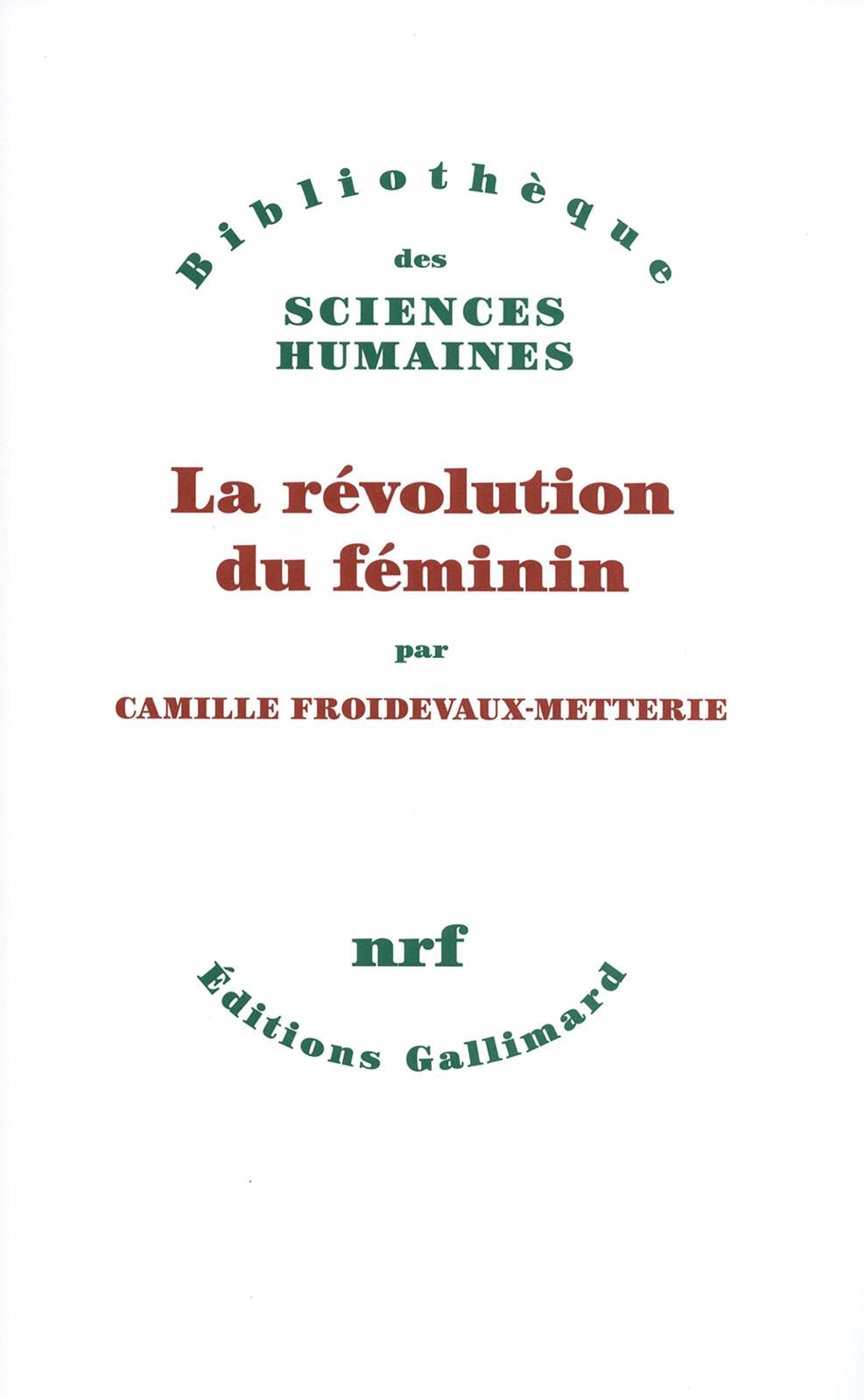

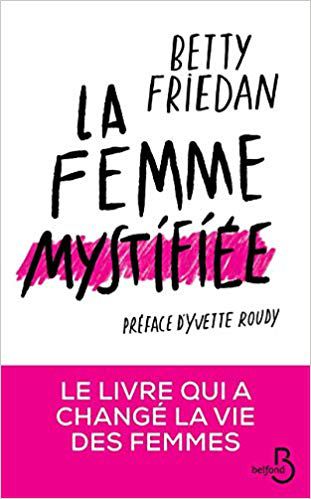
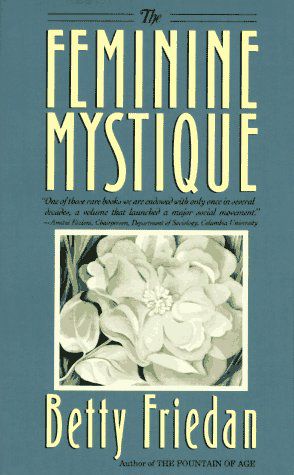

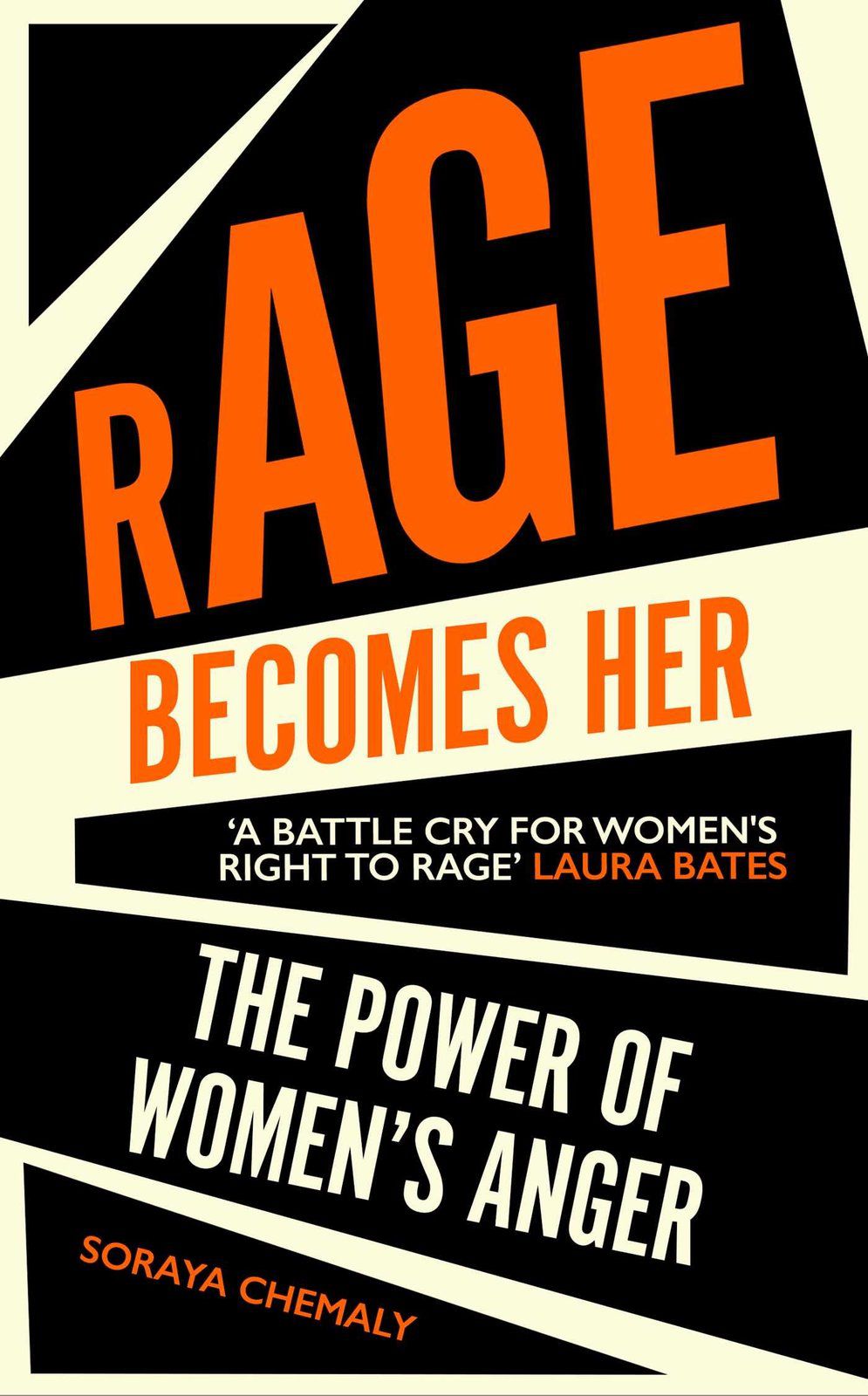

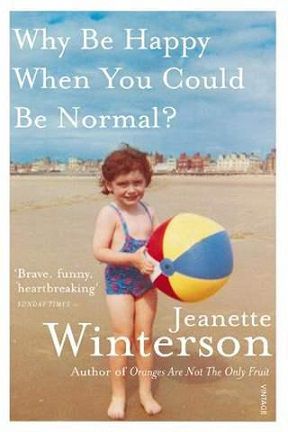

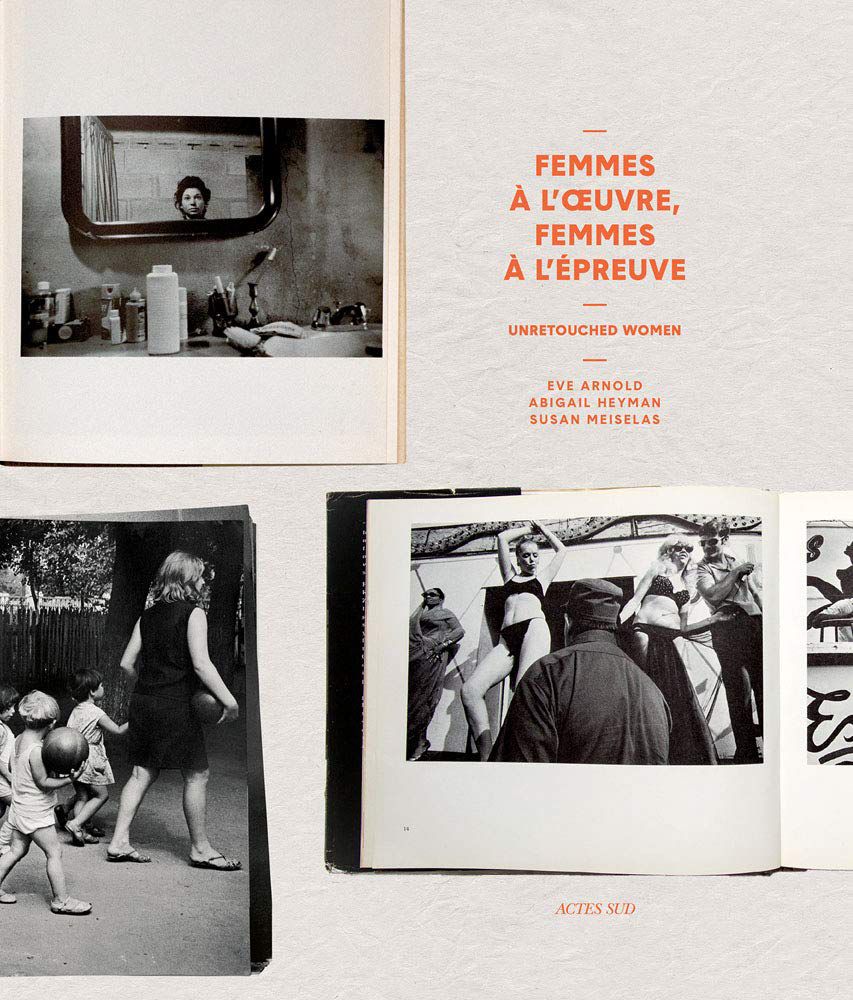










/image%2F1470571%2F20230601%2Fob_57d5fe_bolano-detectives.jpg)
/image%2F1470571%2F20230601%2Fob_3d898a_bolano-4.jpg)
/image%2F1470571%2F20210426%2Fob_16dcc5_bolano-llamadas.jpeg)
/image%2F1470571%2F20210426%2Fob_1d4f72_bolano-amuleto-anagrama.jpg)
/image%2F1470571%2F20210426%2Fob_02d70e_bolano-oeuvres-ii.jpg)
/image%2F1470571%2F20210426%2Fob_830fec_bolano-oeuvres-iii.jpg)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_16a94b_aux-prises-avec-le-mal.JPG)


/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_6e0ce1_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20230527%2Fob_53dba3_kafka-journaux-nous.jpg)







/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)
/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)
/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)
/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)


/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)



/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)
/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_e2a305_emmaues-poupee.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)


/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)
/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)
/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)
/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)
/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)


/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)
/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)
/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)


/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)



/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)
/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)
/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)
/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)
/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)
/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)
/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6753d4_partacua-ruisseau-heinz-m-hoelderlin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)
/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)
/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)


/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_c8d327_kawabata-tristesse-et-beaute-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)
/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)
/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)


/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)
/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)


/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)
/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)
/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)
/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)


/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)
/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)



/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)
/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)