/image%2F1470571%2F20240408%2Fob_2ad5c0_bormio-voute-peinte.JPG)
Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, Bormio, Brescia.
Photo : T. Guinhut.
Les livres dans l’Histoire ou dans la peau.
Martin Puchner,
Erin Morgenstern & Gunnar Kaiser.
Martin Puchner : Ecrire le monde. La formidable épopée des livres qui ont fait l’Histoire,
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Odile Demange, Fayard, 2019, 432 p, 25 €.
Erin Morgenstern : La Mer sans étoiles,
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Julie Sibony, Sonatine, 2020, 656 p, 23 €.
Gunnar Kaiser : Dans la peau,
traduit de l’allemand par Yasmin Hoffmann, Fayard, 2020, 512 p, 24 €.
À quoi mesure-t-on la valeur d’un livre ? À son contenu, son récit et son argumentaire, ou à sa parure, la peau de sa reliure ? Hors de toute appréciation subjective, certainement à son importance dans l’Histoire de l’humanité et des civilisations, comme ceux que présente Martin Puchner dans Ecrire le monde. Il y a des livres fondateurs, mythologiques, angéliques et saints, d’autres qui nous emportent sur la mer des rêves, d’autres encore sur les voies de la liberté ou du crime politique. Ou plus simplement ils sont redevables de valeurs subjectives, là où ils collent à la peau du lecteur, comme un miroir, d’où la quête d’Erin Morgenstern, dans La Mer sans étoiles. Nombreux sont ceux qui vont jusqu’à faire basculer leurs lecteurs dans le labyrinthe de la personnalité et des mondes parallèles en les glissant dans la peau d’un personnage troublé. Pire, comme le postule Gunnar Kaiser, avec son roman Dans la peau, ceux dont la peau est à prendre au sens cutané, pour vêtir les meilleurs, ou les pires livres de l’humanité…
Il en va de l’Histoire des livres comme de l’Histoire du monde, telle qu’analysée par John M. Roberts et Odd A. Westad[1] : « J’ai cherché d’emblée à repérer, là où c’était possible, les éléments qui par l’influence générale qu’ils exercèrent, eurent l’impact le plus large et le plus profond […] et mettre en valeur les processus historiques majeurs, ceux qui ont affecté une quantité considérable d’êtres humains et laissé un héritage substantiel aux générations futures[2] ». C’est ce qu’a tenté avec brio Martin Puchner dans Ecrire le monde, narrant « la formidable épopée des livres qui ont fait l’Histoire » ; même si une certaine pusillanimité ne permet pas au lecteur d’être tout à fait convaincu.
L’ingénieux prologue de Martin Puchner est situé dans l’espace, là où l’on se livre une « guerre froide littéraire ». Car Borman à bord d’Apollo 8 lisait la Genèse[3], partie inaugurale de la Bible, pour célébrer la vision de la terre depuis son hublot, alors que Gagarine n’y voyait aucun dieu, se référant à l’auteur du Manifeste communiste. Ce sont bien là deux livres d’inspiration presque universelle, quoiqu’antagonistes.
Auparavant, Alexandre le Grand emportait toujours avec lui, lors de ses conquêtes, de l’Egypte jusqu’à l’Inde, un manuscrit de l’Iliade d’Homère, qui plus est annoté par son maître Aristote, et qu’il glissait sous son oreiller. Ainsi l’épopée était son modèle. Celui qui fut à l’origine de la bibliothèque d’Alexandrie contribua également à diffuser l’alphabet grec, qui à la différence de son ancêtre phénicien, ajouta les voyelles aux consonnes, d’où l’influence considérable d’une littérature couplée à une écriture.
Mais à cet amateur et inspirateur de récits épiques, qui n’eut pas la chance d’avoir à son service un poète à la hauteur d’Homère, échappait un texte déjà disparu, et qui ne réapparut qu’au XIX° siècle, lors de fouilles anglaises à Ninive : l’Epopée de Gilgamesh, venue des années 1200 avant notre ère, quoique ses origines fussent plus anciennes. Grâce aux signes cunéiformes, « pour la première fois, la narration, domaine oral des chantres, croisa l’écriture, sphère des diplomates et comptables ». Le roi Gilgamesh avait pu dompter le sauvage Enkidu, en faire son ami, dont il dut pleurer la mort... Mais le plus étonnant et que, répondant à la Bible, un déluge voisinait avec un navire salvateur échoué sur une montagne ! L’universalité des mythes rencontrait l’Histoire. Le souverain de Ninive, et maître d’une bibliothèque d’argile, Assurbanipal, « n’ignorait rien de l’importance stratégique d’un texte fondateur », confie Martin Puchner, même s’il devinait que le déluge du temps aurait raison de son empire.
/image%2F1470571%2F20221226%2Fob_4e011c_puchner-drama.jpg)
/image%2F1470571%2F20221226%2Fob_66d477_puchner-poetry.jpg)
Plus vivantes sont encore les saintes écritures, établies au sixième siècle avant Jésus Christ et sous les doigts d’Ezra et de ses scribes araméens : « pour la première fois, le peuple adora son dieu sous forme de texte ». C’est en hébreu que la Torah fut écrite pour devenir un texte sacré fondateur, soit ce que nous appelons l’Ancien testament. Mais gare à ce que l’essayiste appelle justement « l’intégrisme textuel » ! La suite, historique sinon logique, est l’éclosion du Christianisme.
Pour Martin Puchner, les sutras bouddhistes, les entretiens de Confucius, les dialogues de Socrate et les Evangiles ont un point commun : « un maître et ses disciples ». Ce qui était un enseignement oral devint une « littérature de maîtres », fondant une philosophie, une morale, une religion, donc une civilisation du livre. Affranchi des attachements terrestres, Bouddha est le guide suprême vers le nirvana. Confucius, plus exactement Maître Kong, est à l’origine du « canon de la littérature chinoise », qui fut longtemps à la base du recrutement des fonctionnaires. Socrate fit de sa mort une mise en scène, qui lui permit de devenir le philosophe de la remise en cause et du questionnement ; et paradoxalement son refus de l’écriture lui valut d’être immortalisé par la graphie de Platon. Jésus également fut rédimé par ceux qui écrivirent le récit de sa vie et de sa mort, recueillant son enseignement : les évangélistes. À des degrés divers, des millions d’individus sont encore aujourd’hui redevables de leurs enseignements, et portent à la main leurs livres, de manière talismanique. Cependant cela ne se passa pas sans « guerres de traduction », sans que l’évolution des supports, du papyrus au parchemin, du rouleau au codex, ne contribue à la diffusion des textes. Alors que les adeptes de Bouddha et de Confucius accédaient les premiers à l’invention du papier et de l’imprimerie, quoique par un système de blocs de bois gravés et non de caractères.
Plus surprenant, quoique fort justifiée, est la présence ici d’un roman, mais de Dame Murasaki Shikibu, Le Dit du Genji[4], écrit vers l’an 1000 à la cour du Japon, racontant une immense histoire de pouvoir et d’amour contrariée, émaillée de près de huit cents poèmes. Ce premier roman psychologique de l’histoire littéraire, texte raffiné, abondamment lu et illustré au cours des siècles, dans lequel le « Prince radieux, ou Genji, enlève sa jeune aimée pour faire son éducation littéraire et calligraphique, est à la fois un manuel de cour et le canon d’une esthétique japonaise fondée sur le dialogue poétique. Mieux encore il permit de renforcer « l’identité culturelle « du Japon face à la Chine.
Une autre femme lui répond au Proche-Orient, c’est Shéhérazade, la conteuse des Mille et une nuits, celle qui a l’art d’inventer et de compiler des centaines de récits venus de Perse, de Chine et d’Inde, voire d’Egypte et de Grèce, mais si peu d’Arabie, quoique le livre qui nous reste, écrit en arabe, soit probablement originaire de Perse. L’arabisation du texte coïnciderait avec la Bagdad d’Haroun al-Rachid, qui vit également l’expansion du papier et la création d’une bibliothèque au VIII° siècle. Martin Puchner omet cependant de préciser que les Arabes ont depuis le IX° siècle négligé ce livre, au point qu’il aurait disparu, si le Français Antoine Galland ne l’eût recueilli et traduit en français au début du XVIII° siècle…
/image%2F1470571%2F20221226%2Fob_8890ab_puchner-2018-the-written-world-how-lit.jpg)
/image%2F1470571%2F20221226%2Fob_fe011b_puchner-language.jpg)
Un souffle nouveau emporta la Bible lorsqu’en 1454 Gutenberg en fit le second livre imprimé avec des caractères mobiles (après sa plus modeste grammaire latine de Donatus) ; alors que Luther la traduisant en allemand invitait chaque Protestant à lire son volume propre. Et surtout Luther, imprimant ses Quatre-vingt-quinze thèses s’opposant à la vente des indulgences, « avait inauguré l’ère de la polémique publique, une ère où un auteur isolé pouvait publier sous son propre nom ».
Mais avec la découverte des Amériques un texte maya allait pouvoir révéler ses glyphes. Ce qui, imprimé sur papier et en caractères romains, donna le Popol Vuh[5], dans lequel on peut lire un mythe de la création par la main du « Souverain Serpent à plumes », mais aussi un déluge ; encore une fois ! Ce récit aujourd’hui largement ignoré avait pourtant fait l’Histoire de la Mésoamérique. L’Espagne ayant détruit la civilisation Maya, l’on se console avec le Don Quichotte de Cervantès[6], de 1605. Non seulement, il inventa largement le roman moderne, qui « mobilisa la réalité contre le roman de chevalerie » bien trop idéalisé, mais il connut une aventure de « piraterie littéraire », qui le conduisit à écrire une seconde partie, dans laquelle le plagiat et l’imprimerie jouent un rôle non négligeable.
Plutôt que l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert - qu’il n’oublie pas - Martin Puchner a choisi les activités et les écrits de Benjamin Franklin, qui prospéra en se faisant « imprimeur de la République des Lettres ». Ses journaux propagèrent la déclaration d’indépendance américaine, qui fut une conséquence des Lumières et un prélude à la constitution de 1787. De l’autre côté de l’Atlantique, entre Weimar et l’Italie, Goethe promeut le concept de Weltliteratur, soit littérature mondiale. Outre ses romans et son théâtre considérables, il écrivit, inspiré par le poète persan Hafez, tout un cycle de poèmes, le Divan occidental oriental. C’est en lisant de rares traductions de romans chinois qu’il forgea cette expression, qui offrait à la littérature une dimension aussi novatrice que planétaire.
L’on ne pouvait rater (faut-il dire hélas ?) le Manifeste communiste qui eut l’honneur trouble de multiplier ses fidèles et ses propagandistes, de voir son programme adopté de la Russie à la Chine et au-delà. Marx et Engels eurent avec ce brûlot prolétarien un succès d’abord timide puis considérable, prétendant libérer les peuples alors que le texte contient les préceptes du totalitarisme qui allait s’ensuivre[7], avec Lénine, Mao, qui fit de son Petit livre rouge un autre bréviaire, et Castro, ce que ne dit pas notre essayiste ; quoiqu’il note avec pertinence que le genre du manifeste allait faire école jusqu’au sein des mouvements littéraires et artistiques. Peut-on conclure ce chapitre sur une telle formule obscène : « Peu d’écrits ont su, au cours des quatre premiers millénaires de la littérature, façonner aussi efficacement l’Histoire ? » S’agit-il de l’efficacité du goulag et du logaï…
Heureusement, ensuite, il est question d’« écrire contre l’Etat soviétique », avec Akhmatova et Soljenitsyne. Car écrire des poèmes en dehors du réalisme socialisme est forcément subversif ; Anna Akhmatova[8] pouvant à cet égard être associée à Marina Tsvetaïeva et Ossip Mandelstam, tous pourchassés par le stalinisme. Face à l’omniprésence de la censure, elle dut recourir à l’oralité du poème, que des amies apprenaient par cœur, comme si l’on revenait à la culture orale préhistorique. Après la mort de Staline, son œuvre circula sous forme de samizdats ; et c’est à Soljenitsyne qu’elle lut son Requiem. De la machine à écrire de ce dissident tombait alors Une Journée d’Ivan Denissovitch, découvrant l’horreur et l’immensité du goulag, qui devint par la suite un « archipel ». Comme Primo Levi, il est un de ces écrivains qui « témoignent contre les horreurs du fascisme et du totalitarisme ».
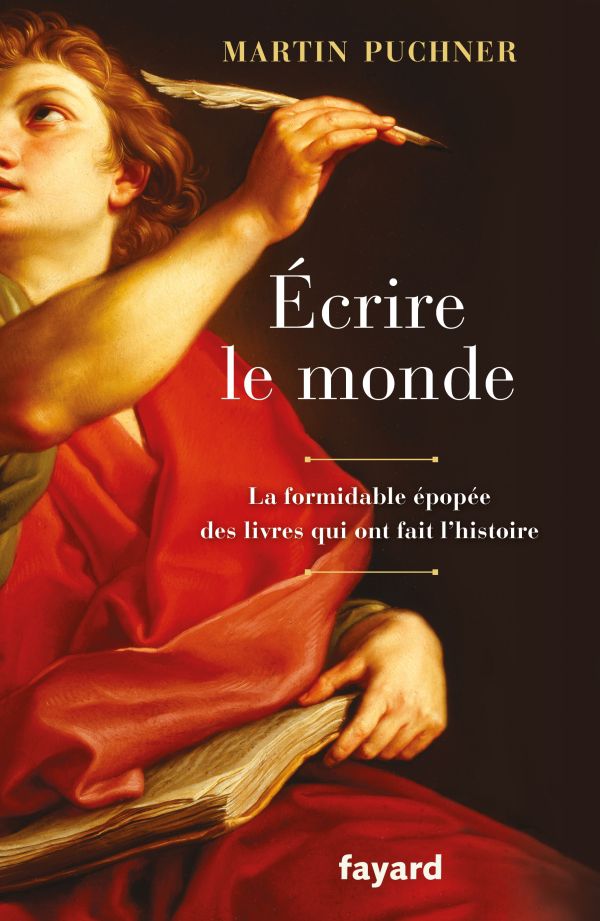
Il faut s’attendre à quelques surprises à la fin de cet essai décidément bouillonnant. Le modeste critique auteur de ces lignes dut avouer son ignorance abyssale en y découvrant l’Epopée de Soundiata. Elle raconte la fondation de l’empire mandingue (englobant Mali et Guinée) à la fin de notre moyen Âge. Longtemps transmise oralement, elle attendit 1994 pour être transcrite par un scribe. À ce récit précolonial (quoique colonisé précédemment par l’Islam), répond une littérature postcoloniale, celle du poète de Sainte-Lucie, Derek Walcott, un « Homère caribéen ». Son épopée des Amériques s’appelle Omeros ; et si elle n’a pas encore été traduite en français, car écrite en un anglais teinté de créole, d’autres pans, magnifiques, de son œuvre sont ici connus[9]. Le poète a su « exprimer pour la première fois un lieu, une culture et un langage sous une forme littéraire ». La dernière étape (mais n’est-elle pas provisoire au regard des évolutions de la littérature et de l’Histoire) ?) va « De Poudlard à l’Inde ». Sans préjugés, après avoir arpenté de prestigieux millénaires de littérature, notre professeur de Harvard, se plonge dans le monde d’Harry Potter. Certes il trouve l’œuvre répétitive et la traite de « fatras », de « méli-mélo médiéval et de roman d’internat » ; mais il ne peut que reconnaître, sans le dire explicitement, combien une génération a pu être formée par ce roman de fantasy et d’initiation à la sorcellerie, à cet archétypal combat du bien contre le mal. Notre essayiste à la curiosité sans limite va jusqu’à se demander si des « archéologues de l’avenir » sauront parmi Internet « dénicher des chefs-d’œuvre oubliés comme l’Epopée de Gilgamesh »…
Qu’avant les grands textes politiques les grands textes religieux soit ici présents, rien d’étonnant, entre la Bible juive, les Evangiles et les enseignements du Bouddha ; mais quid du Coran ? N’a-t-il pas « fait l’Histoire » ? Notre essayiste n’y fait allusion qu’à l’occasion de « son intégrisme textuel », alors qu’un milliard de croyants le révèrent. Que des livres fassent l’Histoire, soit, mais d’une manière positive ou délétère ? Il faut bien, au-delà de Martin Puchner, élaborer des jugements de valeurs. Si l’influence de la Bible et des Evangiles n’a pas généré que des conséquences heureuses, malgré le message intrinsèquement pacifique du Christ, celle du Coran tient en quatorze siècles de soumission, de guerre de conquête et de tyrannie[10]. De même, les textes profanes ont des influences diverses : on ne mettra pas dans le même plateau de la balance l’Encyclopédie et le Manifeste communiste.
Malgré de tels manques criants, l’essai de martin Puchner mérite plus que le détour. C’est un parcours historique non sans largeur de vue, associé avec un art du récit et de la vulgarisation agréable et entraînant, quoiqu’il présente et résume abondamment tel ouvrage en négligeant un peu tel autre - n’est-il pas permis d’avoir des préférences enthousiastes ? Il va jusqu’à voyager à Jérusalem ou Alexandrie pour accréditer son enquête dont il nous rend complice. Cependant, et en dépit de ses indéniables qualités, ne fait-il pas preuve d’un certain degré de politiquement correct ? Si la traînée sanglante du Manifeste du parti communiste et du Petit livre rouge est ici pointée, pourquoi ne pas avoir livré à un tel examen le Coran et Mein Kampf [11] ? Qu’un texte ait marqué l’Histoire ne signifie pas expressément qu’il s’agisse d’un excellent livre, tant au regard des critères esthétiques que moraux. Reste que chacun aurait beau jeu d’ajouter des grands textes à l’exposé de l’essayiste, comme les récits des mythes fondateurs que sont les Métamorphoses d’Ovide[12] pour le monde gréco-romain ou le Ramayana pour le sous-continent indien, sans compter Shakespeare et 1984 d’Orwell.
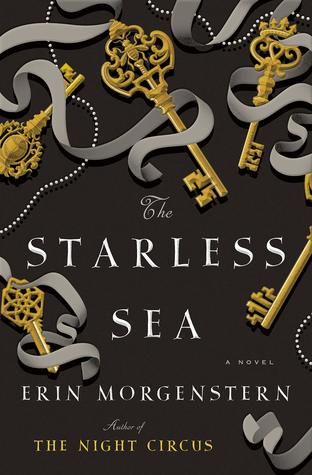

Voici un roman d’un intérêt somme toute modeste, qui de toute évidence n’a rien de la puissance des œuvres fondatrices présentées par Martin Puchner, sans compter qu’il confond à plusieurs reprises « tranche » et « dos ». Cependant, au lieu d’un regard qui revendiquerait une pertinente objectivité dans le choix des livres qui ont fait l’Histoire, toute subjective est la valeur accordée au livre par le personnage d’Erin Morgenstern, dans La Mer sans étoiles. C’est en effet lui-même qu’il quête en partant à la recherche d’un volume de la bibliothèque de sa ville. Car quelle ne fut pas la surprise du jeune Zachary Ezra Rawlins de découvrir en un roman sans auteur, intitulé Doux chagrins, « dans un livre qui a l’air beaucoup plus vieux que lui », parmi des séquences abracadabrantesques, le récit exact d’une scène de son enfance ! Une quête doit s’ensuivre, où une épée et une abeille forment un indice récurrent, alors que le livre est perdu, volé, retrouvé, dissimulé, de façon à découvrir le mystère de l’identité du jeune homme. Les péripéties abondent, entre un bal où devoir rencontrer une mystérieuse inconnue et un « Club des collectionneurs ». Cependant elles alternent avec des épisodes recueillis dans le volume mis en abyme, de l’ordre du merveilleux et de la fantasy, par un étonnant labyrinthe, avec « des disciples sans langue dans une bibliothèque souterraine », jusqu’à « la mer sans étoiles » du titre : « Il y a toutes sortes de portes dans toutes sortes d’endroits. Dans des villes grouillantes et des forêts lointaines. Sur des îles, au sommet des montagnes et au milieu des plaines ». Il faudra également passer par le « Journal secret de Katrina Hawkins » pour accéder à ce qui n’est « pas la fin de l’histoire ».
Au critère historique et planétaire qui préside au choix d’un livre - ceux que se doit de présenter toute bibliothèque digne de ce nom, publique ou privée - s’oppose, sans que cela soit en rien indigne, la subjectivité du lecteur et sa capacité d’imaginaire ouverte sur « un monde fantastique biblio-centré ». N’importe quel livre est grand s’il est élu par son lecteur, s’il est notre miroir personnel et intime, sans que cela puisse cependant tendre à un relativisme niveleur. Il faut alors souhaiter que ce lecteur, sans abandonner son fétiche, puisse un jour accéder à quelques-unes des grandes œuvres, non de son petit moi, mais de l’humanité, telles que celles d’Homère ou de Cervantès, et connaître les grands textes religieux et politiques. Non pour se placer face à eux en position de sujet et d’assujetti, mais de façon à mesurer leur implication dans l’Histoire et leur dimension morale.

/image%2F1470571%2F20220912%2Fob_9fbae7_kaiser-hunter.jpg)
Faire coïncider bibliophilie et roman policier parait une gageure ; à moins de penser à des vols de livres précieux. Egalement philosophe, le romancier allemand Gunnar Kaiser, né en 1976, va bien plus loin dans l’élaboration de son imaginaire, alternant en son Dans la peau deux romans d’initiation, dont il entrelace les fils de son intrigue, sensuelle, intellectuelle, haletante et terrible. Ce sont, dans un cruel premier roman venu d’Allemagne, les noces de la reliure et du crime.
Voici un romancier qui a le diable dans la peau selon l’expression familière consacrée : Gunnar Kaiser, avec son roman dont le titre laisse longtemps planer une avide interrogation. C’est en 1969 que l’étudiant Jonathan rencontre à New York un étrange homme mûr, Josef Eisenstein. Très vite ce dernier devient son initiateur, d’une part dans la séduction des jeunes filles dont il observe les copulations avec un Jonathan ravi, d’autre part devant sa bibliothèque aux rares volumes soigneusement reliés. Peu à peu les aventures érotiques, et parfois amoureuses, de l’étudiant qui cherche « la fille définitive », ses lectures et ses velléités enthousiastes d’apprenti écrivain, cèdent le pas à une inquiétude récurrente : qui est véritablement son mentor ?
En un habile contrepoint, Josef devient le narrateur de sa propre adolescence, qui se déroule dans un tout autre contexte : l’Allemagne des années trente et la montée du nazisme. Malgré son ascendance juive, Josef, recueilli à Berlin chez une famille allemande et ainsi appelé Schwarzkopf, traverse l’époque sans autre souci que l’hallucinante beauté des livres anciens, comme une Germania de Tacite qu’il vole aux dépens de la délicieuse fille d’un bouquiniste, désespérée au point de se jeter dans la rivière. Bénéficiant lui aussi d’initiateurs, le libraire Abramsky et le relieur Cornelius, sans oublier un tanneur, il n’aura de cesse de faire coïncider ces deux beautés en réalisant des reliures parfaites ; car « ces livres étaient sirènes et Lotophages à la fois », voire « le livre que tu ouvres et [qui] enlève le péché du monde ». Aussi, en une montée soigneusement disposée, en un enchaînement épicé jusqu’à l’horreur, devine-t-on qu’il est « L’Ecorcheur », qui sème les cadavres jeunes et féminins au service de son art exigeant et cruel. La piste passant par l’Allemagne de l’Est, Israël, enfin l’Argentine en 1990, l’enquête policière devra mettre sous le nez de Jonathan l’évidence pourtant niée.
Dès son premier roman, Gunnar Kaiser excelle dans le thriller intelligent, dépeignant des caractères opposés et divers, une amitié contrecarrée par un abîme éthique, fouillant des passions délétères, non sans érudition bibliophilique, réalisant « les noces du papier et de la peau », surtout avec le concours des classiques de l’Antiquité. Ainsi l’épiderme d’une danseuse acquiert plus de valeur : « Elle aurait pu danser pendant quelques années et enchanter le public par son art. Mais quel art éphémère cela aurait été comparé à celui qu’elle rendait possible à présent ! ». Comme le suggère son titre ambivalent, Dans la peau, il s’agit d’entrer dans celle du personnage, dont le livre-confession du même titre est une habile mise en abyme. Et si le récit de Jonathan parait plus faible, manquant parfois de tension et de concision, l’on comprend que, frappé « d’impuissance narrative » face à son fantasme de « Grand Roman Américain », cela soit intentionnel, face à la puissance et à l’autorité de celui du criminel, d’ailleurs calligraphié en « Centaur » dans un exemplaire unique.
L’on ne peut s’empêcher de penser à un autre romancier allemand, certes fort différent, Patrick Suskind, dont Le Parfum a marqué à bon droit les esprits. Un tueur poursuivait les jeunes filles pour extraire leur essence enivrante. Ici la perversion ne recule pas devant la réalisation d’un bel exemplaire de Mein Kampf relié « dans la peau » de la fille d’un officier, qui, bien sûr ignore la nature et la provenance d’une si suave reliure à lui vendue. Cependant, si le roman de Gunnar Kaiser est digne d’être relié, lui faudra-t-il une moins inhumaine peau ?
Faut-il alors penser à la reliure comme à une peau animale, que les défenseurs de la cause des quatre pattes et autres végans verraient avec horreur ? Pourtant elles habillent si bien les chefs-d’œuvre…
Louis-Sébastien Mercier publiait en 1801, dans l’Almanach des prosateurs, une charge acide contre les relieurs, « profession inutile », et la reliure, qui est la « plus cruelle ennemie » de la lecture. Ce sont « carton doré et surdoré […] peaux de bêtes bien polies, dont on couvre les productions du génie, et que l’on vend à l’ostentation et à l’ignorance […] C’en est fait, on ne l’ouvre plus[13] ». Avouons que nous ne sommes pas le moins du monde en accord avec l’auteur de L’An 2440[14], d’ailleurs étonnante œuvre d’utopie et de science-fiction avant l’heure. Certes une précieuse et fragile reliure doit se traiter avec rare respect qui ne supporte pas le continu feuilletage, mais une reliure esthétique et bien en main encourage au contraire à l’amour du livre, elle est ainsi un tentatrice du lecteur. Unir les dimensions esthétique et morale, tant dans la reliure que dans le contenu du roman ou de l’essai religieux ou politique, reste le gage de l’excellence du livre. Et s’il est indispensable de conserver en sa bibliothèque les grands livres évoqués par Martin Puchner, nous ne nous résoudrons pas à les relier tous de la même manière. Car la « peau » d’un livre doit révéler son âme.
Thierry Guinhut
Une vie d'écriture et de photographie
La partie sur Dans la peau a été publiée dans Le Matricule des anges, mars 2020.
[2] John M. Roberts et Odd A. Westad : Histoire du monde, Perrin, 2017, p 19.
[4] Murasaki Shikibu, Le Dit du Genji, Diane de Selliers, 2007.
[5] Popol Vuh, VLB / Castor astral, 1987.
[8] Voir : Requiem pour Anna Akhmatova
[13] Louis-Sébastien Mercier : Des relieurs et de la reliure, Almanach des prosateurs, 1801, p 267.
[14] Louis-Sébastien Mercier : L’An 2440, France Adel, 1977.

Reliures en veau glacé sur :
Linguet : Histoire des révolutions de l'empire romain, Desaint, 1766.
Photo : T. Guinhut.



/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)
/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)
/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)
/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)


/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)



/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)
/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_e2a305_emmaues-poupee.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)
/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)


/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)
/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)
/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)
/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)
/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)
/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)
/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)
/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)


/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)
/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)
/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)


/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)
/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)
/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)



/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)
/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)
/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)
/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)
/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)
/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)
/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)
/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6753d4_partacua-ruisseau-heinz-m-hoelderlin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)
/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)
/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)
/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)
/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)
/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)


/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_c8d327_kawabata-tristesse-et-beaute-or.jpg)
/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)


/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)
/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)
/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)
/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)
/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)


/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b16a3b_venus-roma.JPG)
/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)
/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)


/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)
/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)


/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)
/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)
/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)
/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)
/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)
/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)
/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)
/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)
/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)
/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)
/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)


/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)
/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)
/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)
/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)


/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)



/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)
/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)
/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)
/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)